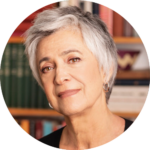Soutenances
de thèses
2025
Lucas
LEHERICY
Sous la direction de
05/05/2025
L'Etat in vivo. Le Conseil du Roi au XVIe siècle.
Au XVIe siècle, le Conseil du Roi est au fondement de la légitimité du pouvoir monarchique qui repose encore sur le principe du gouvernement par bon conseil apparu au cours du Moyen Âge. Étudiant le gouvernement royal tout au long du XVIe siècle (1515-1610), cette thèse entend rendre compte des évolutions de l’institution en prêtant attention simultanément aux productions normatives des monarques, aux discours des politistes et des pamphlétaires et aux actes de la pratique émanés du Conseil. Fondée sur le dépouillement exhaustif des sources de l’institution, elle cherche d’abord à présenter les débats sur la place de l’institution dans la « constitution monarchique » en les reliant aux tâtonnements de la réglementation royale à la même période. Elle présente ensuite le fonctionnement quotidien du Conseil en étudiant l’apparition progressive de ses archives, la manière dont il exerce la justice retenue du prince et sa mainmise nouvelle sur le pilotage des dépenses publiques. Loin de faire apparaître l’affirmation triomphale de l’absolutisme royal, cette étude laisse au contraire entrevoir l’importance de la négociation dans la pratique politique du temps : au Conseil, tout se négocie. Si le contexte des guerres de Religion favorise ces négociations permanentes, celles-ci s’expliquent également par la tradition synodale de la monarchie qui incite les rois à rechercher le consentement de leurs sujets ou des élites. Le Conseil apparaît alors comme un creuset où tout le royaume se presse pour participer à l’élaboration de la politique royale. Malgré les affirmations des thuriféraires de la monarchie, la loi du roi n’est donc pas l’expression arbitraire de ses volontés : elle apparaît plutôt comme le fruit d’une négociation constante. |
Olga
MELNICHENKO
Sous la direction de
09/01/2025
Les entrepreneurs français dans l'industrie russe de la soie (XIXe s.- 1914): un secteur industriel porté par les migrants français
Tout au long du XIXe siècle, l’industrie de la soie en France a connu des crises périodiques. Celles-ci concernent à la fois les ouvriers, les industriels et les commerçants. Afin de surmonter les difficultés économiques, les spécialistes français de l’industrie de la soie, et pas seulement eux, tentent d’appliquer leurs connaissances et leurs compétences à l’étranger. L’une des destinations de leur émigration était la Russie. Pourquoi ont-ils choisi ce pays en particulier ? Quels ont été leurs premiers pas ? Quelle stratégie ont-ils choisie pour surmonter les difficultés, prendre une position importante sur le marché russe et, finalement, devenir les leaders de l’industrie russe de la soie ? Dans quelles conditions cette industrie s’est-elle développée dans une perspective historique ? La présente étude tente de répondre à ces questions et à bien d’autres, en se basant sur les sources des archives publiques et privées, les sources publiées et les témoignages des descendants des personnages de cet ouvrage, en raison de la nature inexplorée du sujet et du manque de publications sur ce thème.
2024
17/12/2024
Des cartes, des humains et des glaces. Savoirs, empires et mondes sous les latitudes d'un Nord global (vers 1530-vers 1610)
Cette thèse est consacrée à la place des plus hautes latitudes du globe dans les opérations impériales et savantes européennes au cours d’un long XVIe siècle. Loin d’avoir été périphériques, elles se présentèrent à la fois comme un enjeu impérial et comme un objet voire un terrain du savoir. Dans ces espaces inconnus des « Anciens », mais dont les frontières n’avaient pas été beaucoup repoussées depuis, à part au nord et autour de la Scandinavie, il y avait de l’espace pour expérimenter. Les puissances européennes écartées du partage ibérique du globe (Français, Anglais, Danois, Suédois, puis Néerlandais) cherchèrent ainsi des mondes et des empires en pariant sur les hautes latitudes contre les logiques cartographiques adverses d’un « englobement » du monde longitudinal, qui avait circuit le monde pour le déplier sur un axe Est-Ouest. En Espagne, au Portugal ou à Anvers, on ne négligea pas de leur répondre, ni d’anticiper le problème de ces latitudes qui trouaient toujours le globe ibérique, alors qu’on avait éprouvé ailleurs toutes les grandeurs de cette nouvelle Terre devenue globe homogène et connectable. À travers un double questionnaire d’histoire des empires et d’histoire des savoirs, accompagné de réflexions d’histoire matérielle et d’anthropologie historique, cette thèse envisage une série d’opérations avec les espaces et les environnements des hautes latitudes autant qu’avec le globe même. Elle restitue les problématisations de ces espaces troubles de l’« englobement du monde » (A. Romano), et ce à deux échelles d’observation : l’Europe savante et les empires européens d’une part, les mondes du savoir en Suède et le premier impérialisme des Vasas de l’autre. En saisissant le Nord, l’empire et les savoirs en train de se faire, dans une série de lieux (en particulier Anvers, Stockholm, Venise, Paris, Londres et Amsterdam), mais aussi sur le terrain, dans le Nord de la mission romaine ou par l’espionnage savant loin de chez soi, ce travail s’attache à reconstruire les mondiations originales que permettent les médiations septentrionales du globe. S’observent également des politiques des savoirs particulières qui ne séparent que relativement les différents domaines de leur appréhension, mêlant géographie, histoire (sacrées comme profanes), philosophie naturelle, art de la navigation, droit ou encore astrologie et étymologie. Terrain d’expérimentation épistémologique permettant d’appréhender la nature comme l’empire, le Nord global offre alors un point d’observation des heurts de l’englobement autant que des techniques du désangoissement savant et impérial. Alors qu’une première partie cherche à montrer de quoi la dialectique du passage arctique et du grand pont terrestre transatlantique est le nom, une seconde envisage la construction des savoirs et des empires du Nord au moment de l’acclimatation savante des glaces, en se demandant si, absentes des cartes à première vue, elles ne seraient pas en fait bien là, ressources négligées de la mise en globe. Cette thèse réinterroge alors, par une histoire socio-culturelle des savoirs, la première projection impériale du royaume de Suède, dans les années 1560-1570. À partir d’un étrange globe terrestre, et de longues listes inscrites par Erik XIV (r. 1560-1568) dans les marges de ses livres de captivité, après avoir été déposé par ses frères, on pourrait paradoxalement observer l’empire suédois en train de s’inventer, lorsque, poussant plus loin les dynamiques de son règne, le corps du roi de Suède prend un tournant global, utilisant les savoirs géographiques comme agents de sa charge sacrale, non sans entrer alors en conflit avec le « constitutionnalisme aristocratique » de la noblesse. Ainsi l’empire suédois achopperait-il une première fois, lorsque Erik XIV fut déposé en 1568 après avoir tenté de rendre son corps politique coextensif aux nouvelles grandeurs de la terre, écart aux pratiques qui posa un précédent dans la recherche ultérieure de l’empire.
14/12/2024
Le projet intellectuel d'un réformateur : Philippe de Mézières (1327-1405)
Cette thèse est consacrée à l’étude de l’activité littéraire de Philippe de Mézières (1327-1405) dans une perspective d’histoire intellectuelle. Elle s’appuie sur des concepts élaborés par l’« École de Cambridge », en mettant l’accent sur l’interaction entre les langages intellectuels – des façons de parler fondées sur des autorités – et les actes de langage – des énoncés réalisés à l’aide de ces langages. Je commence par souligner le rôle de Philippe de Mézières lui-même dans la construction de récits biographiques repris par l’historiographie. Une enquête sur les principales références utilisées dans les œuvres de Mézières m’amène ensuite à souligner un recours ostentatoire aux sources bibliques et patristiques. Je l’explique par ses affinités avec une culture intellectuelle émergente, centrée sur la cour papale d’Avignon et pratiquée par un cercle influent et mobile de clercs et de laïcs ayant un penchant pour la création littéraire et la pensée réformatrice. Des études de cas consacrées à Nicole Oresme et à Brigitte de Suède me permettent d’illustrer les relations sociales et intellectuelles soudant ce réseau. Une dernière partie est consacrée aux fondements de la vision du monde de Mézières. Son œuvre met en évidence la relation historique entre Dieu et la congrégation des fidèles. Son intérêt pour l’Église primitive et son plaidoyer en faveur d’un concile général incluant des laïcs le rapprochent à la fois des critiques de la papauté d’Avignon et des partisans du mouvement conciliaire. Son projet d’Ordre de la Passion témoigne d’une préférence pour l’ecclésiologie des ordres militaires ainsi que pour les institutions politiques des cités-états de l’Italie du Nord.
30/11/2024
Pouvoirs et territoires en Bohême, Xe-XIIIe siècle
Depuis une trentaine d’années, les médiévistes français écrivent différemment l’histoire du territoire dans l’Occident latin. Ils le font, cependant, en prenant très peu en compte l’Europe centrale, tandis que l’historiographie tchèque n’a pas connu le même tournant. Le but du travail est de remédier à ce manque de dialogue entre les historiographies, tout en utilisant les concepts développés hors de Tchéquie pour analyser à nouveaux frais les documents écrits de l’époque přemyslide (Xe-XIIIe siècle). Les processus de territorialisation, c’est-à-dire de définition de portions d’espace par leurs limites et par leur domination, notamment politique, ont été étudiés sur l’ensemble de la période, sans distinction stricte entre laïcs et clercs, ou entre acteurs « étatiques » ou non. Cette démarche a permis d’aborder sous un angle différent quelques concepts fondamentaux de l’historiographie tchèque, tels que le système castral, les grandes-paroisses ou la gestion des frontières du royaume, et de relire des documents aussi célèbres que la « description du diocèse de Prague » ou les premières chartes produites par des institutions ecclésiastiques en Bohême. Elle éclaire aussi différemment le contraste entre deux Moyen Âge tchèques séparés par les transformations du XIIIe siècle. Une grande attention a été accordée à la relation entre territorialités laïques et ecclésiastiques, dans la mesure où cela offrait les plus grandes possibilités de comparaison avec l’historiographie française récente. Les diocèses de Prague et d’Olomouc ne semblent pas, à l’issue de ces recherches, s’être distingués précocement par leur territorialité unique. En revanche, les acteurs ecclésiastiques, principalement mais pas seulement les réguliers, semblent bien avoir été pionniers dans leur manière d’envisager leurs propriétés foncières comme des territoires : de ce point de vue, l’histoire du territoire médiéval est semblable en Bohême et en France. Cette précocité ecclésiastique n’empêche pas des modes très similaires d’appréhension et de contrôle de l’espace, notamment par la perambulation, pratique attestée aussi bien chez les laïcs que chez les clercs, et dont les évolutions au XIIIe siècle sont ici relues à la lumière des appréciations récentes de la coutume et des rituels médiévaux.
30/11/2024
Cours d'eau et sociétés humaines dans le bassin atlantique de la Gaule franque
Au cours des quarante dernières années, nombres d’aménagements et d’épaves datés du haut Moyen Âge ont été découverts dans les fleuves français du bassin atlantique. Pourtant au sein des travaux diachroniques et localisés qui étudient les fleuves, il y a souvent le même absent : le haut Moyen Âge. Cette absence d’étude entre en contradiction avec les nombreux vestiges de cette période retrouvés dans les rivières.Grâce à des sources textuelles et des données archéologiques, ce mémoire a donc pour objectif de dévoiler ce que furent les cours d’eau en Gaule franque, quelles activités y trouvaient place, et comment ces activités s’inscrivaient dans la continuité ou le changement par rapport à la période de la Gaule romaine.Il apparaît finalement que l’interaction des humains avec les cours d’eau de Gaule franque se caractérise par l’exploitation des ressources notamment grâce au développement de nombreux moulins et pêcheries. Cette interaction s’illustre également par l’aspect régalien qui est conféré au cours d’eau par la gestion des ponts, les péages, les frontières fluviales et les affrontements sur l’eau. Ces fleuves sont aussi des axes de communication qui ont permis le transport de biens et de personnes en Francie et au-delà. Les raids vikings et la naissance d’al-Andalus ne font pas disparaître pas ces échanges fluvio-maritimes. Cette exploitation, ce contrôle de l’État et ces échanges ont également été rendus possibles par la présence de nombreux navires diversifiés francs et d’outre-mer. Leurs navigations ont été facilitées par la présence de ports éclectiques sur les rives. L’humain utilise donc toujours le milieu fluvial pour survivre, voyager et s’imposer.Cependant par rapport aux activités menées sur les cours d’eau de Gaule romaine, on peut noter des évolutions. Ainsi, alors que nulle pêcherie ne semble exister en Gaule romaine, au cours du haut Moyen Âge, des dizaines d’entre elles sont fondées sur les cours d’eau francs. Alors que les moulins fluviaux en Gaule romaine étaient situés à des centaines de mètres de la rivière en lien avec des bassins et de très longs biefs, en Gaule franque, ces moulins sont désormais placés au plus proche du cours d’eau. L’emprise de l’humain se resserre sur les ressources fluviales. La mention d’Ulpien, juriste du IIIe siècle, disant qu’il ne fallait rien construire sur un fleuve qui entrave la bonne marche des navires, n’est plus à l’ordre du jour. L’emprise régalienne se resserre également avec le caractère frontalier qui échoit à bien des cours d’eau durant le haut Moyen Âge. Les échanges externes vers les contrées d’outre-mer semblent également évoluer puisque des navires voyagent désormais depuis les estuaires francs vers l’Irlande et la péninsule Ibérique. Concernant les navires, alors, que ceux évoluant en Gaule romaine étaient construits avec des clous, ceux de Gaule franque sont principalement façonnés avec des chevilles. Les ports témoignent aussi d’évolution entre ces deux périodes. Alors que les ports gallo-romains étaient construits selon une structure à caissons, les ports de Gaule franque semblent être devenus très hétérogènes allant de ponton de bois à des môles de pierres. La conclusion quant à ces évolutions est que le cours d’eau n’est plus un simple vecteur d’échanges, il devient un espace que l’on exploite au maximum.L’interaction entre cours d’eau et humains sur le bassin atlantique de Gaule franque, c’est une emprise humaine qui s’accroît et se diversifie sur le milieu fluvial. Cette emprise ne cessera de se renforcer au cours des siècles qui suivront. La multiplication des conflits entre meunier, batelier et pêcheur mais aussi l’impact environnemental sur le milieu aquatique en seront les symptômes révélateurs.
30/11/2024
Faire capitale dans l'État territorial lombard : Pavie (1359-1500)
En 1359, Galéas II Visconti, coseigneur de Milan, s’empare de la petite cité de Pavie, située à une trentaine de kilomètres au sud de Milan. Son installation directe dans la ville répond au projet d’en faire sa capitale, tandis qu’il laisse Milan aux mains de son frère Barnabé. L’obtention du titre ducal par son fils Jean Galéas en 1395, suivie de la création du comté de Pavie l’année suivante, sont les étapes fondamentales qui fondent la légitimité politique de la branche « pavesane » des Visconti.Malgré une résistance initiale de la population locale, une fois la ville conquise, le projet de Galéas suscite très rapidement l’adhésion des habitants, surtout des élites urbaines prêtes à saisir l’opportunité représentée par le service de cour. Parallèlement, de multiples chantiers sont lancés dans la ville, et aboutissent à transformer en profondeur son aspect. De petite ville gouvernée par des familles seigneuriales concurrentes, Pavie devient temporairement la capitale du duché sous Jean Galéas, un statut qui se transforme par la suite, mais dont les effets perdurent longtemps, jusque sous les Sforza.Ce travail vise à comprendre les implications politiques, culturelles, sociales, économiques et territoriales de la remise en capitale de la ville de Pavie pour en saisir la multiplicité des enjeux et les questionner dans le contexte spécifique de la construction de l’État territorial lombard entre 1359 et 1500.
25/06/2024
Politique de souveraineté et sociabilité de cour dans la Principauté de Monaco, du Printemps des peuples à la mort d'Albert Ier (1848-1922)
En 1848, le Printemps des peuple ébranle la principauté de Monaco. Après avoir fait sécession, Menton et Roquebrune sont intégrées à la France, en 1861, en échange de compensations financières et d’un accès routier. Plus que jamais réduite à un État confetti, mais désormais affranchie de tout protectorat, la Principauté retrouve une réelle indépendance alors même que la tendance est aux unifications nationales. Toutefois, sa viabilité implique une refondation. Celle-ci est d’abord économique et se traduit par l’essor du tourisme d’hiver. Elle est aussi diplomatique, et Monaco, à l’égal de toute puissance classique, s’efforce de s’insérer dans le « concert des nations » en développant des représentations consulaires et diplomatiques et en passant des traités. C’est aussi une refondation institutionnelle portée par la construction d’un appareil d’État, et qui débouche sur l’octroi d’une constitution en 1911. Enfin, c’est une refondation culturelle, dont l’opéra de Monte-Carlo, la participation de Monaco aux Expositions universelles et l’action personnelle du prince Albert Ier dans le domaine des sciences sont les incarnations les plus remarquables. Pour les princes de Monaco, il s’agit d’affirmer une souveraineté fragile puisqu’elle ne repose ni sur la puissance commerciale, ni sur celle des armées. Tout en multipliant les attributs légaux et symboliques du pouvoir, ils développent une sociabilité brillante, ainsi qu’une vie de cour destinée à leur servir de relais et à étancher leur soif de représentation. D’un point de vue personnel, dans ce contexte de mutations, l’enjeu, pour Charles III et Albert Ier, est certes de consolider un régime, mais aussi de tenir un rang.
15/06/2024
Richesses foncières et espaces au Haut Moyen-Âge : jeux d'échelles et de représentations en Gaule de l'Empire romain tardif à l'Empire carolingien
Cette étude porte sur les interactions et les évolutions entre ressources, espaces contrôlés, positionnement social et mémoire en Gaule du IVe au IXe siècle. Elle insiste sur la force des représentations et sur l’importance des échelles et des focales d’observations pour les questions relatives à la richesse et à l’espace. Elle propose des hypothèses sur les géostratégies individuelles et collectives mises en œuvre au regard d’environnements changeants et de territoires en évolution. Elle souligne une rationalité économique relative des acteurs médiévaux, qui n’exclue pas des comportements irrationnels et des rapports de forces violents dans la domination de la terre. Elle étudie la manière dont les acteurs du haut Moyen-Âge se créent ou utilisent des souvenirs de circulations foncières comme outils de mémoire, d’influence et de pouvoir. Elle met en relief le changement permanent de terres permettant aux personnes de se réinvestir sans cesse dans une stratigraphie sociale et des structures politiques en constante évolution. Elle insiste sur la réduction de l’importance de la propriété, du foncier et de l’espace dans le positionnement social des individus au profit d’accès à des réseaux. Elle propose des hypothèses sur les modalités par lesquelles les populations altomédiévales se représentent l’espace.

Christina
FEIST
Sous la direction de

Dominique Bourel
Sorbonne Université
17/04/2024
Désormais, je suis, Dieu soit loué ! un philosophe." De la réception de Kant à la réforme religeuse : le projet de la Haskala de Lazarus Bendavid
Les tâche de recherche principales de la dissertation sont d’analyser l’impact qui a eu la philosophie kantienne sur la pensée de Lazarus Bendavid (1762 – 1832) et sa philosophie du judaïsme. Le personnage de Bendavid étant très peu connu, nous présentons ainsi la première biographie complète de cet intellectuel de la Haskala et sa vie entre Berlin et Vienne. De même nous avons, pour la première fois, recherché son projet de Haskala à fin de mettre en lumière sa vision pour un Judaïsme individuel et autonome, son rôle important pour le Kantisme juif et son impact sur le processus d’évolution d’une identité juive allemande et, enfin, de la création de la Wissenschaft des Judentums. Il s’agit donc d’un projet à l’intersection de philosophie, histoire et études juives, qui, en examinant l’Aufklärung à Berlin et Vienne, recherche la biographie peu connu et l’oeuvre peu recherché d’un de ses intellectuels: Lazarus Bendavid.
22/03/2024
Le lys royal et l'aigle impérial : la mission diplomatique du comte de Ségur auprès de la cour de Catherine II de Russie (1785-1789).
Perspectives commerciales et itinéraires diplomatiques franco-russes à la fin de l'Ancien Régime
La thèse de doctorat s’intéresse à la figure du comte Ségur et à sa mission diplomatique à la cour de Catherine II de Russie (1785-1789). La recherche explore différents aspects, notamment les relations commerciales et diplomatiques entre la France et la Russie, le rôle de Ségur en tant que diplomate et ses interactions avec des personnages clés, tels que Catherine la Grande et Potemkine. Elle analyse également l’identité et la personnalité de Ségur, en tenant compte du contexte social et culturel de l’époque. L’objectif principal de la recherche est de fournir une nouvelle perspective sur l’histoire française de la période pré-révolutionnaire, en cherchant à mieux comprendre les dynamiques diplomatiques et politiques de l’époque.
26/02/2024
Un arbre en ce monde. Théodore de Bèze, moraliste du contemptu mundi
Inspirés par les idées de détachement et de renoncement, les thèmes cléricaux et monastiques du contemptus mundi dénoncent la richesse, la chair et la gloire comme autant d’obstacles dans la quête de Dieu. Ils devaient, cependant, être renouvelés à la faveur de sa réception humaniste tandis que la Réforme, de son côté, avait besoin d’une doctrine du mépris du monde qui lui soit propre. La façon dont ce topos est transformé par Théodore Bèze au XVIe siècle pour devenir un thème majeur pour les réformateurs n’a pas encore reçu l’attention qu’elle mérite. C’est pourtant une manière importante de comprendre leur « imaginaire » à partir des mentalités, de l’anthropologie culturelle et de la théorie de la réception. Via les genres littéraires à sa disposition, Théodore Bèze favorise une reconfiguration du contemptus mundi à partir des traditions médiévales et classiques. Son itinéraire commence à Orléans dans le contexte de la poésie latine humaniste et de l’évangélisme, ainsi que dans les bouleversements provoqués par les persécutions. Sa conversion au calvinisme le conduit à l’exil. La reformulation du mépris du monde à travers ses thèmes de prédilection comme la conversion, les normes et la discipline des églises, les confessions de foi, la sanctification, l’eschatologie, la méditation sur la mort et la vanité de ce monde… s’est traduite par une diffusion plus large du motif à travers de nouveaux genres et médias. Bèze a joué un grand rôle dans l’adoption d’une conception éthique personnelle d’une attitude chrétienne droite à adopter face au théâtre d’un monde en mutation. Cette reconfiguration du mépris du monde est devenue constitutive du rayonnement calviniste en Europe.
15/02/2024
Les ingénieurs français et le développement économique de la Chine (1840-1911)
À la fin de la dynastie des Qing, un nombre important d’ingénieurs français se rendirent dans différentes régions de l’Empire chinois, jouant divers rôles dans les relations franco-chinoises. Provenant de milieux sociaux variés, ils étaient souvent jeunes et partageaient des profils professionnels. Fréquemment bien rétribués et parés de titres honorifiques au cours de leur carrière, nombre d’entre eux connurent une ascension sociale notable. L’effectif de ces ingénieurs augmenta de manière significative du milieu du XIXe siècle au début du XXe. Initialement, les ingénieurs militaires occupaient une position prédominante, mais ils cédèrent progressivement la place aux ingénieurs issus des corps civils d’État et aux ingénieurs civils qui assumèrent une multitude de fonctions dans les affaires commerciales et industrielles. Simultanément, un grand nombre d’ingénieurs militaires rejoignirent des activités commerciales privées, lesquelles se multipliaient et se diversifiaient. Les ingénieurs français qui s’installèrent en Chine pour une longue durée étaient principalement des ingénieurs civils. Le mariage, la religion et l’attrait culturel constituaient des éléments essentiels pouvant conduire à un séjour prolongé en Chine. Dans l’Empire chinois, la France bénéficiait de ses élites techniques pour rivaliser avec les autres puissances industrielles. Ces ingénieurs réalisèrent d’importants ouvrages dans l’Empire chinois, laissant derrière eux un patrimoine historique. Sans que ce fût toujours un succès économique, leurs réalisations témoignaient à la fois de leurs compétences techniques et de la puissance technologique de la France. Leurs écrits, rapports, plans, récits et correspondances familiales, ainsi que les photographies qu’ils prirent et les documents qu’ils rapportèrent, constituaient des éléments de recherche précieux pour les études historiques. S’ils transmirent un savoir-faire, leur rôle fut limité par les contraintes historiques.
26/01/2024
La fiscalité coloniale du royaume de France (1600-1732)
La fiscalité coloniale du royaume de France est un système douanier et fiscal transatlantique étroitement lié aux activités économiques et commerciales des colonies françaises aux XVIIe et XVIIIe siècles. Cette fiscalité prit sa première forme dans les années 1670, marquées par la création de la ferme du Domaine d’Occident en 1675. Il s’agit d’un système des privilèges anciennement détenus par les compagnies coloniales, qui ont été transformé en droits fiscaux au cours des années 1650-1670. Dans le dernier quart du XVIIe siècle, les financiers engagés dans le grand commerce ont cherché à combiner les droits de la fiscalité coloniale avec les privilèges commerciaux afin d’obtenir des profits supplémentaires. Cela a donné lieu à des rivalités entre les groupes d’intérêts autour de la fiscalité coloniale.Au XVIIe siècle, l’administration de la fiscalité coloniale a longtemps relevé des départements des Finances et de la Marine. Cependant, à partir de 1698, les deux départements n’étaient plus dirigés par un même ministre. Et, à partir des années 1710, alors que les problèmes financiers du royaume s’aggravaient, l’administration des impôts coloniaux devient un sujet de discorde entre les deux départements. Une série de réformes dans les années 1720 permet de régler ce différend. Nous avons choisi la division du Domaine d’Occident en 1732 comme borne terminale de cette étude. Cet événement marque la répartition définitive de la fiscalité coloniale entre le contrôle général des finances et la Marine, et il annonce la formation du modèle définitif de la fiscalité coloniale du royaume de France.
16/01/2024
La noblesse canadienne de la Conquête à la Grande Guerre : identité et devenir d'un groupe élitaire (1760-1918)
Lors d’une conférence prononcée en 1922, Louis Alexandre Taschereau, premier ministre du Québec et d’ascendance noble, fait l’apologie de la noblesse canadienne en insistant sur le fait qu’elle occupe toujours le premier rang de la société. À l’inverse, une certaine historiographie (Ouellet, 1966; Brunet 1969 ; Séguin, 1970) a prétendu que le groupe nobiliaire a perdu son autorité dès la Cession de la Nouvelle-France. Il est indéniable que la noblesse s’est transformée lorsque la période préindustrielle a peu à peu laissé place à l’ère industrielle, mais dans quelle mesure? Cette thèse poursuit l’objectif d’établir un portrait du devenir de l’ensemble des familles nobles d’origine française restées au Canada, de la Cession de la Nouvelle-France jusqu’à la Première Guerre mondiale, en portant une attention particulière à ses comportements démographiques et matrimoniaux ainsi qu’aux parcours professionnels et à l’identification à ses lignées ancestrales.Si la Cession nécessite une adaptation, la deuxième moitié du XIXe siècle constitue un choc encore plus important. De nombreuses familles nobles ont connu un glissement social, mais ce processus s’est effectué progressivement dans le temps et à des moments différents selon les cas. Surtout, l’ensemble des thèmes étudiés convergent vers un noyau de familles ayant réussi à conserver une position élitaire et à maintenir une autorité locale, régionale et, dans quelques cas, nationale, voire plus rarement, impériale. Des caractéristiques du régime français persistent au sein de ce sous-groupe restreint, telle que la propriété foncière et la valeur du service. Celui-ci fait aussi preuve d’adaptation, par exemple sur le plan professionnel et du choix des conjoints. Alors que de nombreuses familles déclinent au fil du XIXe siècle, des initiatives identitaires émergent parallèlement chez celles s’étant maintenues, qui revendiquent une appartenance à une lignée le plus souvent en voie d’extinction démographique.
2023

Vincent
PETIT
Sous la direction de

Esther Benbassa
École Pratique des Hautes Études - Université PSL
11/12/2023
Émissaires d'une émancipation féminine juive : les institutrices de l'Alliance israélite universelle dans l'aire judéo-espagnole de l'Empire ottoman (1872-1924)
Vincent Petit est docteur de l’EPHE / PSL, sa thèse préparée sous la direction d’E. Benbassa et soutenue le 11 décembre 2023, Émissaires d’une émancipation féminine juive : les institutrices de l’Alliance israélite universelle dans l’aire judéo-espagnole de l’Empire ottoman (1872-1924) porte sur la vie de ces femmes partagées entre Orient et Occident, formées dans l’unique école normale juive française et sur l’éducation féminine au XIXe et au début du XXe siècle dans l’Empire ottoman et en France. Son travail traite aussi de la formation des institutrices et de l’évolution de la condition des femmes dans ces sociétés en s’appuyant sur leur correspondance régulière avec le siège parisien de l’Alliance qui constitue un corpus en français riche, dense et unique, car il documente l’histoire de la vie quotidienne des femmes juives d’Orient, grâce au témoignage laissé par ces femmes judéo-espagnoles résolument engagées dans une lutte contre la pauvreté et en faveur de la transformation des sociétés juives et de la condition féminine.

Jérôme
LIMORTÉ
Sous la direction de
09/12/2023
Les comtes de Blois de la fin des Thibaudiens à Guy Ier de Châtillon : des princes aux barons (milieu du XIIe siècle – début du XIVe siècle)
Entre le milieu du XIIe et le début du XIVe siècle, les comtes de Blois sont des figures éminentes mais discrètes d’une société politique de plus en plus dominée par le roi de France et sa famille. Des prestigieux Thibaudiens en quête d’une couronne aux Châtillons dans l’ombre du roi, l’histoire des comtes de Blois est celle de barons qui, ne pouvant être princes, sont parvenus à maintenir leur rang durant près de deux siècles. En s’appuyant sur des sources comtales, en grande partie inédites, il s’agit dès lors de retracer la succession des lignages – Thibaudiens, Avesnes et Châtillons – qui gouvernent le comté de Blois. Sont alors mis en évidence leurs points communs, notamment la proximité avec le roi, l’attention portée au château de Blois, symbole de leur puissance et à la ville qui l’entoure, et leurs différences, en particulier le prestige de leurs origines, leurs politiques religieuses et leurs stratégies de distinction. Une attention particulière est portée aux changements dynastiques et au gouvernement par les comtesses, en s’interrogeant sur leur rôle dans la trajectoire du comté. Parmi elles, la figure de Jeanne de Châtillon (1280-1292), épouse de Pierre d’Alençon, mérite d’être mise en valeur car elle incarne d’une part la tension entre conscience dynastique et intégration à la famille royale et d’autre part une éphémère ambition princière qui disparaît avec elle. À la tête d’un ensemble multipolaire, composé des comtés de Blois et de Chartres puis du comté de Blois et des seigneuries d’Avesnes et de Guise, les comtes se dotent d’une administration de plus en plus étoffée et spécialisée afin de renforcer leur autorité sur leur territoire. Cela implique également la constitution et la multiplication de nouveaux outils de gestion à partir du milieu du XIIIe siècle : cartulaires, comptes généraux et livre des fiefs. Le développement de l’administration permet au comte d’augmenter les revenus de ses possessions. À travers le compte général de 1319, se dessine l’image d’un comte qui dispose de revenus considérables mais toujours en quête d’argent tant sa position sociale l’oblige à la largesse et à déployer un train de vie fastueux. Pour répondre à cet endettement, le comte recourt à des expédients, comme des emprunts auprès de ses bourgeois blésois et des Lombards, ce qui rend les seigneuries d’Avesnes et de Guise essentielles pour les comtes. Ce travail entend également saisir la place de ces seigneuries dans l’ensemble territorial gouverné par les Châtillons. Pour cela, le choix a été fait d’étudier la politique d’acquisition que mènent les comtes dans chacune de leurs possessions. Alors que les comtes multiplient les achats dans leur domaine ligérien, se concentrant notamment sur les forêts, symboles de pouvoir et espaces de richesses, ils prêtent une attention moins forte à leurs seigneuries septentrionales comme en témoignent les politiques sigillaires, onomastiques, testamentaires et funéraires des Châtillons de Blois. Enfin la société féodale blésoise est analysée à travers le livre des fiefs de 1322. Rédigé par l’administration comtale, ce document donne un aperçu de la diversité et de l’hétérogénéité des vassaux du comte. Il apparaît alors qu’aucun feudataire ne peut rivaliser avec le comte qui est à la tête d’un réseau castral important et dont le pouvoir a été renforcé par la mise en place d’une « féodalité administrative ». Cette situation s’explique en partie par le renforcement du pouvoir royal qui a bénéficié aux barons dont les comtes de Blois font indéniablement partie.
08/12/2023
Les présents diplomatiques de Louis XV : des objets d'art au service du dialogue international
Bijoux, porcelaines, tapisseries et tapis, pendules, montres, orfèvrerie, boîtes, tabatières, pistolets, médailles, livres, peintures, mobilier, vins de Bourgogne et de Champagne : cette longue énumération illustre la variété des objets et produits qui ont été envoyés tout au long du XVIIIe siècle par Louis XV en Europe, mais également en Asie, en Afrique ou en Amérique du Nord. Le présent est un sujet inévitable lorsque l’on aborde la diplomatie et il s’inscrit profondément dans le cérémonial au sein des cours européennes. Si celui-ci est principalement utilisé pour le défraiement du diplomate étranger à la fin de sa mission, le présent permet également au souverain d’en faire un instrument au service de sa politique. Durant le règne de Louis XV, les présents diplomatiques deviennent aussi des outils et instruments permettant de renforcer une alliance, d’en changer, de corrompre un individu ou encore de célébrer la paix. Par ailleurs, l’échange de présents entre souverains fait apparaître les notions de don et de contre-don étudiées par les anthropologues. L’étude de ces objets précieux – qui nécessitent fréquemment l’intervention de plusieurs corps de métier (artistes, artisans ou marchands), mais aussi celle d’acteurs institutionnels comme les Affaires étrangères, le Garde-Meuble de la Couronne et les manufactures royales – apporte un éclairage nouveau sur les usages et les modes d’exercice du pouvoir, le fonctionnement d’institutions curiales ou encore les modes de consommation et la diffusion du goût français à l’étranger au XVIIIe siècle. Mots-clés : présents ; diplomatie ; luxe ; artisan ; cour ; Versailles ; manufactures royales ; Louis XV.
02/12/2023
Sous les ailes de l’archange. Saint Michel à l’épreuve de l’histoire (France, XVe XVIIe siècle)
Cette thèse étudie la destinée de saint Michel dans la France du début de l’époque moderne. Dans le contexte d’une spiritualité multipliant les pratiques dévotionnelles, l’archange, par la place qu’il occupe dans le culte, la croyance et la société, est en effet une figure essentielle de la sainteté à la fin du Moyen Âge. Par ailleurs, il bénéficie du choix des Capétiens de faire de lui, au XVe siècle, le véritable défenseur et l’ange tutélaire du roi et de la monarchie française. De ce fait, il n’est pas épargné par la remise en question du culte des saints par les idées réformatrices puis, lors des troubles de religion, par les actes iconoclastes visant les symboles catholiques et royaux. Mais son ancrage ancien et l’idéal victorieux qu’il porte le placent en première ligne dans la reconquête catholique au plus fort des guerres de Religion. Toutefois, cette utilisation politique n’est pas sans effet sur le saint archange qui perd de son éclat au XVIIe siècle. Prenant appui sur un vaste corpus de sources textuelles et iconographiques, envisagées dans leur grande variété de forme et de thématique, cette recherche entend faire de l’archange un acteur de l’histoire du royaume de France en cette période de bouleversements et ainsi révéler la figure emblématique du providentialisme royal et français qu’est saint Michel.
25/11/2023
Les métamorphoses du pouvoir : pratiques, langages et conceptions politiques des seigneurs de Romanie latine (1204-1316)
Ce travail vise à analyser la manière dont les seigneurs latins installés dans les territoires byzantins à l’issue de la Quatrième croisade ont adapté leurs manières de gouverner à un nouvel environnement politique et culturel. Il porte sur un groupe de 422 individus, allant des empereurs de Constantinople jusqu’aux modestes chevaliers n’ayant que leur équipement militaire ainsi que les ressources démographiques et économiques nécessaires à leur entretien. Le point commun de ces individus est de se revendiquer d’un même groupe social, à savoir l’aristocratie, qui se définit avant tout par sa prétention et sa capacité à dominer le reste de la société. Ce groupe social fonde sa cohérence et sa cohésion sur un ensemble de manières d’être, de faire et de penser visant à légitimer sa domination. Ceci étant, il est structuré par une forte hiérarchie interne au sommet de laquelle est promu un petit nombre de familles tirant les fruits de la croisade. Ces seigneurs implantés en Romanie entendent reprendre le flambeau du gouvernement de l’empire byzantin dans une perspective universaliste. Aussi est-il question dans cette étude de la majeure partie de cet espace, à savoir le domaine impérial – autour de Constantinople, en Thrace et au nord-ouest de l’Asie mineure –, le royaume de Thessalonique, les seigneuries d’Athènes et de Négrepont, ainsi que la principauté de Morée. L’étude de cette domination aristocratique débute en 1204, avec la conquête de Constantinople, et se poursuit jusqu’en 1316, alors que les possessions latines ont pour la plupart été reconquises et que la Morée n’est désormais plus gouvernée par un prince présent sur place mais passe entièrement sous administration indirecte de la cour angevine de Naples. Au fil de ce long XIIIe siècle, l’aristocratie latine déploie des pratiques de gouvernement venues d’Occident et transforme en conséquence les structures politiques ainsi que l’organisation territoriale des anciens territoires byzantins. En effet, à partir de 1204, le groupe dominant en Romanie est imprégné des codes et imaginaires de la chevalerie en vertu desquels ses membres imposent leur domination par divers usages de la violence, par un nouvel exercice de la justice et par un subtil jeu de postures et de représentations de soi. En outre, cette aristocratie chevaleresque fait valoir son autorité dans l’espace au moyen de chevauchées et de la multiplication des constructions castrales qui refaçonnent les terres d’empire. Pour autant, les seigneurs latins récupèrent aussi une partie de l’héritage byzantin et s’adaptent aux sociétés qu’ils prétendent dominer quand cela peut servir leur hégémonie. À Constantinople, ils se montrent particulièrement soucieux de perpétuer une tradition impériale qui ne leur est pas étrangère mais qui répond à leurs idéaux de « res publica », au service du salut de tous les chrétiens. Dans cette optique, ils mettent également en place des dispositifs pour gouverner de manière collective dans lesquels sont impliqués des individus pouvant se revendiquer barons. Ces dispositifs, déjà existants en Occident – comme la tenue de conseils ou les procédures électorales –, connaissent un nouvel épanouissement en Romanie. Ils contribuent à équilibrer les rapports de pouvoir entre les souverains – empereurs, rois et princes – et le groupe baronnial qui les entoure. Enfin, dans la mesure où les seigneurs latins de Romanie sont au départ des croisés, ces derniers remobilisent activement par la suite les gestes et imaginaires de la croisade, entretenant tout particulièrement le souvenir des premiers croisés et des rois de Jérusalem comme des modèles politiques à imiter. L’implantation de pratiques venues tout à la fois de l’Occident et de l’Orient latin dans un environnement impérial et grec en Méditerranée centrale a ainsi produit une nouvelle culture dominante. De la sorte, ces transferts culturels ont durablement transformé une partie des structures et représentations du pouvoir dans cette région.
25/11/2023
Jeux de rois. France et Angleterre à l'heure de l’absolutisme naissant (1610-1642)
Les monarques pré-absolutistes de la première moitié du XVIIe siècle avaient-ils l’appareil diplomatique correspondant à leur politique – c’est-à-dire les moyens de leurs fins – ou la politique de leur appareil diplomatique ? L’objectif principal de cette thèse vise à approfondir nos connaissances sur les relations entre la France et l’Angleterre depuis la mort d’Henri IV en 1610 jusqu’à l’année 1642, marquée à la fois par la disparition de Richelieu et le déclenchement de la révolution sur les îles Britanniques. L’étude de cette période – qui nous paraît être familière tout en restant peu étudiée et globalement perçue au prisme des romans d’Alexandre Dumas – ne se veut pas être un simple récit chronologique et événementielle des interactions politico-diplomatiques franco-anglaises, mais a pour objet d’analyser la structure et le fonctionnement de l’appareil diplomatique des deux états pré-absolutistes ainsi que le jeu de ses représentants, afin d’essayer de comprendre comment l’état des structures administratives et la sociologie des acteurs diplomatiques ont pesé sur le cours des événements politiques entre les deux Couronnes. Ainsi, cette étude s’attachera à mettre en lumière certains traits majeurs de la diplomatie dans la première modernité, telle qu’elle ressort de l’étude des rapports franco-anglais : encore peu structurée sur le plan administratif et donc en retard dans la « modernisation » des instruments de l’État pré-absolutiste, elle est l’outil d’une politique extérieure déjà intense mais protéiforme, qui emprunte plusieurs canaux pas encore exclusifs les uns des autres, mais n’en suit pas moins des codes et des protocoles très précis, dont chaque détail était investi d’un sens politique. La diplomatie peut alors à ce titre être vue comme un ensemble de rituels, une « chorégraphie » politique qui avait ceci de paradoxal que les figures étaient imposées avec une grande précision, sans être pour autant confiées à un appareil administratif structuré. En l’absence de ce dernier, le personnage de l’ambassadeur n’en est que plus central dans la diplomatie, dont il exécute les actes comme les figures d’un ballet ou d’une pièce théâtrale. À cet égard, cette thèse vise également à proposer une étude socio-professionnelle des ambassadeurs dont le but est de cerner la composition du vivier diplomatique dans lequel les monarchies puisaient afin de trouver des candidats, de comprendre comment les futurs représentants se préparaient à exercer leurs fonctions à l’étranger et de mettre en lumière les raisons du recrutement et du choix de tel ou tel homme. Qui plus est, cette étude – comparative par sa nature même – permettra de poser la question de la professionnalisation de l’activité diplomatique, inégale en France et en Angleterre, mais partout inaboutie. Par ailleurs – et c’est là un autre trait que ce travail vise à mettre en exergue – les ambassadeurs n’avaient pas le monopole des relations diplomatiques. Nous montrerons que ces relations étaient aussi le fait d’une multitude d’autres acteurs, peu articulés, de tous rangs et de toute nature, qui, foisonnant entre les deux rives de la Manche, conduisaient des missions tant officielles qu’officieuses et se trouvaient de plus en plus nombreux à jouer un jeu dans les interactions entre les deux Couronnes. Enfin, nous proposerons, dans la lignée des éléments précédents, une lecture renouvelée de certains grands mouvements politiques et stratégiques des années 1610-1642 à la lumière d’une étude structurelle de l’appareil politico-diplomatique, appuyée notamment sur l’exploitation de la correspondance diplomatique et des écrits privés des acteurs. Puiser dans ces fonds, issus des archives tant anglaises que françaises, mais aussi de tierces puissances telles que Venise, permet de s’affranchir de prismes nationaux de lecture des événements, prismes dont l’influence reste prégnante dans toute la période qui nous intéresse.
28/09/2023
Le port de Shanghai, porte maritime de la Chine, 1843-1912
La présente thèse porte sur le développement du port de Shanghai de 1843 à 1912, en se concentrant sur l’histoire des entreprises étrangères installées à Shanghai pendant cette période. À une époque où la Chine promeut son Initiative de la Ceinture et la Route, visant à étendre son influence mondiale en aidant les pays participants à développer leurs infrastructures publiques, notamment portuaires, il est intéressant de réétudier l’histoire du développement du port de Shanghai durant la période concessionnaire. Les concessions étrangères de Shanghai et les entreprises privées établies sur place entre 1843 et 1912 ont joué un rôle essentiel dans la construction du port de cette ville, qui est devenu par la suite un modèle de développement pour les autres villes portuaires chinoises. La ville de Shanghai telle que nous la connaissons aujourd’hui trouve ses fondations durant cette période. Cette thèse essaie de démontrer en quoi les compétitions commerciales des entreprises étrangères présentes à Shanghai ont été le moteur du développement de son port. Elle explore le contexte historique, les étapes clés de la construction du port, l’aménagement et la gestion, ainsi que l’impérialisme occidental et l’émergence d’une conscience nationale chinoise.

Razvan Ioan
DUMITRU
Sous la direction de
04/09/2023
La société des laboureurs. Une prosopographie d'une communauté agraire de Transylvanie à la veille de la modernité
Prise dans le caractère incontournable de l’histoire, la paysannerie d’Europe centrale a participé activement aux grands événements qui définissent cet espace entre la fin de l’époque moderne et le milieu du 20e siècle. Dans la société rurale complexe des laboureurs roumains de Transylvanie, qui fait l’objet de ce travail, le monde extérieur était à la fois un mirage et une expérience banale. Traitée comme des assemblées homogènes, comme des masses unitaires, et souvent représentée par les grands récits historiographiques du siècle passé selon une perspective de lutte des classes, la paysannerie a été maintes fois martyrisée de manière injustifiée. Même quand ce n’était pas le cas, l’intérêt pour le village de Transylvanie restait tributaire de thèmes spécifiques interrogeant le développement des institutions plutôt que celui de la population qui les faisait respecter. S’appuyant sur ces efforts historiographiques antérieurs, les principales questions abordées dans cette recherche visent à savoir qui sont les membres de cette société rurale et ce qui les a poussés à s’adapter et à accepter la nouveauté face aux défis constants de l’histoire. Nécessitant un équilibre permanent entre l’accès aux histoires privées et la connexion de ces histoires aux événements historiques plus importants qui se déroulaient en Transylvanie et en Europe en général, la recherche a adopté une méthodologie plurielle utilisant des registres d’état civil, des journaux et des périodiques, des entretiens d’histoire orale et une série d’ego documents tels que des photographies et des mémoires. Révélateurs d’individualités dont l’acceptation de la tradition s’est construite en accord avec leur desideratum pragmatique, les membres de cette société agraire, qui a dominé le paysage social transylvanien jusqu’au XXe siècle, ont embrassé le changement comme condition de survie, ce qui a donné des réponses originales.
10/07/2023
L’industrie lyonnaise de la soie et la Chine : réalités et limites de l’expansion commerciale des soyeux lyonnais (milieu du XIXe siècle à 1914)
L’industrie de la soie a joué un rôle central dans les échanges commerciaux mondiaux au XIXe siècle. Lyon, capitale historique pour l’industrie de la soie en Europe, constituait aussi l’un des centres commerciaux les plus importants du continent, déjà à l’époque romaine, puis, à nouveau, à partir du XVIe siècle. Au XIXe siècle, Lyon était l’un des centres les plus importants de la soie au monde, en grande partie grâce à ses liens étroits avec la Chine, laquelle était le plus grand fournisseur de matières premières pour la soierie lyonnaise. En même temps, la Chine, où la technique de la fabrication de soie a été découverte sous la dynastie des Shang , est une destination indispensable pour les soyeux lyonnais. En effet, l’ouverture de la Chine au commerce étranger, après la Seconde Guerre de l’Opium, permit aux soyeux lyonnais de s’implanter et de réaliser des opérations de commerce de la soie en Chine. Depuis le XIXe siècle, ces commerces s’intensifient en profitant de l’établissement de concessions françaises en Chine et de la mise en place de la route maritime entre Marseille et Shanghai. Les soyeux lyonnais réussirent à conquérir le marché chinois et ils développaient une stratégie de partenariat avec les négociants locaux pour acquérir des soies grèges directement en Chine et les envoyaient à Lyon sans passer par Londres afin de concurrencer les Britanniques. Puis ce réseau lyonnais travailla avec le plus puissant acteur britannique, qui avait installé des filatures et des ateliers de tissage sur place. Cette stratégie leur permit de devenir des acteurs majeurs du commerce de la soie en Chine et de renforcer leur position sur le marché mondial.
04/07/2023
Le pétrole de l'Afrique subsaharienne : un enjeu stratégique dans la genèse de l'industrie pétrolière publique française (1928-1977)
Au sortir de la Seconde guerre mondiale, la France tire ses leçons de ce conflit. L’énergie est utilisée à des fins géostratégiques et géopolitiques de démonstration de puissance. Les deux grandes guerres mondiales révèlent ainsi, le pétrole comme un objet d’influence, de rapport et de force capable d’octroyer la victoire à quiconque le possède. À cet effet, comme le souligne le Comte de Fels : « La Nation qui n’a pas de pétrole, n’aura plus désormais de marine, d’armée et de crédit, et tombera dans la catégorie humiliée des nations subordonnées (…). Sans pétrole, il n’y a pas de véritable indépendance nationale ! ». C’est ainsi que l’ensemble des États se lancent dans une course effrénée pour l’obtention de cette huile noire par tous les moyens possibles. La France ne possédant pas de réelles potentialités pétrolières sur son territoire, se tourne ainsi vers son immense empire colonial. Le 1er novembre 1954, on assiste à la première découverte pétrolière française commercialement exploitable, dans le Sahara algérien. Malheureusement cette découverte se déroule au moment même où commence la guerre de libération nationale algérienne. Cette découverte pétrolière est utilisée par les Algériens comme outil de chantage dans les négociations entre l’Algérie et la France. Ces négociations aboutissent à une scission au profit d’une indépendance quasi-totale de l’Algérie. Quelques années plus tard, la France fait une importante découverte en Afrique équatoriale française sur l’île d’Ozouri (actuel Port-Gentil) au Gabon. Cette dernière est suivie de plusieurs autres découvertes de gisements pétroliers et gaziers en Afrique centrale, tant au Gabon qu’au Congo-Brazzaville. C’est ainsi que la France fonde ses espoirs dorénavant sur le Gabon. Cette découverte d’or noir permet, non seulement à la France de s’approvisionner en pétrole, mais aussi de pouvoir occuper une place respectable dans le grand concert des nations. Ces découvertes d’hydrocarbures participent, sans équivoque, à la naissance du groupe pétrolier français ELF. L’Afrique centrale en générale, et le Gabon en particulier, constitue un atout important dans la réalisation de la vision d’antan d’un pétrole « franc », et sur le long terme, à celle d’une industrie pétrolière nationale française.
03/07/2023
La Compagnie française de tramways et d’éclairage électriques de Shanghai. De la construction à l’exploitation : performances, stratégies et structures (1901-1961)
En tant que le plus grand opérateur français de services publics dans la première moitié du XXe siècle en Chine, la Compagnie française de tramways et d’éclairage électriques de Shanghai (abrégée CFTE) constitue un cas représentatif qui a réussi à mettre en application le modèle de la concession à l’étranger. L’accord des capitaux franco-belges a permis à l’entreprise de monopoliser dans la Concession française de Shanghai les services parallèles de l’électricité, de l’eau et des transports publics (tramway, trolleybus et autobus). Toutefois, l’opération financière et technique de la CFTE n’a pas été moins mise en épreuve suite à une série d’évènements locaux et mondiaux. Cette thèse vise à étudier les performances de la firme tout au long de son exploitation. En premier lieu, le succès de la CFTE est attribuable au soutien et à la protection des autorités publiques de la Concession française. En second lieu, les stratégies tarifaires et d’adaptation effectuées par la firme deviennent des clés d’aboutir ses bonnes performances. En troisième lieu, la CFTE a pris une politique à la fois coopérative et concurrentielle face à ses homologues chinois et anglo-saxons basés en dehors de sa zone d’influence. Vis-à-vis de son concurrent anglo-saxon faisant preuve d’un caractère « audacieux », la CFTE n’échappe pas à une tendance d’américanisation, ce qui se traduit surtout par l’évolution de son organisation structurelle.

Michael
JOALLAND
Sous la direction de
22/04/2023
Newton et le désenchantement du cosmos: de l’iconoclasme en philosophie naturelle à la fin du XVIIe siècle
Newton laissa à sa mort un manuscrit inédit intitulé “Les Origines philosophiques de la théologie païenne”. Il y soutient que la cosmologie des Anciens était de nature théologique puisqu’elle postulait que les astres étaient de nature divine et que leur mouvement résultait du fait qu’ils étaient dotés d’une âme intrinsèque. Pour Newton, cet animisme astral procédait de la caractérisation dans les corps célestes des esprits des ancêtres de l’humanité déifiés. A ses yeux, la chute de l’homme dans l’astrolâtrie avait corrompu aussi bien la vraie religion que la philosophie naturelle. C’est ainsi qu’il conclut les Principia (1687) : « Les idolâtres s’imaginaient que le soleil, la lune, les astres, les âmes des hommes et toutes les autres parties du monde étaient des parties du Dieu suprême et que, par conséquent, on devait leur rendre un culte, mais c’était une erreur. » Cette thèse vise à examiner les sources du traité des Origines ainsi que la portée qu’il eut sur le reste de l’œuvre de Newton. Il en ressort que l’auteur des Principia entendait désacraliser le cosmos afin de satisfaire les exigences d’un monothéisme austère et intransigeant.
04/04/2023
La perception du Canada dans l'opinion publique anglaise et française dans la première moitié du XVIIIe siècle
Victorieuse de la guerre de Sept Ans, la Grande-Bretagne étend son emprise sur les quatre parties du monde. Pour sa part, la France perd une partie de ses colonies et en ressort endettée. À l’issue de ce conflit, l’équilibre des puissances est précaire et chacun des deux empires doit repenser sa politique impériale. Au cœur de ces enjeux se trouve le Canada, nouvellement cédé à l’Angleterre à la suite de la signature du Traité de Paris (1763). À une époque où les autorités doivent se plier de plus en plus aux débats qui émergent de la sphère publique, il importe de se questionner sur la place qu’occupe le Canada dans l’opinion exprimée à son sujet dans la presse des deux pays belligérants. De plus, il convient d’analyser, par l’intermédiaire des discours écrits dans la presse, comment ils ont su informer les populations européennes sur les enjeux qui concernent le Canada et sa place dans les négociations diplomatiques des deux pays au midi du XVIIIe siècle. Au croisement de l’histoire culturelle, transnationale et impériale, notre projet doctoral s’inscrit dans une large historiographie pour comprendre la place occupée par le Canada dans l’imaginaire colonial des Européens.
13/03/2023
Le crédit et la contrainte. L’emprisonnement pour dette à Paris dans la seconde moitié du XVIIIe siècle
À Paris, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, comme ailleurs dans le royaume ou en Europe, l’essentiel des échanges économiques se fait à crédit. Longtemps analysé à partir de ses aspects positifs et de son rôle dans la dynamique du commerce, le crédit entraîne pourtant de lourdes contraintes. L’emprisonnement pour dette constitue une des réponses au problème du crédit impayé et de la dette non remboursée. Cette thèse propose une relecture des rapports de pouvoir engendrés par la dette à partir de l’analyse de la contrainte par corps, un droit sur le corps de son débiteur offert au créancier par décision de justice. Outre un ensemble varié de sources judiciaires, administratives, et notariales, ce travail se fonde sur l’étude quantitative et qualitative de deux registres d’écrou de prisons parisiennes. Des relations interpersonnelles aux structurations des conditions de l’échange par l’État, des trajectoires carcérales aux acteurs de l’emprisonnement qui les conditionnent, la thèse dessine la pluralité des individus, des institutions et des pratiques qui concourent à la gestion individuelle et collective de l’emprisonnement pour dette. L’analyse des conditions d’obtention et d’exécutions des sentences par corps permet de proposer une histoire de l’emprisonnement pour dette qui sorte du cadre carcéral et envisage le phénomène à l’échelle de la ville et de l’État. Au croisement entre histoire sociale et histoire économique, l’étude retrace les obligations inhérentes aux échanges économiques et éclaire par là les interactions entre droit, justice, et économie.
11/03/2023
Transmissions et cultures familiales. Enquête sur la population de Charleville (1740-1890)
Mettre en évidence l’existence de cultures familiales est le but de cette thèse : les cultures familiales peuvent être définies des pratiques sociales répétées sur plusieurs générations, spécifiques à une famille et révélant un ensemble de valeurs, voire une identité, transmis de parent à enfant. Le terrain d’observation est celui de la population à Charleville, petite ville du nord-est de la France, entre 1740 et 1890, et plus précisément un échantillon de 215 familles reconstruites sur au moins deux générations dans leur descendance masculine comme féminine. La famille est ici comprise comme un ensemble plus vaste que la famille nucléaire, composée du père, de la mère et des enfants : elle comprend également les oncles et tantes ainsi que les cousins. Cet échantillon de population est représentatif de toutes les franges de la société car la sélection a été faite à partir de la première lettre du patronyme de l’époux (B, G, M, N, P, R, et T). Les sources principales utilisées sont les registres paroissiaux et les actes d’état civil, en particulier les actes de mariage. Les indicateurs à partir desquels nous analysons les cultures familiales sont la capacité de signer des conjoints, la transmission de prénoms familiaux, le choix de cousins comme témoins de mariage, l’âge au premier mariage des femmes, les naissances illégitimes ainsi que les mariages entre parents consanguins ou affins (entre le 1er et le 4e degré). Cette méthode révèle des pratiques familiales transgénérationnelles qui varient au sein d’un même milieu économique et social, ce qui permet de rendre compte de l’importance de la notion de culture familiale pour comprendre l’histoire sociale.
2022
10/12/2022
Les deux compagnies de Mousquetaires du roi de France (1622-1815) : corps d’élite, confiance royale et service extraordinaire
Ce travail de recherche a pour ambition d’étudier les deux compagnies de Mousquetaires de la Maison du roi de leur création en 1622 à leur suppression définitive en 1815. La problématique tend à étudier les Mousquetaires sous le prisme de deux approches. Il s’agit tout d’abord de comprendre le fonctionnement d’une des troupes d’élite de l’armée et ses spécificités : en quoi sont-ils singuliers par rapport aux autres corps ? Ensuite, et concomitamment, il est intéressant d’étudier la légende des Mousquetaires en train de se construire en recherchant ses fondements dans le quotidien des hommes qui composaient cette troupe : en quoi tout ce qu’ils firent – officiellement ou non – et ce qu’ils étaient, représente une base à ce mythe et comment tout cela a contribué, par la suite, à ancrer la légende avec l’œuvre d’Alexandre Dumas.
09/12/2022
Histoire d’une liberté dans la France moderne
Cette thèse interroge l’histoire politique des réformés français au début du XVIIe siècle au prisme de la notion de liberté : liberté comme défense des acquis juridiques conférés par le régime de l’édit de Nantes, mais aussi comme capacité d’action. Loin de considérer les huguenots comme les victimes passives d’une « France toute catholique », elle les pense comme des acteurs politiques. Cette capacité d’agir est analysée en deux temps : nous interrogeons d’abord les caractéristiques qui fondent cette liberté d’action dans le contexte du XVIIe siècle, à travers une étude de la place accordée aux institutions, à la mémoire, à l’union et au langage dans leurs pratiques. Nous étudions ensuite la « mise en pratique » de cette liberté politique, en interrogeant les évolutions du parti huguenot, du rapport aux institutions, à la noblesse, aux stratégies langagières à la suite de la mort d’Henri IV. Enfin, nous consacrons une dernière partie à la « mise à mort » de cette culture politique : la fin du parti huguenot, largement documentée, n’est pas le fruit de dissensions internes, mais d’une volonté politique qui cherche à attaquer cette liberté.
02/12/2022
La sexualité légitime comme privilège. Masculinités parisiennes à l’époque moderne (1600-1750).
30/11/2022
LA première guerre mondiale, l'artillerie et l'industrialisation de la guerre
Avant le déclenchement des affrontements armés, l’Artillerie est équipée en cohérence avec une doctrine inadaptée au regard des conflits récents et des possibilités techniques. Lorsque la guerre courte imaginée se mue en une guerre longue offrant la possibilité d’adapter les armements et nécessitant des consommations massives de projectiles, la gouvernance de la fonction de production entre en crise. Une évolution des schémas mentaux s’impose. L’institution d’un Sous-secrétariat d’État de l’artillerie et des munitions constitue une première manifestation de cette transformation. Albert Thomas adapte la gouvernance de la fonction de production des matériels d’artillerie en mettant en place une programmation des besoins, des fabrications et des facteurs de production, une politique industrielle, ainsi que des instruments de pilotage et de contrôle. Cette nouvelle gouvernance constitue le cœur de l’activité gouvernementale de pilotage de l’économie de guerre, mais cette dernière ne s’y limite pas : elle comprend aussi l’administration de toutes les ressources de la nation, qu’il s’agisse de la main-d’œuvre, des matières premières, de l’énergie, des transports ou des capacités d’innovation. Dans le contexte du parlementarisme de guerre, il est loisible d’affirmer que la concrétisation de l’idée d’une guerre industrielle conduit le pays à se doter peu à peu d’un nouveau régime politico – économique. En contrepoint de cette évolution, les entreprises adaptent leurs modes de fonctionnement pour produire en grandes séries ; les Armées industrialisent leurs fonctions de destruction, de protection, de logistique et de restauration des forces.
29/11/2022
Gabriel Hanotaux. Un homme d’État, historien et académicien au service de la nation française (1898-1944)
Ancien ministre des affaires étrangères (1894-1898) et académicien (1897), fervent défenseur de l’unité de la Patrie et de son rayonnement international, Gabriel Hanotaux (1853-1944) a quitté les devants de la scène politique à l’aube du XXe siècle. Au cours de ce demi-siècle de vie, de 1898 à 1944, où les deux premières guerres mondiales ont bouleversé l’équilibre des nations, Hanotaux a participé à l’élaboration de la paix en tant que délégué à la Société des Nations (1920), à la consolidation des liens culturels avec l’Amérique en créant le Comité France Amériques (1909), tout en étant pleinement intégré à l’élite politique et culturelle du pays. Admirateur de Richelieu, homme d’Etat dont il a cherché à suivre les traces, cet académicien contribua à écrire l’Histoire, menant de front analyse des évènements passés et préparation de l’avenir.
26/11/2022
Défendre son territoire, milice et société dans l'Amérique coloniale française, XVIIe - XVIIIee siècles
Cette thèse cherche à définir les milices coloniales de l’empire français à l’époque moderne. Assemblant tous les hommes libres et armés, elles possèdent un rôle militaire central dans la défense des colonies. Avant l’arrivée des troupes réglées à la fin du XVIIe siècle, ces colons-soldats assurent seuls la sûreté des jeunes colonies puis, en appui des armées royales, ils défendent les côtes, les villes ou les frontières dans les guerres de l’espace colonial. Or leurs autres fonctions des milices coloniales ne doivent pas être négligées, notamment l’encadrement des sociétés et des territoires. Le quartier, cadre quotidien du service du milicien, présente, avec d’autres espaces tels les chemins, un enjeu dans le contrôle des colonies. Les fonctions de police et la place des élites, des gens de couleur ou des peuples autochtones dévoilent les liens étroits entre milices et sociétés. Enfin, l’institution des milices interroge le rapport à l’autorité royale et le système impérial notamment à travers l’évolution des cadres législatifs, entre spécificités locales et uniformisation.
Milice, défense, colonie, empire français, territoire, police, élites, gens de couleur et esclaves.
25/11/2022
Les diplomaties plurielles de Côme Ier de Médicis. Les agents florentins et la France à la fin des guerres d’Italie (1537-1559)
Cette thèse porte sur les agents diplomatiques de Côme Ier de Médicis envoyés en France entre 1537 et 1559, dans la seconde partie des guerres d’Italie. En 1530, les Médicis rejoignent l’empereur et deviennent, sous sa tutelle, ducs de Florence, rompant avec la tradition francophile de la cité. Les deux changements, de régime d’une part, d’alliance de l’autre, ont longtemps été considérés comme étant à l’origine d’une rupture absolue des relations en Florence et la France, alors même que la période correspond à celle de l’ascension française de Catherine de Médicis, cousine de Côme. À l’aune d’un large dépouillement des registres de la chancellerie médicéenne, cette thèse rend caduque la doxa historiographique postulant cette rupture. Elle montre comment se construit une projection extérieure dans un espace inamical et dans le contexte d’un renouvellement du personnel politique florentin. Ce travail met en avant la multiplicité des acteurs des relations internationales et des modalités d’envois qui président à leur action. Ces « diplomaties plurielles » permettent à Côme de Médicis d’employer des dizaines d’agents aux statuts variés (espions, ambassadeurs, secrétaires, banquiers ou encore consuls) et de disposer d’une présence quasi continue à la cour de France et auprès des représentants français en Italie. Ainsi, ce cas d’étude permet de rendre compte de toute la complexité d’un modèle social et politique qui pourrait être représentatif de la Renaissance européenne, bien au-delà des seules limites du duché de Florence.
23/11/2022
LE Tuyau de la fonte Mussipotain à la conquête du monde. Pont-à-mousson et sa politique exportatrice (1856-1970)
Créée en 1856 à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle actuelle), la société du même nom (abrégée PAM) se spécialise dans la production de tuyaux en fonte pour l’adduction de l’eau et du gaz. Alors qu’elle doit encore se faire un nom, l’entreprise est confrontée à un marché intérieur contraint. Sa stratégie intègre un recours continu à des ventes hors métropole, à la fois à l’étranger et dans les colonies. La politique exportatrice qu’elle développe est poursuivie tout au long de sa croissance. Devenue un groupe reconnu pour sa gestion financière et son activité à l’international, PAM fusionne avec Saint-Gobain en 1970. L’abondance de ses archives permet d’interroger les raisons et les modalités de son dynamisme à l’exportation. Il s’agit alors de comprendre ce que recouvre cette activité et ce qu’elle implique. En tant qu’axe stratégique, le développement et la place de la politique exportatrice au sein de l’entreprise constituent le premier objet d’analyse. Entre variations du contexte international et critères industriels internes, l’exportation mussipontaine varie selon des facteurs nombreux. L’organisation et les moyens déployés par PAM pour conquérir les marchés hors métropole forment le deuxième volet d’investigation. Le dispositif commercial et les fournitures obtenues sont abordés dans leurs généralités et par l’approfondissement de cas d’étude. À chaque étape, les retombées de la politique exportatrice sont estimées. Les résultats industriels et financiers tendent alors à préfigurer les modalités de son maintien. La place de l’exportation dans l’image et la culture de l’entreprise fait quant à elle figure tant d’incidence que de facteur de continuité.
21/06/2022
Violences et grèves dans les plantations de São Paulo dans la période post-abolition (1888-1930)
Cette thèse traite des grèves et de la violence entre les ouvriers agricoles et les patrons dans les plantations de café à São Paulo, au Brésil, dans la période post-abolition (1888-1930). S’appuyant sur l’histoire sociale et sur une diversité de sources historiques, l’objectif est de démontrer que les ouvriers agricoles n’étaient pas des sujets historiques pacifiques et soumis. Bien que les patrons aient interdit la formation de syndicats, les ouvriers ont pu (re)créer des tactiques de résistance et de lutte individuelle, familiale et collective, où les femmes ont joué un rôle primordial en tant que travailleuses et participantes actives dans la lutte contre les multiples formes d’exploitation auxquelles elles étaient soumises dans les fazendas. C’était pour les ouvriers un moyen de contester les stratégies d’exploitation et de domination que les propriétaires de fazendas, par des mécanismes de contrôle rigides et coercitifs et par une discipline excessive, mettaient en œuvre afin de les contenir dans un modèle idéal de travailleur. La répression violente des grèves par les patrons et la police et les agressions physiques entre ouvriers et patrons révèlent que la violence dans les relations de travail en milieu rural au Brésil était fréquente, ce qui démystifie la thèse du pacifisme et de la soumission des travailleurs ruraux brésiliens.
21/06/2022
Les nobles canadiens sous le régime britannique : réactualiser le « vivre noblement » pour continuer à exister
Entre 1774 et 1815, la noblesse canadienne tente de stabiliser sa position sociale au sein d’une société canadienne qui est désormais sous tutelle britannique. Pour cela, les nobles opèrent une redéfinition culturelle et sociale de leur idée de noblesse afin de s’adapter au nouveau régime.
Grâce aux relations qui s’établissent entre les nobles restés dans l’Empire britannique, ceux l’ayant quitté et les nouvelles élites qui s’établissent dans la colonie au tournant du XIXe siècle, il nous est possible de mieux appréhender la façon dont la noblesse réinvestit son capital symbolique. L’étude des patrimoines matériels, sociaux et intellectuels ainsi que leurs modes de transmission permettront d’examiner les modalités d’adaptation de la communauté noble face aux changements de la période étudiée. Enfin, cette noblesse à cheval entre deux empires, dont les réseaux s’étendent sur de nombreux territoires, permet de mieux percevoir les évolutions qui s’opèrent à cette époque dans les sociétés coloniales et en particulier en Amérique du Nord et au Canada.
14/05/2022
FAMILLES DOMINANTES, Réseaux de fidélité et pouvoir (orvieto, pérouse). xie - Xiie siècle
Les XIe-XIIIe siècles constituent une phrase de reconfiguration tout à fait fondamentale de la société du regnum italicum et de tout l’Occident. C’est dans ce cadre que ce travail s’intéresse aux évolutions des relations de domination et du pouvoir, entendu comme l’aptitude à structurer le champ d’action et de pensée d’autrui. Il analyse également l’ensemble des actions et des techniques déployées par les dominants pour établir, imposer, légitimer et pérenniser leur domination. L’enquête met au centre de l’attention des relations et des réseaux — interpersonnels, économiques, d’information —, ainsi que les rapports dans l’espace et à l’espace. Elle développe notamment le concept de réseau de fidélités, qui rend compte de l’ensemble des liens qu’un puissant peut établir pour influencer de manière contraignante l’action d’autres individus. L’analyse repose sur le dépouillement systématique de toutes les sources écrites et matérielles d’Ombrie et du nord du Latium, ainsi que sur la constitution d’une base de données et d’un SIG. Une attention particulière est consacrée à la seigneurie, dont est établie une définition nouvelle, rendant compte de la diversité de ses formes et de son évolution au cours du temps. Par l’étude précise et circonstanciée du centre de la péninsule italienne, ce travail apporte également de nouveaux éléments à propos de l’incastellamento, de l’évolution des structures familiales, de la tenure et du fief, du concept de féodalité, du développement des communes ou encore à propos du débat entre mutationnisme et antimutationnisme.
14/04/2022
Le Pérou et l’abolition de l’esclavage : circulation des idées émancipatrices et construction de l’État Nation (1788-1854)
À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle prend forme en Europe un mouvement contestataire remettant en cause les bases et pratiques de l’institution esclavagiste qui s’étend jusqu’aux confins des territoires de l’expansion coloniale européenne. Cette révolution des idées va avoir un impact conséquent au niveau mondial, au point d’anéantir le système esclavagiste en l’espace d’un siècle. En suivant la méthode développée par O. Pétré-Grenouilleau, cette thèse propose une étude de l’impact de la révolution abolitionniste au Pérou sur une période qui s’étend de 1788 à 1854. La problématique majeure est d’y étudier les modalités de circulation et de fécondation des idées abolitionnistes au Pérou. Car, les indianos* du Pérou ont eu connaissance de ces thèses très rapidement, à peine un an après que l’A.T.S.S. (The committee for Abolition of the Slave Trade) ne soit constituée. Ainsi, cette révolution abolitionniste génère différentes réactions et commentaires autant critiques qu’élogieux de la part des contemporains du Pérou. La presse, les livres, les pamphlets, les tertulias* et les commentaires constituent les vecteurs privilégiés de la diffusion des idées émancipationnistes*, mais aussi, de la peur d’une révolution Noire au Pérou. Le débat politique sera particulièrement vif au moment des Cortès de Cadix, des guerres indépendantistes de 1810 à 1824, et de la guerre civile du Pérou (1853-1855).
13/03/2022
Les cours des miracles de Paris (1667-1791) : imaginaires, spatialisation et contrôle de la mendicité parisienne
On sait qu’elles ont existé, mais on ne sait pas vraiment ce qu’elles ont été. La Cour des Miracles est un motif littéraire que Victor Hugo a amplement développé dans Notre-Dame de Paris, mais qui fut également l’objet d’une large part de la littérature de la gueuserie des XVIe et XVIIe siècles. Les historiens de la littérature ont étudié cet univers littéraire, notamment à travers l’argot, cette première forme de langage souterrain et codé qui devint rapidement le véhicule des représentations de la pauvreté et de la criminalité. Pourtant, au moment où l’histoire policière, judiciaire et urbaine se développaient, les cours des miracles demeuraient dans l’ombre. Oscillant toujours entre le mythe et la réalité sans qu’aucune recherche ne tente de tisser des liens entre les discours fictionnels et la réalité urbaine et sociale. C’est dans un creux historiographique que s’inscrit cette recherche qui s’articule autour de trois pôles : les représentations sociales, la sûreté et les sociabilités. Il fallait d’abord comprendre le mythe et son enracinement dans la société. Henri Sauval (1623-1676), le premier, décrivait la Cour des Miracles située derrière le couvent des Filles-Dieu, entre les rues Saint-Denis et Neuve-Saint-Sauveur. Endroit fétide, boueux, surpeuplé, réunissant des voleurs, des prostituées et les familles des classes les plus malfamées de la capitale. Il dressait un portrait enraciné dans le Paris de la fin du XVIIe siècle. Cette célèbre Cour des Miracles des Filles-Dieu fut apparemment détruite en 1667, première mission du nouveau lieutenant général de police. Pourtant, des cours des miracles persistaient dans les guides et les plans de la ville jusqu’à la Révolution française témoignant de leur implantation dans le paysage mental et géographique des Parisiens. Mais au-delà du mythe, les cours des miracles sont un problème de sûreté. Espaces de non-droit, les cours des miracles s’inscrivent, par définition, comme des lieux risqués de la capitale et potentiellement surveillés par la police. Si les cours des miracles intègrent le paysage mental des Parisiens, n’intègrent-elles pas, du même coup, celui de la police? C’est dans les documents de la police des mendiants, durant la seconde partie du XVIIIe siècle, qu’il a été possible de chercher les traces des cours des miracles. Les procès-verbaux d’arrestations de mendiants permettent de suivre les pas d’une police spécialisée. Entre organisation territoriale et pratique policière, les cours des miracles des papiers de la police quittent définitivement les culs-de-sac de la ville pour intégrer l’archipel des lieux d’accueil. Enfin, il y avait les habitants de ces cours dont il fallait confronter les réalités aux descriptions fictionnelles. Si les auteurs, comme Henri Sauval, décrivaient les résidents des cours des miracles comme des exclus et des faux mendiants, les mendiants de Paris constituent une catégorie beaucoup plus hétéroclite et beaucoup moins criminelle. Les papiers de la police contiennent bon nombre de pistes pour repenser l’exclusion des mendiants au travers des relations sociales et du travail. De fait, l’exclusion sociale est à reconsidérer alors que la mendicité doit être perçue comme une stratégie de survie qui s’inscrit dans les marchés informels de la ville de Paris.
16/02/2022
Destins d’Osifekunde, né et mis en esclavage au Nigeria, déporté au Brésil, transporté en France, revenu au Brésil et assassiné à Recife (1793-1842)
Pendant les plus de trois cents ans que dura la traite négrière transatlantique, du XVIe au XIXe siècle, plus de douze millions de personnes furent déportées du continent Africain pour servir de main-d’œuvre dans les plantations de canne à sucre, de coton, ainsi que dans les mines “du Nouveau Monde.” On considère que 4.800.000 Africains ont débarqué au Brésil, soit 43 % du total des déportés. Des études plus récentes sur les biographies d’esclaves, retracent les itinéraires individuels des captifs ainsi que leurs démarches pour regagner la liberté. La reconstitution du parcours de ces derniers leur donne de l’humanité, tout en leur restituant leur dignité. Nous nous inspirons de cette méthodologie pour accomplir notre étude doctorale sur la biographie d’Osifekunde, un commerçant issu de l’ethnie Ijebu (du sud-ouest de l’actuel Nigeria), réduit en esclavage au Brésil en 1820 et devenu homme libre en France en 1837. Pour ce faire, nous avons divisé notre étude en six parties et chaque partie est subdivisées en trois chapitres: Dans la première partie nous avons présenté des observations sur les études biographiques en France après les années 1970, notamment sur les biographies d’esclaves, sur l’utilisation de la méthode microhistorique dans ces dernières recherches et les champs de recherche sur les biographies d’esclaves aux États-Unis, au Brésil et en France. Dans une deuxième partie, nous avons essayé de comprendre comment l’intérieur de l’Afrique est devenu le centre d’intérêt des Sociétés Savantes et par conséquent, comment les membres de ces sociétés ont utilisé les témoignages d’esclaves dans leurs études, afin de trouver des endroits très reculés comme la ville de Tombouctou ou la source du fleuve Niger, pour propager l’idée de l’Africain comme « sauvage, antropophage, » ce qui pourrait justifier l’argument civilisateur, utilisé par les européens pour coloniser l’Afrique.
11/02/2022
LE MARQUIS DE BIENCOURT ET LA TERRE d'azay-le-rideau, de la seigneurie au monument historique (1888-1899)
En septembre 1791, après une longue procédure et de nombreuses hésitations en raison du contexte révolutionnaire, le marquis Charles de Biencourt, noble d’extraction, militaire et originaire de la Creuse, député aux états généraux et à la Constituante, signe l’achat de la terre d’Azay-le-Rideau et de son château. À sa suite, la propriété passe entre les mains des trois marquis de Biencourt successifs, Armand-François, Armand-Marie, puis Charles-Marie. Dans la seconde moitié de la période, alors que la grande fortune des héritiers du titre périclite peu à peu et au fur et à mesure des partages inhérents aux héritages, le dernier marquis de Biencourt, veuf et ayant perdu ses deux fils, finit, malgré lui, par se séparer du domaine et du château d’Azay à partir de 1899, après une vente difficile. Au cours de ces quatre générations, les marquis de Biencourt, tout en conservant leur mode de vie pluri-résidentiel, et leur vie parisienne, modifient profondément ce qu’ils appellent encore tout au long de la période « la terre d’Azay ». De ce fait, si l’acquéreur du domaine, en physiocrate averti, choisit un mode de gestion privilégiant le métayage et le faire-valoir direct, ses héritiers successifs, quant à eux, adoptent une gestion qui assoie à la fois la concentration foncière et le déploiement du fermage. Mais c’est aussi le château et son parc que ces hommes décident aussi de transformer. Ainsi, à partir des années 1840, par le choix des rénovations dans un style résolument néo-Renaissance, les marquis de Biencourt ancrent définitivement le château d’Azay-le-Rideau dans le paysage renaissant du Val-de-Loire qui, de fait, est en partie une construction du XIXe siècle.
21/01/2022
Pour l’extirpation de l’hérésie : la violence dans les prédications catholiques du XVIe siècle
Cette thèse se fonde sur une relecture des sermons de François Le Picart, qui fut le grand prédicateur du Paris du premier XVIe siècle, et qui a laissé, grâce à des impressions savantes, un corpus riche de ses prises de parole, permettant d’examiner la genèse de l’imaginaire d’une violence ainsi véhiculée et promue oralement. Le Picart est en effet au cœur de l’histoire de la prédication combattante qui se met en place dès les années 1520-1550 avant d’envahir la sphère publique à partir de 1560. Il est un précurseur qui donne les codes autorisant la progressive maturation d’une tension de violence théophanique dont les hommes devaient être les outils. Par son truchement ; le lecteur peut saisir la puissance des mots qui émanait de la prédication, une autre éloquence de la Renaissance qui visait à mettre en fonctionnement une stratégie d’endoctrinement du peuple catholique à partir du principe d’une mise en défense panique des consciences opérant sur les bases d’une actualisation de la doctrine de l’Église. Dans cette optique, Le Picart accorda une place déterminante à une technique de mise en scène de l’imaginaire de la violence qui reposait sur le recours à des peintures mentales qu’il cherchait à projeter dans la psyché de ses auditeurs. Cette stratégie était un dispositif rhétorique susceptible de susciter, par effet de pathos, une angoisse qui était eschatologique dans la tension inhérente aux sermons opposant dramatiquement l’amour zélé pour Dieu au péché toujours plus croissant de l’homme. Le Picart fut un prophète, qui non seulement parlait pour Dieu et par Dieu mais aussi travaillait l’imaginaire des fidèles en infusant en eux un « parler Dieu », les mettant en condition, après 1560, de devenir des guerriers de Dieu. L’enfer qu’il décrivait comme attendant les hérétiques dans le temps de leur mort allait alors venir sur terre.
2021
10/12/2021
« Au nom du bien public ». Exercer le pouvoir règlementaire dans une société en guerre. Lyon, vers 1561-vers 1594
La ville du XVIe siècle est un entrelacs de responsabilités, d’institutions et de juridictions concurrentes. Gérer une ville est une affaire ardue, d’autant plus lorsque les responsables sont en désaccord sur la manière de le faire et ne sont pas spécialistes de son administration. Pourtant, confrontés aux défis d’une longue guerre civile, de la cohabitation religieuse, des crises économiques et sanitaires qui frappent Lyon au XVIe siècle, les pouvoirs municipaux ont dû inventer de nouvelles manières de gouverner et d’administrer l’espace sur lequel leur juridiction s’étend. Cette dernière s’est considérablement accrue au cours des guerres, profitant de l’éloignement du pouvoir central, mais plus encore profitant, presque par mégarde, des opportunités ouvertes par les circonstances. Au quotidien, assurer le ravitaillement de la ville, la santé publique, garder ses portes et ses murailles pour assurer son intégrité, sont des nécessités mobilisatrices, en même temps que des prises de responsabilités attendues, d’hommes à qui le commandement de la cité a été octroyé par l’élection.
C’est cette gestion quotidienne qu’il convient de cerner, pour comprendre comment il est possible de gouverner une ville aux prises avec les conflits religieux. C’est d’abord par un dialogue fructueux avec la monarchie que les échevins de Lyon assoient leurs pouvoirs : si certains sont au cœur des responsabilités communales depuis sa création au Moyen Âge, telles que la garde ou l’organisation des élections, celles-ci sont rebattues à l’occasion des crises que traverse la ville et se renforcent de nouveaux. Cette augmentation des pouvoirs se double de responsabilités accrues, que les échevins ne désirent pas systématiquement, et qui, indirectement, assurent le rôle régulateur de la monarchie. La progression des officiers royaux dans la composition du consulat dans les années 1570 et 1580 favorise l’apparition d’une culture juridique commune et d’un recours de plus en plus important à l’écrit dans les pratiques quotidiennes du pouvoir. La gestion de l’espace urbain par l’entretien de la voirie et des murailles leur permet de participer à la définition d’un espace public, dont la caractéristique essentielle est d’être catholique et dans lequel se déploie une mise en scène réfléchie du pouvoir municipal. Tantôt s’appuyant sur, tantôt combattant les autres institutions urbaines, ces prétentions sont construites dans des espaces différents, qui ont chacun leurs avantages et sont mobilisés dans le cadre d’une négociation réfléchie, faisant appel à de larges réseaux curiaux mais également interurbains. Ces savoir-faire politiques et administratifs se transmettent au cours des années : une véritable accumulation d’expérience règlementaire se dessine à mesure que le consulat se dote d’outils et d’experts chargés de justifier ces pouvoirs et de fabriquer à la fois du droit et des technologies de gouvernement adaptées. La Ligue dès lors, malgré ses ambiguïtés, semble être une acmè dans cette autonomie, autant voulue que subie, du pouvoir municipal : le retour de Lyon sous l’autorité royale est en ce sens une rupture majeure, qui, si elle réorganise les institutions en profondeur, ne remet pourtant pas en cause la transmission des dispositifs règlementaires visant à assurer le bien public.
04/12/2021
« où l'on offre tout ce qui peut se vendre ». niveaux de vie et consommation à rouen dans la seconde moitié du xve siècle.
Cette thèse analyse les niveaux de vie et la consommation de la population rouennaise à la fin du Moyen Âge (du milieu du XVe siècle au début du XVIe siècle). Il s’agit de s’interroger sur la possibilité d’estimer les niveaux de vie et détailler les consommations urbaines d’une des principales villes du royaume de France. Cette réflexion se fonde sur la richesse et la diversité des sources rouennaises, à la fois textuelles, iconographiques et archéologiques. Les comptabilités sont le support principal de cette étude. Elles font l’objet d’une analyse sur leur contexte de production et sur leur élaboration. Leur dépouillement minutieux permet de cerner finement la fabrique économique et sociale des niveaux de vie. La réflexion menée autour de l’établissement d’un « panier de consommation » souligne que la mise en regard des salaires et des dépenses alimentaires est indispensable, mais insuffisante, pour saisir le pouvoir d’achat. Tous les paramètres de la vie quotidienne – alimentation, ustensiles de cuisine, loyer, combustibles, éclairage, meubles, vêtement ou coût du travail – sont successivement examinés et détaillés pour proposer des premières estimations des niveaux de vie. La richesse des sources offre également l’opportunité de saisir dans le détail certaines pratiques économiques : réparation, recyclage, location, aumônes… La quantification des consommations n’est pas le seul volet à prendre en considération pour définir les niveaux de vie. La culture matérielle des groupes sociaux tout comme leur présence dans l’espace public – par le vêtement par exemple – en sont également des marqueurs.
Christophe
FURON
Sous la direction de

Jean-Marie Moeglin
Sorbonne Université
04/12/2021
Servir le roi par les armes : La Hire et Poton de Xaintrailles, capitaines de Charles VII
La thèse reconstitue la carrière d’Etienne de Vignoles, dit La Hire (le valet de coeur du jeu de carte), et Poton de Xaintrailles. Ces petits capitaines gascons font leur apparition dans l’histoire en 1418 : au service du dauphin Charles, le futur Charles VII, ils mènent alors une guerre d’escarmouches et de coups de main qui font leur renommée. A partir de ce moment, ils sont de presque tous les principaux faits d’armes du règne, combattant par exemple aux côtés de Jeanne d’Arc et servant le roi jusqu’à leur mort (1443 pour La Hire, 1461 pour Poton). Ils acquièrent ainsi terres, titres et offices (Poton devient maréchal en 1454).
La thèse analyse également leur activité d’entrepreneurs de guerre. L’étude de leurs réseaux, de leur gestion des compagnies placées sous leurs ordres et de la dimension économique de leur activité montre que la prééminence de ces deux capitaines dans la société militaire de leur temps n’est pas uniquement due à leurs talents militaires.
La thèse s’attache également à étudier les ressorts de leur renommée et leur image à travers les siècles, jusqu’à aujourd’hui.
Elle tente ainsi d’offrir un éclairage nouveau sur la société militaire sous Charles VII.
C’est cette gestion quotidienne qu’il convient de cerner, pour comprendre comment il est possible de gouverner une ville aux prises avec les conflits religieux. C’est d’abord par un dialogue fructueux avec la monarchie que les échevins de Lyon assoient leurs pouvoirs : si certains sont au cœur des responsabilités communales depuis sa création au Moyen Âge, telles que la garde ou l’organisation des élections, celles-ci sont rebattues à l’occasion des crises que traverse la ville et se renforcent de nouveaux. Cette augmentation des pouvoirs se double de responsabilités accrues, que les échevins ne désirent pas systématiquement, et qui, indirectement, assurent le rôle régulateur de la monarchie. La progression des officiers royaux dans la composition du consulat dans les années 1570 et 1580 favorise l’apparition d’une culture juridique commune et d’un recours de plus en plus important à l’écrit dans les pratiques quotidiennes du pouvoir. La gestion de l’espace urbain par l’entretien de la voirie et des murailles leur permet de participer à la définition d’un espace public, dont la caractéristique essentielle est d’être catholique et dans lequel se déploie une mise en scène réfléchie du pouvoir municipal. Tantôt s’appuyant sur, tantôt combattant les autres institutions urbaines, ces prétentions sont construites dans des espaces différents, qui ont chacun leurs avantages et sont mobilisés dans le cadre d’une négociation réfléchie, faisant appel à de larges réseaux curiaux mais également interurbains. Ces savoir-faire politiques et administratifs se transmettent au cours des années : une véritable accumulation d’expérience règlementaire se dessine à mesure que le consulat se dote d’outils et d’experts chargés de justifier ces pouvoirs et de fabriquer à la fois du droit et des technologies de gouvernement adaptées. La Ligue dès lors, malgré ses ambiguïtés, semble être une acmè dans cette autonomie, autant voulue que subie, du pouvoir municipal : le retour de Lyon sous l’autorité royale est en ce sens une rupture majeure, qui, si elle réorganise les institutions en profondeur, ne remet pourtant pas en cause la transmission des dispositifs règlementaires visant à assurer le bien public.
27/11/2021
Devenir prince. James Stuart, réseaux européens et ambitions britanniques (1660-1685)
La thèse d’Emmanuel Lemée étudie la construction concrète du pouvoir d’un prince européen et cherche à mettre en lumière la dimension informelle du pouvoir princier dans les cours et les sociétés d’Europe de l’ouest, à travers le cas du frère de Charles II d’Angleterre, James Stuart. Pour ce faire, la thèse d’Emmanuel Lemée étudie aussi bien l’action politique de James Stuart, et notamment son implication croissante au cours du règne de son frère dans les affaires diplomatiques, que son entourage et sa très nombreuse clientèle. À travers l’étude des relations de ce prince avec ses contemporains, ce travail de recherche s’efforce également de mieux cerner l’impact que pouvaient avoir les fréquentations d’un homme de pouvoir sur son action et son image, notamment les contraintes qu’impliquaient pour un patron la nécessité de ne pas perdre sa crédibilité aux yeux de ses clients. Ce travail de recherche contribue à faire émerger de nouvelles pistes d’explication et d’analyse pour comprendre la dégradation de l’image de James Stuart dans l’opinion britannique, qui joua un grand rôle dans sa perte du pouvoir lors de la Glorieuse Révolution de 1688.
C’est cette gestion quotidienne qu’il convient de cerner, pour comprendre comment il est possible de gouverner une ville aux prises avec les conflits religieux. C’est d’abord par un dialogue fructueux avec la monarchie que les échevins de Lyon assoient leurs pouvoirs : si certains sont au cœur des responsabilités communales depuis sa création au Moyen Âge, telles que la garde ou l’organisation des élections, celles-ci sont rebattues à l’occasion des crises que traverse la ville et se renforcent de nouveaux. Cette augmentation des pouvoirs se double de responsabilités accrues, que les échevins ne désirent pas systématiquement, et qui, indirectement, assurent le rôle régulateur de la monarchie. La progression des officiers royaux dans la composition du consulat dans les années 1570 et 1580 favorise l’apparition d’une culture juridique commune et d’un recours de plus en plus important à l’écrit dans les pratiques quotidiennes du pouvoir. La gestion de l’espace urbain par l’entretien de la voirie et des murailles leur permet de participer à la définition d’un espace public, dont la caractéristique essentielle est d’être catholique et dans lequel se déploie une mise en scène réfléchie du pouvoir municipal. Tantôt s’appuyant sur, tantôt combattant les autres institutions urbaines, ces prétentions sont construites dans des espaces différents, qui ont chacun leurs avantages et sont mobilisés dans le cadre d’une négociation réfléchie, faisant appel à de larges réseaux curiaux mais également interurbains. Ces savoir-faire politiques et administratifs se transmettent au cours des années : une véritable accumulation d’expérience règlementaire se dessine à mesure que le consulat se dote d’outils et d’experts chargés de justifier ces pouvoirs et de fabriquer à la fois du droit et des technologies de gouvernement adaptées. La Ligue dès lors, malgré ses ambiguïtés, semble être une acmè dans cette autonomie, autant voulue que subie, du pouvoir municipal : le retour de Lyon sous l’autorité royale est en ce sens une rupture majeure, qui, si elle réorganise les institutions en profondeur, ne remet pourtant pas en cause la transmission des dispositifs règlementaires visant à assurer le bien public.
27/11/2021
Léguer sans fils. Hériter sans père. Transmission et légitimation du pouvoir chez les cardinaux au Quattrocento
Les cardinaux se conforment de plus en plus au Quattrocento à un mode de vie princier, dans lequel l’hérédité est la norme. Ils accumulent dans le même mouvement toujours plus de pouvoirs et de biens qu’ils parviennent à extraire de l’Église. Toutefois, le patrimoine matériel et immatériel qu’ils se constituent est principalement composé de biens de l’Église qui sont en théorie inaliénables. Dans le même temps, ils sont soumis au célibat ecclésiastique qui leur interdit de transmettre ces biens et ces pouvoirs à d’éventuels enfants. Face à cette tension, les sénateurs de l’Église parviennent à contourner la norme : ils héritent bien souvent de la pourpre et de biens d’origine ecclésiastique d’un de leurs parents et parviennent à les léguer à certains membres de leur famille qui ne sont pas leurs enfants. Des stratégies élaborés et différenciés de transmission se mettent alors en place. À l’inverse, les aspirants à la barrette et les nouveaux venus dans le Sacré Collège s’appuient, lorsqu’ils en ont l’occasion, sur les relations de parenté qui les unissent à d’anciens cardinaux pour légitimer leur position sociale. Bien loin d’être mise en accusation, la parenté qui unit les détenteurs de la pourpre de la fin du Moyen Âge est au contraire valorisée. Ces successions de cardinaux appartenant à la même famille aboutissent à la création de dynasties cardinalices qui se multiplient dans le Sacré Collège de la seconde moitié du XVe et du début du XVIe siècle. La figure du cardinal lignager, caractéristique de la Renaissance, connaît alors son apogée avant de s’éclipser largement avec la réforme tridentine.
20/11/2021
Les parfumeurs et la cour de France, de Louis XIV à Louis XVI : analyse sociale, culturelle et technique d'un métier
Cette thèse a pour objet l’étude des parfumeurs qui fournissaient la cour de Versailles de Louis XIV à Louis XVI. A partir du XVIIe siècle, le métier de parfumeur se constitue en un artisanat indépendant. Les gantiers s’emparent de ce savoir-faire et parviennent à s’en arroger le monopole. Dès lors, les gantiers-parfumeurs fabriquent les gants parfumés, dont le succès est à son apogée à la cour de Louis XIV, les eaux de senteur et tous les cosmétiques. Ces produits font l’objet d’une consommation importante parmi les courtisans qui se conforment à une certaine apparence pour répondre aux critères du paraître curial. Ces recherches se placent dans le cadre d’une histoire socio-culturelle en analysant ces artisans dans une vision globale comprenant le métier lui-même, mais également l’environnement social et culturel. La mise en valeur des réseaux sociaux dans lesquels ces hommes s’insèrent permet de dégager ceux qui ont été les plus influents. Parmi eux, la dynastie des Huet, qui a fourni la famille royale et la cour sur quatre générations, représente un modèle de réussite artisanale familiale. Les recherches viseront également à cerner le profil culturel de ces individus.
C’est cette gestion quotidienne qu’il convient de cerner, pour comprendre comment il est possible de gouverner une ville aux prises avec les conflits religieux. C’est d’abord par un dialogue fructueux avec la monarchie que les échevins de Lyon assoient leurs pouvoirs : si certains sont au cœur des responsabilités communales depuis sa création au Moyen Âge, telles que la garde ou l’organisation des élections, celles-ci sont rebattues à l’occasion des crises que traverse la ville et se renforcent de nouveaux. Cette augmentation des pouvoirs se double de responsabilités accrues, que les échevins ne désirent pas systématiquement, et qui, indirectement, assurent le rôle régulateur de la monarchie. La progression des officiers royaux dans la composition du consulat dans les années 1570 et 1580 favorise l’apparition d’une culture juridique commune et d’un recours de plus en plus important à l’écrit dans les pratiques quotidiennes du pouvoir. La gestion de l’espace urbain par l’entretien de la voirie et des murailles leur permet de participer à la définition d’un espace public, dont la caractéristique essentielle est d’être catholique et dans lequel se déploie une mise en scène réfléchie du pouvoir municipal. Tantôt s’appuyant sur, tantôt combattant les autres institutions urbaines, ces prétentions sont construites dans des espaces différents, qui ont chacun leurs avantages et sont mobilisés dans le cadre d’une négociation réfléchie, faisant appel à de larges réseaux curiaux mais également interurbains. Ces savoir-faire politiques et administratifs se transmettent au cours des années : une véritable accumulation d’expérience règlementaire se dessine à mesure que le consulat se dote d’outils et d’experts chargés de justifier ces pouvoirs et de fabriquer à la fois du droit et des technologies de gouvernement adaptées. La Ligue dès lors, malgré ses ambiguïtés, semble être une acmè dans cette autonomie, autant voulue que subie, du pouvoir municipal : le retour de Lyon sous l’autorité royale est en ce sens une rupture majeure, qui, si elle réorganise les institutions en profondeur, ne remet pourtant pas en cause la transmission des dispositifs règlementaires visant à assurer le bien public.
Tom
SADLER
Sous la direction de

Jean-Marie Moeglin
Sorbonne Université
29/10/2021
Les armées de la Maison des comtes de Luxembourg. Guerres, société, espaces (XIIIe – première moitié du XIVe siècle)
A partir du XIIIe siècle, la Maison des comtes de Luxembourg connaît une ascension fulgurante. En 1346, Charles IV, fils de Jean, cumule les dignités de ses prédécesseurs : comte de Luxembourg, roi de Bohême, roi des Romains et empereur. L’armée accompagne cette évolution. A travers l’étude des armées, des guerres, de la conduite de la guerre, mais aussi des relations diplomatiques des Luxembourg nous cherchons à mettre en lumière des armées comme phénomène dynamique qui est révélateur des transformations qui affectent la politique de la Maison de Luxembourg. Notons que la Maison de Luxembourg n’est pas qu’une maison comtale. Elle est par moment royale et impériale. A cause du cumul des diverses dignités plusieurs espaces géographiques doivent être considérés : le comté de Luxembourg, l’Italie du Nord, le royaume de Bohême, la Silésie, le Tyrol, le Brandebourg, le royaume de France ou encore la Lituanie. L’ascension politico-sociale des Luxembourg permet de bien mettre en lumière la pluralité ou diversité dans la guerre comme dans l’armée. Les armées et les guerres sont à la fois le produit des transformations et mutations qui s’imposent aux Luxembourg et la cause comme l’accélérateur de l’évolution constatée. En apportant non seulement un soutien réel et matériel, mais aussi immatériel, les armées permettent à la maison comtale d’être éligible à la dignité impériale et contribuent ainsi au cheminement de la maison comtale vers la maison royale et impériale. Par leur interdépendance avec la société, les armées influent sur cette dernière. Guerre et société, liées par le lien étroit de l’économie, se façonnent mutuellement, donnant naissance à un embryon d’État moderne.
15/09/2021
présence de la chine aux expositions universelles françaises de 1855 à 1937
À leur apogée, les Expositions universelles ou internationales, marques des processus de mondialisation et de modernisation, ne manquaient pas une participation chinoise de multi-forme et multi-niveau dans le principal pays organisateur, la France. L’étude de la présence chinoise suit chronologiquement ces grandes manifestations déroulées à Paris, cas par cas, durant près d’un siècle. Les représentations traitées évoluaient avec le temps, selon le contexte international, la relation franco-chinoise et le régime politique. La question d’éclairer les faits et de préciser les limites de la place de ce pays aux Expositions universelles françaises se situe à l’origine de la présente étude. À la fin de la dynastie, des Douanes maritimes impériales sous la direction des étrangers influençaient fortement les procédures d’organisation. Témoins de la mutation de la vie économique, des pavillons nationaux à Paris dévoilaient tant le déséquilibre de la répartition géographique de commerce que la disparité de la structure industrielle dans ce pays. De manière parallèle, des manifestations culturelles et artistiques présentaient une continuité survivant aux changements. De plus, l’analyse de ces participations permet d’examiner l’éventuelle capacité de se présenter sur l’échiquier international, ainsi que d’évaluer de premiers efforts d’industrialisation chinoise. Cette thèse a pour ambition de dresser un bilan des participations chinoises en France, afin de contribuer à l’un des aspects de l’histoire des expositions de la Chine moderne.
06/07/2021
La question indochinoise entre la france et la république populaire de chine de 1954 à 1964
Cette thèse traite principalement des relations sino-françaises autour de la question indochinoise, le rôle d’Indochine dans les relations sino-françaises et l’influence de la Guerre froide sur ces questions entre 1954 et 1964. Pendant la guerre d’Indochine, la France et la Chine se trouvent en opposition en Indochine en raison du soutien chinois au Vietminh et de la situation tendue de la Guerre froide. À partir de 1953, la Chine et la France ont des souhaits communs de régler des conflits indochinois par voie de négociation. Ainsi, pendant la conférence de Genève de 1954, la Chine et la France ont un certain nombre de contacts et réalisent des collaborations en vue de mettre fin à la guerre d’Indochine. Après la guerre d’Indochine, la Chine poursuit la ligne politique de dissocier l’alliance occidentale. Elle tente de développer ses relations avec la France et d’obtenir le soutien français dans l’application des accords de Genève. Cependant, la politique extérieure de la IVe République française n’est pas indépendante des États-Unis. Les deux pays manquent donc une occasion de normalisation de leurs relations et de collaboration dans l’application des accords de Genève. Après son arrivée au pourvoir, Charles de Gaulle poursuit une France indépendante et puissante. La divergence franco-américaine à propos de l’Indochine devient aiguë. Des contacts pendant la conférence de Genève sur le Laos entre 1961 et 1962 ont une influence positive sur les relations sino-françaises. Avec pour l’un des objectifs d’obtenir la coopération de la Chine sur la question indochinoise, De Gaulle décide de reconnaître la Chine en janvier 1964. Cependant, même si certaines coopérations réalisées entre la France et la Chine sur le Laos après l’établissement des relations diplomatiques, une conférence internationale sur toute Indochine espérée par De Gaulle n’est pas réalisée.
18/06/2021
Les polices du corps féminin : constructions politico-religieuses de la virginité et de la maternité entre Renaissance et Réforme, 1488-1589 (France et espace romand)
Dans les discours du XVIe siècle, les femmes, dans leur nature jugée faible et facilement tournée vers le vice, sont considérées avoir le pouvoir de mettre en péril la société dans son ensemble. Cette problématique a d’autant plus d’implications pendant les années des conflits confessionnels. C’est pourquoi une volonté se lit dans les textes prescriptifs de « policer » le corps des femmes et de le rendre le plus exemplaire possible, afin que cette exemplarité, dans leurs pratiques, se répercute ensuite sur le corps social. La lecture des sources retenues – recoupant entre autres des manuels de comportements, des sermons ainsi que des traités moraux et des sources littéraires – permet d’appréhender la manière dont les divers auteurs, humanistes, catholiques ou réformés, cherchent à modeler le corps des jeunes filles, des épouses et des mères. Cela, au travers d’une instruction qui se perpétue au long de l’existence, et qui concerne tant l’esprit, les mouvements, les apparences, l’habillement, la posture, ou encore le corps dans sa puissance maternelle. En parallèle, des textes écrits par des femmes ou mettant en scène des femmes, témoignent de leur agentivité et d’une affirmation de soi qui s’éloigne parfois du portrait idéalisé et policé mis en avant par les discours normatifs dominants.
29/05/2021
Michel Hurault de L’Hospital 1559 –1592 : Recherches historiques sur la vie et la pensée du petit-fils du Chancelier de France Michel de L’Hospital
Voici le fructueux parcours oublié depuis des siècles de Michel Hurault de L’Hospital au cœur des guerres de Religion. Issu de l’importante famille Hurault, instruit par son illustre grand-père maternel Michel de L’Hospital, celui-ci le distinguait d’entre ses petits-enfants pour ses évidentes prédispositions.La thèse explore le contexte familial, fratrie, alliances, amitiés, rivalités et clientèle, les aspects intellectuels, juridiques, politiques, religieux (Hurault était huguenot) de la carrière et l’œuvre de ce fidèle à Henri III. Jeune parlementaire il devint serviteur, compagnon d’Henri de Navarre, diplomate, chancelier de Navarre, homme de guerre d’Henri IV avant de périr d’une mort « estrange ».Bien avant le sacre d’Henri et l’Edit de Nantes, Hurault avait formulé diverses propositions d’apaisement. Par ses écrits et ses actions il défendait l’application de la loi salique contre le duc de Guise, la Ligue et l’Espagne, la liberté religieuse, l’idée supérieure du service de l’Etat, l’indépendance et la grandeur du royaume unifié autour de son roi légitime : Henri IV.Angleterre, Allemagne, Hollande, son rayonnement dépassait les frontières. En son temps Hurault impressionnait par son ardente implication éclairée par son regard singulièrement pénétrant sur les forces contraires qui déchiraient la France. Sa vision précise, rationnelle que l’Histoire confirma ultérieurement, le conduisait dans ses recommandations pour écarter les périls et rétablir le royaume.Apparaissent alors les spécificités et l’apport de ce personnage lettré et courageux. Son énergie, ses combats prouvent sa foi et son amour de la France qu’il appelait : « ma patrie, ma première mère. »
C’est cette gestion quotidienne qu’il convient de cerner, pour comprendre comment il est possible de gouverner une ville aux prises avec les conflits religieux. C’est d’abord par un dialogue fructueux avec la monarchie que les échevins de Lyon assoient leurs pouvoirs : si certains sont au cœur des responsabilités communales depuis sa création au Moyen Âge, telles que la garde ou l’organisation des élections, celles-ci sont rebattues à l’occasion des crises que traverse la ville et se renforcent de nouveaux. Cette augmentation des pouvoirs se double de responsabilités accrues, que les échevins ne désirent pas systématiquement, et qui, indirectement, assurent le rôle régulateur de la monarchie. La progression des officiers royaux dans la composition du consulat dans les années 1570 et 1580 favorise l’apparition d’une culture juridique commune et d’un recours de plus en plus important à l’écrit dans les pratiques quotidiennes du pouvoir. La gestion de l’espace urbain par l’entretien de la voirie et des murailles leur permet de participer à la définition d’un espace public, dont la caractéristique essentielle est d’être catholique et dans lequel se déploie une mise en scène réfléchie du pouvoir municipal. Tantôt s’appuyant sur, tantôt combattant les autres institutions urbaines, ces prétentions sont construites dans des espaces différents, qui ont chacun leurs avantages et sont mobilisés dans le cadre d’une négociation réfléchie, faisant appel à de larges réseaux curiaux mais également interurbains. Ces savoir-faire politiques et administratifs se transmettent au cours des années : une véritable accumulation d’expérience règlementaire se dessine à mesure que le consulat se dote d’outils et d’experts chargés de justifier ces pouvoirs et de fabriquer à la fois du droit et des technologies de gouvernement adaptées. La Ligue dès lors, malgré ses ambiguïtés, semble être une acmè dans cette autonomie, autant voulue que subie, du pouvoir municipal : le retour de Lyon sous l’autorité royale est en ce sens une rupture majeure, qui, si elle réorganise les institutions en profondeur, ne remet pourtant pas en cause la transmission des dispositifs règlementaires visant à assurer le bien public.
15/01/2021
L'industrie automobile française et la Russie de 1954 à 2014.
La thèse étudie les activités des entreprises automobiles françaises en Russie dans les années 1954 – 2014. Elle couvre deux périodes bien distinctes : soviétique et post-soviétique et montre une continuité́ dans la stratégie des constructeurs automobiles français sur le marché russe. L’étude couvre la coopération franco-russe dans le domaine automobile sous le prisme des relations tant économiques et politiques que technologiques entre les pays. Cette coopération résulte d’une volonté́ bilatérale de la part de la France et de l’Union soviétique d’élargir les champs de leur coopération et de s’engager dans des projets industriels à long terme. Il est possible ainsi de mettre en lumière l’importance du transfert de technologies réalisé dans le cadre des projets automobiles franco-russes. L’analyse du marché automobile russe permet de mesurer le rôle de la France dans le développement de l’industrie automobile soviétique puis russe.
2017-2020
2020
2019
Adrien PITOR, L'espace du Palais : Etude d'un enclos judiciaire parisien de 1670 à 1790, sous la direction de Reynald Abad, soutenue le 16 novembre 2019.
Site dédié : https://crm-umr8596.huma-num.fr/omeka-s/s/apitor/page/palais_accueil
2018
2017
Raphaël CHERIAU, « L’intervention d’humanité » ou le droit d’ingérence pour raisons humanitaires dans les relations internationales : Zanzibar, le Royaume-Uni et la France, entre expansion coloniale et lutte contre la traite du milieu du XIXe siècle au début des années 1900, sous la direction d'Olivier Grenouilleau, soutenue le 1 juin 2017.