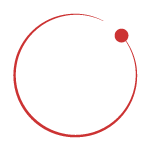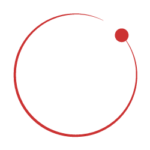Soutenances
de thèses et HDR
Soutenances
de thèses et HDR
Texte
Soutenances de thèses
Texte ?
2023
22/04/2023
Newton et le désenchantement du cosmos: de l’iconoclasme en philosophie naturelle à la fin du XVIIe siècle
Newton laissa à sa mort un manuscrit inédit intitulé “Les Origines philosophiques de la théologie païenne”. Il y soutient que la cosmologie des Anciens était de nature théologique puisqu’elle postulait que les astres étaient de nature divine et que leur mouvement résultait du fait qu’ils étaient dotés d’une âme intrinsèque. Pour Newton, cet animisme astral procédait de la caractérisation dans les corps célestes des esprits des ancêtres de l’humanité déifiés. A ses yeux, la chute de l’homme dans l’astrolâtrie avait corrompu aussi bien la vraie religion que la philosophie naturelle. C’est ainsi qu’il conclut les Principia (1687) : « Les idolâtres s’imaginaient que le soleil, la lune, les astres, les âmes des hommes et toutes les autres parties du monde étaient des parties du Dieu suprême et que, par conséquent, on devait leur rendre un culte, mais c’était une erreur. » Cette thèse vise à examiner les sources du traité des Origines ainsi que la portée qu’il eut sur le reste de l’œuvre de Newton. Il en ressort que l’auteur des Principia entendait désacraliser le cosmos afin de satisfaire les exigences d’un monothéisme austère et intransigeant.
11/03/2023
Transmissions et cultures familiales. Enquête sur la population de Charleville (1740-1890)
Mettre en évidence l’existence de cultures familiales est le but de cette thèse : les cultures familiales peuvent être définies des pratiques sociales répétées sur plusieurs générations, spécifiques à une famille et révélant un ensemble de valeurs, voire une identité, transmis de parent à enfant. Le terrain d’observation est celui de la population à Charleville, petite ville du nord-est de la France, entre 1740 et 1890, et plus précisément un échantillon de 215 familles reconstruites sur au moins deux générations dans leur descendance masculine comme féminine. La famille est ici comprise comme un ensemble plus vaste que la famille nucléaire, composée du père, de la mère et des enfants : elle comprend également les oncles et tantes ainsi que les cousins. Cet échantillon de population est représentatif de toutes les franges de la société car la sélection a été faite à partir de la première lettre du patronyme de l’époux (B, G, M, N, P, R, et T). Les sources principales utilisées sont les registres paroissiaux et les actes d’état civil, en particulier les actes de mariage. Les indicateurs à partir desquels nous analysons les cultures familiales sont la capacité de signer des conjoints, la transmission de prénoms familiaux, le choix de cousins comme témoins de mariage, l’âge au premier mariage des femmes, les naissances illégitimes ainsi que les mariages entre parents consanguins ou affins (entre le 1er et le 4e degré). Cette méthode révèle des pratiques familiales transgénérationnelles qui varient au sein d’un même milieu économique et social, ce qui permet de rendre compte de l’importance de la notion de culture familiale pour comprendre l’histoire sociale.
2022
10/12/2022
Les deux compagnies de Mousquetaires du roi de France (1622-1815) : corps d’élite, confiance royale et service extraordinaire
Ce travail de recherche a pour ambition d’étudier les deux compagnies de Mousquetaires de la Maison du roi de leur création en 1622 à leur suppression définitive en 1815. La problématique tend à étudier les Mousquetaires sous le prisme de deux approches. Il s’agit tout d’abord de comprendre le fonctionnement d’une des troupes d’élite de l’armée et ses spécificités : en quoi sont-ils singuliers par rapport aux autres corps ? Ensuite, et concomitamment, il est intéressant d’étudier la légende des Mousquetaires en train de se construire en recherchant ses fondements dans le quotidien des hommes qui composaient cette troupe : en quoi tout ce qu’ils firent – officiellement ou non – et ce qu’ils étaient, représente une base à ce mythe et comment tout cela a contribué, par la suite, à ancrer la légende avec l’œuvre d’Alexandre Dumas.
09/12/2022
Histoire d’une liberté dans la France moderne
Cette thèse interroge l’histoire politique des réformés français au début du XVIIe siècle au prisme de la notion de liberté : liberté comme défense des acquis juridiques conférés par le régime de l’édit de Nantes, mais aussi comme capacité d’action. Loin de considérer les huguenots comme les victimes passives d’une « France toute catholique », elle les pense comme des acteurs politiques. Cette capacité d’agir est analysée en deux temps : nous interrogeons d’abord les caractéristiques qui fondent cette liberté d’action dans le contexte du XVIIe siècle, à travers une étude de la place accordée aux institutions, à la mémoire, à l’union et au langage dans leurs pratiques. Nous étudions ensuite la « mise en pratique » de cette liberté politique, en interrogeant les évolutions du parti huguenot, du rapport aux institutions, à la noblesse, aux stratégies langagières à la suite de la mort d’Henri IV. Enfin, nous consacrons une dernière partie à la « mise à mort » de cette culture politique : la fin du parti huguenot, largement documentée, n’est pas le fruit de dissensions internes, mais d’une volonté politique qui cherche à attaquer cette liberté.
02/12/2022
La sexualité légitime comme privilège. Masculinités parisiennes à l’époque moderne (1600-1750).
30/11/2022
LA première guerre mondiale, l'artillerie et l'industrialisation de la guerre
Avant le déclenchement des affrontements armés, l’Artillerie est équipée en cohérence avec une doctrine inadaptée au regard des conflits récents et des possibilités techniques. Lorsque la guerre courte imaginée se mue en une guerre longue offrant la possibilité d’adapter les armements et nécessitant des consommations massives de projectiles, la gouvernance de la fonction de production entre en crise. Une évolution des schémas mentaux s’impose. L’institution d’un Sous-secrétariat d’État de l’artillerie et des munitions constitue une première manifestation de cette transformation. Albert Thomas adapte la gouvernance de la fonction de production des matériels d’artillerie en mettant en place une programmation des besoins, des fabrications et des facteurs de production, une politique industrielle, ainsi que des instruments de pilotage et de contrôle. Cette nouvelle gouvernance constitue le cœur de l’activité gouvernementale de pilotage de l’économie de guerre, mais cette dernière ne s’y limite pas : elle comprend aussi l’administration de toutes les ressources de la nation, qu’il s’agisse de la main-d’œuvre, des matières premières, de l’énergie, des transports ou des capacités d’innovation. Dans le contexte du parlementarisme de guerre, il est loisible d’affirmer que la concrétisation de l’idée d’une guerre industrielle conduit le pays à se doter peu à peu d’un nouveau régime politico – économique. En contrepoint de cette évolution, les entreprises adaptent leurs modes de fonctionnement pour produire en grandes séries ; les Armées industrialisent leurs fonctions de destruction, de protection, de logistique et de restauration des forces.
29/11/2022
Gabriel Hanotaux. Un homme d’État, historien et académicien au service de la nation française (1898-1944)
Ancien ministre des affaires étrangères (1894-1898) et académicien (1897), fervent défenseur de l’unité de la Patrie et de son rayonnement international, Gabriel Hanotaux (1853-1944) a quitté les devants de la scène politique à l’aube du XXe siècle. Au cours de ce demi-siècle de vie, de 1898 à 1944, où les deux premières guerres mondiales ont bouleversé l’équilibre des nations, Hanotaux a participé à l’élaboration de la paix en tant que délégué à la Société des Nations (1920), à la consolidation des liens culturels avec l’Amérique en créant le Comité France Amériques (1909), tout en étant pleinement intégré à l’élite politique et culturelle du pays. Admirateur de Richelieu, homme d’Etat dont il a cherché à suivre les traces, cet académicien contribua à écrire l’Histoire, menant de front analyse des évènements passés et préparation de l’avenir.
26/11/2022
Défendre son territoire, milice et société dans l'Amérique coloniale française, XVIIe - XVIIIee siècles
Cette thèse cherche à définir les milices coloniales de l’empire français à l’époque moderne. Assemblant tous les hommes libres et armés, elles possèdent un rôle militaire central dans la défense des colonies. Avant l’arrivée des troupes réglées à la fin du XVIIe siècle, ces colons-soldats assurent seuls la sûreté des jeunes colonies puis, en appui des armées royales, ils défendent les côtes, les villes ou les frontières dans les guerres de l’espace colonial. Or leurs autres fonctions des milices coloniales ne doivent pas être négligées, notamment l’encadrement des sociétés et des territoires. Le quartier, cadre quotidien du service du milicien, présente, avec d’autres espaces tels les chemins, un enjeu dans le contrôle des colonies. Les fonctions de police et la place des élites, des gens de couleur ou des peuples autochtones dévoilent les liens étroits entre milices et sociétés. Enfin, l’institution des milices interroge le rapport à l’autorité royale et le système impérial notamment à travers l’évolution des cadres législatifs, entre spécificités locales et uniformisation.
Milice, défense, colonie, empire français, territoire, police, élites, gens de couleur et esclaves.
25/11/2022
Les diplomaties plurielles de Côme Ier de Médicis. Les agents florentins et la France à la fin des guerres d’Italie (1537-1559)
Cette thèse porte sur les agents diplomatiques de Côme Ier de Médicis envoyés en France entre 1537 et 1559, dans la seconde partie des guerres d’Italie. En 1530, les Médicis rejoignent l’empereur et deviennent, sous sa tutelle, ducs de Florence, rompant avec la tradition francophile de la cité. Les deux changements, de régime d’une part, d’alliance de l’autre, ont longtemps été considérés comme étant à l’origine d’une rupture absolue des relations en Florence et la France, alors même que la période correspond à celle de l’ascension française de Catherine de Médicis, cousine de Côme. À l’aune d’un large dépouillement des registres de la chancellerie médicéenne, cette thèse rend caduque la doxa historiographique postulant cette rupture. Elle montre comment se construit une projection extérieure dans un espace inamical et dans le contexte d’un renouvellement du personnel politique florentin. Ce travail met en avant la multiplicité des acteurs des relations internationales et des modalités d’envois qui président à leur action. Ces « diplomaties plurielles » permettent à Côme de Médicis d’employer des dizaines d’agents aux statuts variés (espions, ambassadeurs, secrétaires, banquiers ou encore consuls) et de disposer d’une présence quasi continue à la cour de France et auprès des représentants français en Italie. Ainsi, ce cas d’étude permet de rendre compte de toute la complexité d’un modèle social et politique qui pourrait être représentatif de la Renaissance européenne, bien au-delà des seules limites du duché de Florence.
23/11/2022
LE Tuyau de la fonte Mussipotain à la conquête du monde. Pont-à-mousson et sa politique exportatrice (1856-1970)
Créée en 1856 à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle actuelle), la société du même nom (abrégée PAM) se spécialise dans la production de tuyaux en fonte pour l’adduction de l’eau et du gaz. Alors qu’elle doit encore se faire un nom, l’entreprise est confrontée à un marché intérieur contraint. Sa stratégie intègre un recours continu à des ventes hors métropole, à la fois à l’étranger et dans les colonies. La politique exportatrice qu’elle développe est poursuivie tout au long de sa croissance. Devenue un groupe reconnu pour sa gestion financière et son activité à l’international, PAM fusionne avec Saint-Gobain en 1970. L’abondance de ses archives permet d’interroger les raisons et les modalités de son dynamisme à l’exportation. Il s’agit alors de comprendre ce que recouvre cette activité et ce qu’elle implique. En tant qu’axe stratégique, le développement et la place de la politique exportatrice au sein de l’entreprise constituent le premier objet d’analyse. Entre variations du contexte international et critères industriels internes, l’exportation mussipontaine varie selon des facteurs nombreux. L’organisation et les moyens déployés par PAM pour conquérir les marchés hors métropole forment le deuxième volet d’investigation. Le dispositif commercial et les fournitures obtenues sont abordés dans leurs généralités et par l’approfondissement de cas d’étude. À chaque étape, les retombées de la politique exportatrice sont estimées. Les résultats industriels et financiers tendent alors à préfigurer les modalités de son maintien. La place de l’exportation dans l’image et la culture de l’entreprise fait quant à elle figure tant d’incidence que de facteur de continuité.
21/06/2022
Les nobles canadiens sous le régime britannique : réactualiser le « vivre noblement » pour continuer à exister
Entre 1774 et 1815, la noblesse canadienne tente de stabiliser sa position sociale au sein d’une société canadienne qui est désormais sous tutelle britannique. Pour cela, les nobles opèrent une redéfinition culturelle et sociale de leur idée de noblesse afin de s’adapter au nouveau régime.
Grâce aux relations qui s’établissent entre les nobles restés dans l’Empire britannique, ceux l’ayant quitté et les nouvelles élites qui s’établissent dans la colonie au tournant du XIXe siècle, il nous est possible de mieux appréhender la façon dont la noblesse réinvestit son capital symbolique. L’étude des patrimoines matériels, sociaux et intellectuels ainsi que leurs modes de transmission permettront d’examiner les modalités d’adaptation de la communauté noble face aux changements de la période étudiée. Enfin, cette noblesse à cheval entre deux empires, dont les réseaux s’étendent sur de nombreux territoires, permet de mieux percevoir les évolutions qui s’opèrent à cette époque dans les sociétés coloniales et en particulier en Amérique du Nord et au Canada.
14/05/2022
FAMILLES DOMINANTES, Réseaux de fidélité et pouvoir (orvieto, pérouse). xie - Xiie siècle
Les XIe-XIIIe siècles constituent une phrase de reconfiguration tout à fait fondamentale de la société du regnum italicum et de tout l’Occident. C’est dans ce cadre que ce travail s’intéresse aux évolutions des relations de domination et du pouvoir, entendu comme l’aptitude à structurer le champ d’action et de pensée d’autrui. Il analyse également l’ensemble des actions et des techniques déployées par les dominants pour établir, imposer, légitimer et pérenniser leur domination. L’enquête met au centre de l’attention des relations et des réseaux — interpersonnels, économiques, d’information —, ainsi que les rapports dans l’espace et à l’espace. Elle développe notamment le concept de réseau de fidélités, qui rend compte de l’ensemble des liens qu’un puissant peut établir pour influencer de manière contraignante l’action d’autres individus. L’analyse repose sur le dépouillement systématique de toutes les sources écrites et matérielles d’Ombrie et du nord du Latium, ainsi que sur la constitution d’une base de données et d’un SIG. Une attention particulière est consacrée à la seigneurie, dont est établie une définition nouvelle, rendant compte de la diversité de ses formes et de son évolution au cours du temps. Par l’étude précise et circonstanciée du centre de la péninsule italienne, ce travail apporte également de nouveaux éléments à propos de l’incastellamento, de l’évolution des structures familiales, de la tenure et du fief, du concept de féodalité, du développement des communes ou encore à propos du débat entre mutationnisme et antimutationnisme.
04/04/2022
La perception du Canada dans l'opinion publique anglaise et française dans la première moitié du XVIIIe siècle
Victorieuse de la guerre de Sept Ans, la Grande-Bretagne étend son emprise sur les quatre parties du monde. Pour sa part, la France perd une partie de ses colonies et en ressort endettée. À l’issue de ce conflit, l’équilibre des puissances est précaire et chacun des deux empires doit repenser sa politique impériale. Au cœur de ces enjeux se trouve le Canada, nouvellement cédé à l’Angleterre à la suite de la signature du Traité de Paris (1763). À une époque où les autorités doivent se plier de plus en plus aux débats qui émergent de la sphère publique, il importe de se questionner sur la place qu’occupe le Canada dans l’opinion exprimée à son sujet dans la presse des deux pays belligérants. De plus, il convient d’analyser, par l’intermédiaire des discours écrits dans la presse, comment ils ont su informer les populations européennes sur les enjeux qui concernent le Canada et sa place dans les négociations diplomatiques des deux pays au midi du XVIIIe siècle. Au croisement de l’histoire culturelle, transnationale et impériale, notre projet doctoral s’inscrit dans une large historiographie pour comprendre la place occupée par le Canada dans l’imaginaire colonial des Européens.
13/03/2022
Les cours des miracles de Paris (1667-1791) : imaginaires, spatialisation et contrôle de la mendicité parisienne
On sait qu’elles ont existé, mais on ne sait pas vraiment ce qu’elles ont été. La Cour des Miracles est un motif littéraire que Victor Hugo a amplement développé dans Notre-Dame de Paris, mais qui fut également l’objet d’une large part de la littérature de la gueuserie des XVIe et XVIIe siècles. Les historiens de la littérature ont étudié cet univers littéraire, notamment à travers l’argot, cette première forme de langage souterrain et codé qui devint rapidement le véhicule des représentations de la pauvreté et de la criminalité. Pourtant, au moment où l’histoire policière, judiciaire et urbaine se développaient, les cours des miracles demeuraient dans l’ombre. Oscillant toujours entre le mythe et la réalité sans qu’aucune recherche ne tente de tisser des liens entre les discours fictionnels et la réalité urbaine et sociale. C’est dans un creux historiographique que s’inscrit cette recherche qui s’articule autour de trois pôles : les représentations sociales, la sûreté et les sociabilités. Il fallait d’abord comprendre le mythe et son enracinement dans la société. Henri Sauval (1623-1676), le premier, décrivait la Cour des Miracles située derrière le couvent des Filles-Dieu, entre les rues Saint-Denis et Neuve-Saint-Sauveur. Endroit fétide, boueux, surpeuplé, réunissant des voleurs, des prostituées et les familles des classes les plus malfamées de la capitale. Il dressait un portrait enraciné dans le Paris de la fin du XVIIe siècle. Cette célèbre Cour des Miracles des Filles-Dieu fut apparemment détruite en 1667, première mission du nouveau lieutenant général de police. Pourtant, des cours des miracles persistaient dans les guides et les plans de la ville jusqu’à la Révolution française témoignant de leur implantation dans le paysage mental et géographique des Parisiens. Mais au-delà du mythe, les cours des miracles sont un problème de sûreté. Espaces de non-droit, les cours des miracles s’inscrivent, par définition, comme des lieux risqués de la capitale et potentiellement surveillés par la police. Si les cours des miracles intègrent le paysage mental des Parisiens, n’intègrent-elles pas, du même coup, celui de la police? C’est dans les documents de la police des mendiants, durant la seconde partie du XVIIIe siècle, qu’il a été possible de chercher les traces des cours des miracles. Les procès-verbaux d’arrestations de mendiants permettent de suivre les pas d’une police spécialisée. Entre organisation territoriale et pratique policière, les cours des miracles des papiers de la police quittent définitivement les culs-de-sac de la ville pour intégrer l’archipel des lieux d’accueil. Enfin, il y avait les habitants de ces cours dont il fallait confronter les réalités aux descriptions fictionnelles. Si les auteurs, comme Henri Sauval, décrivaient les résidents des cours des miracles comme des exclus et des faux mendiants, les mendiants de Paris constituent une catégorie beaucoup plus hétéroclite et beaucoup moins criminelle. Les papiers de la police contiennent bon nombre de pistes pour repenser l’exclusion des mendiants au travers des relations sociales et du travail. De fait, l’exclusion sociale est à reconsidérer alors que la mendicité doit être perçue comme une stratégie de survie qui s’inscrit dans les marchés informels de la ville de Paris.
11/02/2022
LE MARQUIS DE BIENCOURT ET LA TERRE d'azay-le-rideau, de la seigneurie au monument historique (1888-1899)
En septembre 1791, après une longue procédure et de nombreuses hésitations en raison du contexte révolutionnaire, le marquis Charles de Biencourt, noble d’extraction, militaire et originaire de la Creuse, député aux états généraux et à la Constituante, signe l’achat de la terre d’Azay-le-Rideau et de son château. À sa suite, la propriété passe entre les mains des trois marquis de Biencourt successifs, Armand-François, Armand-Marie, puis Charles-Marie. Dans la seconde moitié de la période, alors que la grande fortune des héritiers du titre périclite peu à peu et au fur et à mesure des partages inhérents aux héritages, le dernier marquis de Biencourt, veuf et ayant perdu ses deux fils, finit, malgré lui, par se séparer du domaine et du château d’Azay à partir de 1899, après une vente difficile. Au cours de ces quatre générations, les marquis de Biencourt, tout en conservant leur mode de vie pluri-résidentiel, et leur vie parisienne, modifient profondément ce qu’ils appellent encore tout au long de la période « la terre d’Azay ». De ce fait, si l’acquéreur du domaine, en physiocrate averti, choisit un mode de gestion privilégiant le métayage et le faire-valoir direct, ses héritiers successifs, quant à eux, adoptent une gestion qui assoie à la fois la concentration foncière et le déploiement du fermage. Mais c’est aussi le château et son parc que ces hommes décident aussi de transformer. Ainsi, à partir des années 1840, par le choix des rénovations dans un style résolument néo-Renaissance, les marquis de Biencourt ancrent définitivement le château d’Azay-le-Rideau dans le paysage renaissant du Val-de-Loire qui, de fait, est en partie une construction du XIXe siècle.
21/01/2022
Pour l’extirpation de l’hérésie : la violence dans les prédications catholiques du XVIe siècle
Cette thèse se fonde sur une relecture des sermons de François Le Picart, qui fut le grand prédicateur du Paris du premier XVIe siècle, et qui a laissé, grâce à des impressions savantes, un corpus riche de ses prises de parole, permettant d’examiner la genèse de l’imaginaire d’une violence ainsi véhiculée et promue oralement. Le Picart est en effet au cœur de l’histoire de la prédication combattante qui se met en place dès les années 1520-1550 avant d’envahir la sphère publique à partir de 1560. Il est un précurseur qui donne les codes autorisant la progressive maturation d’une tension de violence théophanique dont les hommes devaient être les outils. Par son truchement ; le lecteur peut saisir la puissance des mots qui émanait de la prédication, une autre éloquence de la Renaissance qui visait à mettre en fonctionnement une stratégie d’endoctrinement du peuple catholique à partir du principe d’une mise en défense panique des consciences opérant sur les bases d’une actualisation de la doctrine de l’Église. Dans cette optique, Le Picart accorda une place déterminante à une technique de mise en scène de l’imaginaire de la violence qui reposait sur le recours à des peintures mentales qu’il cherchait à projeter dans la psyché de ses auditeurs. Cette stratégie était un dispositif rhétorique susceptible de susciter, par effet de pathos, une angoisse qui était eschatologique dans la tension inhérente aux sermons opposant dramatiquement l’amour zélé pour Dieu au péché toujours plus croissant de l’homme. Le Picart fut un prophète, qui non seulement parlait pour Dieu et par Dieu mais aussi travaillait l’imaginaire des fidèles en infusant en eux un « parler Dieu », les mettant en condition, après 1560, de devenir des guerriers de Dieu. L’enfer qu’il décrivait comme attendant les hérétiques dans le temps de leur mort allait alors venir sur terre.
2021
10/12/2021
« Au nom du bien public ». Exercer le pouvoir règlementaire dans une société en guerre. Lyon, vers 1561-vers 1594
La ville du XVIe siècle est un entrelacs de responsabilités, d’institutions et de juridictions concurrentes. Gérer une ville est une affaire ardue, d’autant plus lorsque les responsables sont en désaccord sur la manière de le faire et ne sont pas spécialistes de son administration. Pourtant, confrontés aux défis d’une longue guerre civile, de la cohabitation religieuse, des crises économiques et sanitaires qui frappent Lyon au XVIe siècle, les pouvoirs municipaux ont dû inventer de nouvelles manières de gouverner et d’administrer l’espace sur lequel leur juridiction s’étend. Cette dernière s’est considérablement accrue au cours des guerres, profitant de l’éloignement du pouvoir central, mais plus encore profitant, presque par mégarde, des opportunités ouvertes par les circonstances. Au quotidien, assurer le ravitaillement de la ville, la santé publique, garder ses portes et ses murailles pour assurer son intégrité, sont des nécessités mobilisatrices, en même temps que des prises de responsabilités attendues, d’hommes à qui le commandement de la cité a été octroyé par l’élection.
C’est cette gestion quotidienne qu’il convient de cerner, pour comprendre comment il est possible de gouverner une ville aux prises avec les conflits religieux. C’est d’abord par un dialogue fructueux avec la monarchie que les échevins de Lyon assoient leurs pouvoirs : si certains sont au cœur des responsabilités communales depuis sa création au Moyen Âge, telles que la garde ou l’organisation des élections, celles-ci sont rebattues à l’occasion des crises que traverse la ville et se renforcent de nouveaux. Cette augmentation des pouvoirs se double de responsabilités accrues, que les échevins ne désirent pas systématiquement, et qui, indirectement, assurent le rôle régulateur de la monarchie. La progression des officiers royaux dans la composition du consulat dans les années 1570 et 1580 favorise l’apparition d’une culture juridique commune et d’un recours de plus en plus important à l’écrit dans les pratiques quotidiennes du pouvoir. La gestion de l’espace urbain par l’entretien de la voirie et des murailles leur permet de participer à la définition d’un espace public, dont la caractéristique essentielle est d’être catholique et dans lequel se déploie une mise en scène réfléchie du pouvoir municipal. Tantôt s’appuyant sur, tantôt combattant les autres institutions urbaines, ces prétentions sont construites dans des espaces différents, qui ont chacun leurs avantages et sont mobilisés dans le cadre d’une négociation réfléchie, faisant appel à de larges réseaux curiaux mais également interurbains. Ces savoir-faire politiques et administratifs se transmettent au cours des années : une véritable accumulation d’expérience règlementaire se dessine à mesure que le consulat se dote d’outils et d’experts chargés de justifier ces pouvoirs et de fabriquer à la fois du droit et des technologies de gouvernement adaptées. La Ligue dès lors, malgré ses ambiguïtés, semble être une acmè dans cette autonomie, autant voulue que subie, du pouvoir municipal : le retour de Lyon sous l’autorité royale est en ce sens une rupture majeure, qui, si elle réorganise les institutions en profondeur, ne remet pourtant pas en cause la transmission des dispositifs règlementaires visant à assurer le bien public.
04/12/2021
« où l'on offre tout ce qui peut se vendre ». niveaux de vie et consommation à rouen dans la seconde moitié du xve siècle.
Cette thèse analyse les niveaux de vie et la consommation de la population rouennaise à la fin du Moyen Âge (du milieu du XVe siècle au début du XVIe siècle). Il s’agit de s’interroger sur la possibilité d’estimer les niveaux de vie et détailler les consommations urbaines d’une des principales villes du royaume de France. Cette réflexion se fonde sur la richesse et la diversité des sources rouennaises, à la fois textuelles, iconographiques et archéologiques. Les comptabilités sont le support principal de cette étude. Elles font l’objet d’une analyse sur leur contexte de production et sur leur élaboration. Leur dépouillement minutieux permet de cerner finement la fabrique économique et sociale des niveaux de vie. La réflexion menée autour de l’établissement d’un « panier de consommation » souligne que la mise en regard des salaires et des dépenses alimentaires est indispensable, mais insuffisante, pour saisir le pouvoir d’achat. Tous les paramètres de la vie quotidienne – alimentation, ustensiles de cuisine, loyer, combustibles, éclairage, meubles, vêtement ou coût du travail – sont successivement examinés et détaillés pour proposer des premières estimations des niveaux de vie. La richesse des sources offre également l’opportunité de saisir dans le détail certaines pratiques économiques : réparation, recyclage, location, aumônes… La quantification des consommations n’est pas le seul volet à prendre en considération pour définir les niveaux de vie. La culture matérielle des groupes sociaux tout comme leur présence dans l’espace public – par le vêtement par exemple – en sont également des marqueurs.

Christophe
FURON
Sous la direction de

Jean-Marie Moeglin
Sorbonne Université
04/12/2021
Servir le roi par les armes : La Hire et Poton de Xaintrailles, capitaines de Charles VII
La thèse reconstitue la carrière d’Etienne de Vignoles, dit La Hire (le valet de coeur du jeu de carte), et Poton de Xaintrailles. Ces petits capitaines gascons font leur apparition dans l’histoire en 1418 : au service du dauphin Charles, le futur Charles VII, ils mènent alors une guerre d’escarmouches et de coups de main qui font leur renommée. A partir de ce moment, ils sont de presque tous les principaux faits d’armes du règne, combattant par exemple aux côtés de Jeanne d’Arc et servant le roi jusqu’à leur mort (1443 pour La Hire, 1461 pour Poton). Ils acquièrent ainsi terres, titres et offices (Poton devient maréchal en 1454).
La thèse analyse également leur activité d’entrepreneurs de guerre. L’étude de leurs réseaux, de leur gestion des compagnies placées sous leurs ordres et de la dimension économique de leur activité montre que la prééminence de ces deux capitaines dans la société militaire de leur temps n’est pas uniquement due à leurs talents militaires.
La thèse s’attache également à étudier les ressorts de leur renommée et leur image à travers les siècles, jusqu’à aujourd’hui.
Elle tente ainsi d’offrir un éclairage nouveau sur la société militaire sous Charles VII.
C’est cette gestion quotidienne qu’il convient de cerner, pour comprendre comment il est possible de gouverner une ville aux prises avec les conflits religieux. C’est d’abord par un dialogue fructueux avec la monarchie que les échevins de Lyon assoient leurs pouvoirs : si certains sont au cœur des responsabilités communales depuis sa création au Moyen Âge, telles que la garde ou l’organisation des élections, celles-ci sont rebattues à l’occasion des crises que traverse la ville et se renforcent de nouveaux. Cette augmentation des pouvoirs se double de responsabilités accrues, que les échevins ne désirent pas systématiquement, et qui, indirectement, assurent le rôle régulateur de la monarchie. La progression des officiers royaux dans la composition du consulat dans les années 1570 et 1580 favorise l’apparition d’une culture juridique commune et d’un recours de plus en plus important à l’écrit dans les pratiques quotidiennes du pouvoir. La gestion de l’espace urbain par l’entretien de la voirie et des murailles leur permet de participer à la définition d’un espace public, dont la caractéristique essentielle est d’être catholique et dans lequel se déploie une mise en scène réfléchie du pouvoir municipal. Tantôt s’appuyant sur, tantôt combattant les autres institutions urbaines, ces prétentions sont construites dans des espaces différents, qui ont chacun leurs avantages et sont mobilisés dans le cadre d’une négociation réfléchie, faisant appel à de larges réseaux curiaux mais également interurbains. Ces savoir-faire politiques et administratifs se transmettent au cours des années : une véritable accumulation d’expérience règlementaire se dessine à mesure que le consulat se dote d’outils et d’experts chargés de justifier ces pouvoirs et de fabriquer à la fois du droit et des technologies de gouvernement adaptées. La Ligue dès lors, malgré ses ambiguïtés, semble être une acmè dans cette autonomie, autant voulue que subie, du pouvoir municipal : le retour de Lyon sous l’autorité royale est en ce sens une rupture majeure, qui, si elle réorganise les institutions en profondeur, ne remet pourtant pas en cause la transmission des dispositifs règlementaires visant à assurer le bien public.
27/11/2021
Devenir prince. James Stuart, réseaux européens et ambitions britanniques (1660-1685)
La thèse d’Emmanuel Lemée étudie la construction concrète du pouvoir d’un prince européen et cherche à mettre en lumière la dimension informelle du pouvoir princier dans les cours et les sociétés d’Europe de l’ouest, à travers le cas du frère de Charles II d’Angleterre, James Stuart. Pour ce faire, la thèse d’Emmanuel Lemée étudie aussi bien l’action politique de James Stuart, et notamment son implication croissante au cours du règne de son frère dans les affaires diplomatiques, que son entourage et sa très nombreuse clientèle. À travers l’étude des relations de ce prince avec ses contemporains, ce travail de recherche s’efforce également de mieux cerner l’impact que pouvaient avoir les fréquentations d’un homme de pouvoir sur son action et son image, notamment les contraintes qu’impliquaient pour un patron la nécessité de ne pas perdre sa crédibilité aux yeux de ses clients. Ce travail de recherche contribue à faire émerger de nouvelles pistes d’explication et d’analyse pour comprendre la dégradation de l’image de James Stuart dans l’opinion britannique, qui joua un grand rôle dans sa perte du pouvoir lors de la Glorieuse Révolution de 1688.
C’est cette gestion quotidienne qu’il convient de cerner, pour comprendre comment il est possible de gouverner une ville aux prises avec les conflits religieux. C’est d’abord par un dialogue fructueux avec la monarchie que les échevins de Lyon assoient leurs pouvoirs : si certains sont au cœur des responsabilités communales depuis sa création au Moyen Âge, telles que la garde ou l’organisation des élections, celles-ci sont rebattues à l’occasion des crises que traverse la ville et se renforcent de nouveaux. Cette augmentation des pouvoirs se double de responsabilités accrues, que les échevins ne désirent pas systématiquement, et qui, indirectement, assurent le rôle régulateur de la monarchie. La progression des officiers royaux dans la composition du consulat dans les années 1570 et 1580 favorise l’apparition d’une culture juridique commune et d’un recours de plus en plus important à l’écrit dans les pratiques quotidiennes du pouvoir. La gestion de l’espace urbain par l’entretien de la voirie et des murailles leur permet de participer à la définition d’un espace public, dont la caractéristique essentielle est d’être catholique et dans lequel se déploie une mise en scène réfléchie du pouvoir municipal. Tantôt s’appuyant sur, tantôt combattant les autres institutions urbaines, ces prétentions sont construites dans des espaces différents, qui ont chacun leurs avantages et sont mobilisés dans le cadre d’une négociation réfléchie, faisant appel à de larges réseaux curiaux mais également interurbains. Ces savoir-faire politiques et administratifs se transmettent au cours des années : une véritable accumulation d’expérience règlementaire se dessine à mesure que le consulat se dote d’outils et d’experts chargés de justifier ces pouvoirs et de fabriquer à la fois du droit et des technologies de gouvernement adaptées. La Ligue dès lors, malgré ses ambiguïtés, semble être une acmè dans cette autonomie, autant voulue que subie, du pouvoir municipal : le retour de Lyon sous l’autorité royale est en ce sens une rupture majeure, qui, si elle réorganise les institutions en profondeur, ne remet pourtant pas en cause la transmission des dispositifs règlementaires visant à assurer le bien public.
27/11/2021
Léguer sans fils. Hériter sans père. Transmission et légitimation du pouvoir chez les cardinaux au Quattrocento
Les cardinaux se conforment de plus en plus au Quattrocento à un mode de vie princier, dans lequel l’hérédité est la norme. Ils accumulent dans le même mouvement toujours plus de pouvoirs et de biens qu’ils parviennent à extraire de l’Église. Toutefois, le patrimoine matériel et immatériel qu’ils se constituent est principalement composé de biens de l’Église qui sont en théorie inaliénables. Dans le même temps, ils sont soumis au célibat ecclésiastique qui leur interdit de transmettre ces biens et ces pouvoirs à d’éventuels enfants. Face à cette tension, les sénateurs de l’Église parviennent à contourner la norme : ils héritent bien souvent de la pourpre et de biens d’origine ecclésiastique d’un de leurs parents et parviennent à les léguer à certains membres de leur famille qui ne sont pas leurs enfants. Des stratégies élaborés et différenciés de transmission se mettent alors en place. À l’inverse, les aspirants à la barrette et les nouveaux venus dans le Sacré Collège s’appuient, lorsqu’ils en ont l’occasion, sur les relations de parenté qui les unissent à d’anciens cardinaux pour légitimer leur position sociale. Bien loin d’être mise en accusation, la parenté qui unit les détenteurs de la pourpre de la fin du Moyen Âge est au contraire valorisée. Ces successions de cardinaux appartenant à la même famille aboutissent à la création de dynasties cardinalices qui se multiplient dans le Sacré Collège de la seconde moitié du XVe et du début du XVIe siècle. La figure du cardinal lignager, caractéristique de la Renaissance, connaît alors son apogée avant de s’éclipser largement avec la réforme tridentine.
20/11/2021
Les parfumeurs et la cour de France, de Louis XIV à Louis XVI : analyse sociale, culturelle et technique d'un métier
Cette thèse a pour objet l’étude des parfumeurs qui fournissaient la cour de Versailles de Louis XIV à Louis XVI. A partir du XVIIe siècle, le métier de parfumeur se constitue en un artisanat indépendant. Les gantiers s’emparent de ce savoir-faire et parviennent à s’en arroger le monopole. Dès lors, les gantiers-parfumeurs fabriquent les gants parfumés, dont le succès est à son apogée à la cour de Louis XIV, les eaux de senteur et tous les cosmétiques. Ces produits font l’objet d’une consommation importante parmi les courtisans qui se conforment à une certaine apparence pour répondre aux critères du paraître curial. Ces recherches se placent dans le cadre d’une histoire socio-culturelle en analysant ces artisans dans une vision globale comprenant le métier lui-même, mais également l’environnement social et culturel. La mise en valeur des réseaux sociaux dans lesquels ces hommes s’insèrent permet de dégager ceux qui ont été les plus influents. Parmi eux, la dynastie des Huet, qui a fourni la famille royale et la cour sur quatre générations, représente un modèle de réussite artisanale familiale. Les recherches viseront également à cerner le profil culturel de ces individus.
C’est cette gestion quotidienne qu’il convient de cerner, pour comprendre comment il est possible de gouverner une ville aux prises avec les conflits religieux. C’est d’abord par un dialogue fructueux avec la monarchie que les échevins de Lyon assoient leurs pouvoirs : si certains sont au cœur des responsabilités communales depuis sa création au Moyen Âge, telles que la garde ou l’organisation des élections, celles-ci sont rebattues à l’occasion des crises que traverse la ville et se renforcent de nouveaux. Cette augmentation des pouvoirs se double de responsabilités accrues, que les échevins ne désirent pas systématiquement, et qui, indirectement, assurent le rôle régulateur de la monarchie. La progression des officiers royaux dans la composition du consulat dans les années 1570 et 1580 favorise l’apparition d’une culture juridique commune et d’un recours de plus en plus important à l’écrit dans les pratiques quotidiennes du pouvoir. La gestion de l’espace urbain par l’entretien de la voirie et des murailles leur permet de participer à la définition d’un espace public, dont la caractéristique essentielle est d’être catholique et dans lequel se déploie une mise en scène réfléchie du pouvoir municipal. Tantôt s’appuyant sur, tantôt combattant les autres institutions urbaines, ces prétentions sont construites dans des espaces différents, qui ont chacun leurs avantages et sont mobilisés dans le cadre d’une négociation réfléchie, faisant appel à de larges réseaux curiaux mais également interurbains. Ces savoir-faire politiques et administratifs se transmettent au cours des années : une véritable accumulation d’expérience règlementaire se dessine à mesure que le consulat se dote d’outils et d’experts chargés de justifier ces pouvoirs et de fabriquer à la fois du droit et des technologies de gouvernement adaptées. La Ligue dès lors, malgré ses ambiguïtés, semble être une acmè dans cette autonomie, autant voulue que subie, du pouvoir municipal : le retour de Lyon sous l’autorité royale est en ce sens une rupture majeure, qui, si elle réorganise les institutions en profondeur, ne remet pourtant pas en cause la transmission des dispositifs règlementaires visant à assurer le bien public.
15/09/2021
présence de la chine aux expositions universelles françaises de 1855 à 1937
À leur apogée, les Expositions universelles ou internationales, marques des processus de mondialisation et de modernisation, ne manquaient pas une participation chinoise de multi-forme et multi-niveau dans le principal pays organisateur, la France. L’étude de la présence chinoise suit chronologiquement ces grandes manifestations déroulées à Paris, cas par cas, durant près d’un siècle. Les représentations traitées évoluaient avec le temps, selon le contexte international, la relation franco-chinoise et le régime politique. La question d’éclairer les faits et de préciser les limites de la place de ce pays aux Expositions universelles françaises se situe à l’origine de la présente étude. À la fin de la dynastie, des Douanes maritimes impériales sous la direction des étrangers influençaient fortement les procédures d’organisation. Témoins de la mutation de la vie économique, des pavillons nationaux à Paris dévoilaient tant le déséquilibre de la répartition géographique de commerce que la disparité de la structure industrielle dans ce pays. De manière parallèle, des manifestations culturelles et artistiques présentaient une continuité survivant aux changements. De plus, l’analyse de ces participations permet d’examiner l’éventuelle capacité de se présenter sur l’échiquier international, ainsi que d’évaluer de premiers efforts d’industrialisation chinoise. Cette thèse a pour ambition de dresser un bilan des participations chinoises en France, afin de contribuer à l’un des aspects de l’histoire des expositions de la Chine moderne.
06/07/2021
La question indochinoise entre la france et la république populaire de chine de 1954 à 1964
Cette thèse traite principalement des relations sino-françaises autour de la question indochinoise, le rôle d’Indochine dans les relations sino-françaises et l’influence de la Guerre froide sur ces questions entre 1954 et 1964. Pendant la guerre d’Indochine, la France et la Chine se trouvent en opposition en Indochine en raison du soutien chinois au Vietminh et de la situation tendue de la Guerre froide. À partir de 1953, la Chine et la France ont des souhaits communs de régler des conflits indochinois par voie de négociation. Ainsi, pendant la conférence de Genève de 1954, la Chine et la France ont un certain nombre de contacts et réalisent des collaborations en vue de mettre fin à la guerre d’Indochine. Après la guerre d’Indochine, la Chine poursuit la ligne politique de dissocier l’alliance occidentale. Elle tente de développer ses relations avec la France et d’obtenir le soutien français dans l’application des accords de Genève. Cependant, la politique extérieure de la IVe République française n’est pas indépendante des États-Unis. Les deux pays manquent donc une occasion de normalisation de leurs relations et de collaboration dans l’application des accords de Genève. Après son arrivée au pourvoir, Charles de Gaulle poursuit une France indépendante et puissante. La divergence franco-américaine à propos de l’Indochine devient aiguë. Des contacts pendant la conférence de Genève sur le Laos entre 1961 et 1962 ont une influence positive sur les relations sino-françaises. Avec pour l’un des objectifs d’obtenir la coopération de la Chine sur la question indochinoise, De Gaulle décide de reconnaître la Chine en janvier 1964. Cependant, même si certaines coopérations réalisées entre la France et la Chine sur le Laos après l’établissement des relations diplomatiques, une conférence internationale sur toute Indochine espérée par De Gaulle n’est pas réalisée.
18/06/2021
Les polices du corps féminin : constructions politico-religieuses de la virginité et de la maternité entre Renaissance et Réforme, 1488-1589 (France et espace romand)
Dans les discours du XVIe siècle, les femmes, dans leur nature jugée faible et facilement tournée vers le vice, sont considérées avoir le pouvoir de mettre en péril la société dans son ensemble. Cette problématique a d’autant plus d’implications pendant les années des conflits confessionnels. C’est pourquoi une volonté se lit dans les textes prescriptifs de « policer » le corps des femmes et de le rendre le plus exemplaire possible, afin que cette exemplarité, dans leurs pratiques, se répercute ensuite sur le corps social. La lecture des sources retenues – recoupant entre autres des manuels de comportements, des sermons ainsi que des traités moraux et des sources littéraires – permet d’appréhender la manière dont les divers auteurs, humanistes, catholiques ou réformés, cherchent à modeler le corps des jeunes filles, des épouses et des mères. Cela, au travers d’une instruction qui se perpétue au long de l’existence, et qui concerne tant l’esprit, les mouvements, les apparences, l’habillement, la posture, ou encore le corps dans sa puissance maternelle. En parallèle, des textes écrits par des femmes ou mettant en scène des femmes, témoignent de leur agentivité et d’une affirmation de soi qui s’éloigne parfois du portrait idéalisé et policé mis en avant par les discours normatifs dominants.
29/05/2021
Michel Hurault de L’Hospital 1559 –1592 : Recherches historiques sur la vie et la pensée du petit-fils du Chancelier de France Michel de L’Hospital
Voici le fructueux parcours oublié depuis des siècles de Michel Hurault de L’Hospital au cœur des guerres de Religion. Issu de l’importante famille Hurault, instruit par son illustre grand-père maternel Michel de L’Hospital, celui-ci le distinguait d’entre ses petits-enfants pour ses évidentes prédispositions.La thèse explore le contexte familial, fratrie, alliances, amitiés, rivalités et clientèle, les aspects intellectuels, juridiques, politiques, religieux (Hurault était huguenot) de la carrière et l’œuvre de ce fidèle à Henri III. Jeune parlementaire il devint serviteur, compagnon d’Henri de Navarre, diplomate, chancelier de Navarre, homme de guerre d’Henri IV avant de périr d’une mort « estrange ».Bien avant le sacre d’Henri et l’Edit de Nantes, Hurault avait formulé diverses propositions d’apaisement. Par ses écrits et ses actions il défendait l’application de la loi salique contre le duc de Guise, la Ligue et l’Espagne, la liberté religieuse, l’idée supérieure du service de l’Etat, l’indépendance et la grandeur du royaume unifié autour de son roi légitime : Henri IV.Angleterre, Allemagne, Hollande, son rayonnement dépassait les frontières. En son temps Hurault impressionnait par son ardente implication éclairée par son regard singulièrement pénétrant sur les forces contraires qui déchiraient la France. Sa vision précise, rationnelle que l’Histoire confirma ultérieurement, le conduisait dans ses recommandations pour écarter les périls et rétablir le royaume.Apparaissent alors les spécificités et l’apport de ce personnage lettré et courageux. Son énergie, ses combats prouvent sa foi et son amour de la France qu’il appelait : « ma patrie, ma première mère. »
C’est cette gestion quotidienne qu’il convient de cerner, pour comprendre comment il est possible de gouverner une ville aux prises avec les conflits religieux. C’est d’abord par un dialogue fructueux avec la monarchie que les échevins de Lyon assoient leurs pouvoirs : si certains sont au cœur des responsabilités communales depuis sa création au Moyen Âge, telles que la garde ou l’organisation des élections, celles-ci sont rebattues à l’occasion des crises que traverse la ville et se renforcent de nouveaux. Cette augmentation des pouvoirs se double de responsabilités accrues, que les échevins ne désirent pas systématiquement, et qui, indirectement, assurent le rôle régulateur de la monarchie. La progression des officiers royaux dans la composition du consulat dans les années 1570 et 1580 favorise l’apparition d’une culture juridique commune et d’un recours de plus en plus important à l’écrit dans les pratiques quotidiennes du pouvoir. La gestion de l’espace urbain par l’entretien de la voirie et des murailles leur permet de participer à la définition d’un espace public, dont la caractéristique essentielle est d’être catholique et dans lequel se déploie une mise en scène réfléchie du pouvoir municipal. Tantôt s’appuyant sur, tantôt combattant les autres institutions urbaines, ces prétentions sont construites dans des espaces différents, qui ont chacun leurs avantages et sont mobilisés dans le cadre d’une négociation réfléchie, faisant appel à de larges réseaux curiaux mais également interurbains. Ces savoir-faire politiques et administratifs se transmettent au cours des années : une véritable accumulation d’expérience règlementaire se dessine à mesure que le consulat se dote d’outils et d’experts chargés de justifier ces pouvoirs et de fabriquer à la fois du droit et des technologies de gouvernement adaptées. La Ligue dès lors, malgré ses ambiguïtés, semble être une acmè dans cette autonomie, autant voulue que subie, du pouvoir municipal : le retour de Lyon sous l’autorité royale est en ce sens une rupture majeure, qui, si elle réorganise les institutions en profondeur, ne remet pourtant pas en cause la transmission des dispositifs règlementaires visant à assurer le bien public.
15/01/2021
L'industrie automobile française et la Russie de 1954 à 2014.
La thèse étudie les activités des entreprises automobiles françaises en Russie dans les années 1954 – 2014. Elle couvre deux périodes bien distinctes : soviétique et post-soviétique et montre une continuité́ dans la stratégie des constructeurs automobiles français sur le marché russe. L’étude couvre la coopération franco-russe dans le domaine automobile sous le prisme des relations tant économiques et politiques que technologiques entre les pays. Cette coopération résulte d’une volonté́ bilatérale de la part de la France et de l’Union soviétique d’élargir les champs de leur coopération et de s’engager dans des projets industriels à long terme. Il est possible ainsi de mettre en lumière l’importance du transfert de technologies réalisé dans le cadre des projets automobiles franco-russes. L’analyse du marché automobile russe permet de mesurer le rôle de la France dans le développement de l’industrie automobile soviétique puis russe.
2020
12/12/2020
L'harmonie du prince. Musique, sacré et pouvoirs dans les cours florentine et parisienne (v. 1560-v. 1610).
À partir d’une démarche transdisciplinaire, notamment entre histoire et musicologie, cette thèse interroge les usages politiques de la musique sacrée dans les cours de Florence et Paris entre 1560 et 1610. En suivant l’angle du spectacle musical, il s’agit de démontrer tout d’abord qu’apparaissent dans la période de nouvelles formes de spectacles musicaux dans les cours considérées, comme en attestent les écrits humanistes comme les réformes ecclésiastiques menées par les synodes et conciles provinciaux. Ces spectacles musicaux permettent de répondre aux crises religieuses et politiques que rencontrent les princes, notamment les rois de France, en constituant une représentation du pouvoir souverain moins dépendante des contraintes sacramentelles inhérentes à la liturgie. Dans un deuxième temps, il s’agit de retracer comment les princes se sont dans la période dotés des moyens de produire de tels spectacles musicaux servant à exalter leurs propres pouvoirs. À travers les organisations institutionnelles des chapelles et de la musique de cour, émerge ainsi une sécularisation de la musique sacrée servant les cérémoniaux princiers. Cette sécularisation repose notamment sur un processus de professionnalisation des musiciens, aux dépens de l’emprise des clercs sur la musique des cérémonies héritée du Moyen Âge. Enfin, ces spectacles musicaux instaurent un public soumis à un ordre inédit, en rupture par rapport à l’assemblée des fidèles des offices liturgiques chrétiens. Il s’agit d’étudier comment le public du spectacle musical est instauré, en insistant sur la fonction de discipline ambivalente du spectacle musical et de l’esthétique qui la soutient.
09/12/2020
Développement économique et enjeux géopolitiques : le cas des émirats arabes unis à travers l'exemple des trois îles d'Abou Moussa, de la Grande Tombe et de la Petite Tombe.
Cette recherche doctorale a pour objectif de montrer, en premier lieu, les différents efforts réalisés par les Émirats arabes unis pour le développement économique ainsi que les investissements de ce pays dans les différents domaines et leurs grands efforts déployés pour la préparation à la période post-pétrole. Ensuite, la thèse met en lumière les enjeux géopolitiques du contentieux territorial entre les Émirats arabes unis et l’Iran, ainsi que l’appartenance historique émirienne des trois îles d’Abu Moussa, de la Grande Tombe et la Petite Tombe ainsi que les tentatives pacifiques émiraties pour régler ce contingent. Aussi, la recherche s’intéresse à la menace iranienne et à son occupation des trois îles émiraties, puis à la recherche d’un terrain d’entente pour un règlement pacifique du conflit. Tout au long de ce travail et dans un objectif de compréhension du différend, l’importance économique et géostratégique des trois îles ont été approfondies.
05/12/2020
La galaxie Bochetel. Un clan de pouvoir au service de la couronne de France de Louis XII à Louis XIII.
Guillaume Bochetel, l’un des quatre premiers secrétaires d’État sous Henri II, par le jeu des alliances matrimoniales, s’attache à construire un clan familial, détenant les secrétariats d’État et dont les membres sont régulièrement chargés de missions diplomatiques, en Suisse, dans le Saint Empire, en Espagne et en Angleterre en particulier. Ce clan, composé de plusieurs familles alliées et où les liens du sang sont particulièrement importants, faisant naître entre ses membres une puissante solidarité, compte des hommes comme les secrétaires d’État Jacques Bourdin et Claude de L’Aubespine, des conseillers influents de Catherine de Médicis pendant les guerres de Religion, comme Sébastien de L’Aubespine ou Jean de Morvillier, ou encore des ambassadeurs comme Jean de Vulcob ou Michel de Castelnau. Ce clan déploie son pouvoir dans plusieurs directions, à la cour où ses membres sont des conseillers écoutés, à l’étranger avec les missions diplomatiques, et en province où des alliés se trouvent au premier rang de la notabilité. Il s’inscrit dans un temps long, entre le XVe siècle, qui voit certains membres de ces familles sortir progressivement du cadre de leur province d’origine, et passer de la notabilité locale au service du prince à la cour, à la fin du règne de Henri III qui, en 1588, congédie les secrétaires d’État qui étaient alors tous apparentés à ce clan. L’héritier de ce regroupement n’est autre que le puissant secrétaire d’État Villeroy, le premier en charge des Affaires étrangères à la fin du XVIe siècle, qui a fait ses premiers pas sous l’égide des L’Aubespine, dont il a épousé une héritière, Madeleine.
04/12/2020
De la puissance des femmes : réflexion autour de cinq personnages d'opéra créés par G. F. Handel pour Londres entre 1730 et 1737.
Le livret d’opéra est un support privilégié, mais trop souvent ignoré, pour sonder la psyché collective d’une époque et de sa société. À l’instar d’autres créations humaines, qu’elles soient purement intellectuelles et/ou manuelles, il s’apparente à une fenêtre ouvrant une perspective inédite sur un monde révolu et qui lorsqu’elle est ouverte laisse s’échapper les clameurs venues d’un autre siècle. Il s’agira donc de réinstaller les drammi per musica de George Frideric Handel dans leur contexte culturel et social. Ceci pour en restituer la réception la plus complète et fidèle possible et avoir une chance de s’approcher de l’expérience du public original. Face au mutisme des sources indirectes, il devient indispensable de se plonger au cœur des livrets, de s’intéresser aux mots et aux images, avant de donner la parole à la musique, en se donnant pour but d’expliciter tout ce que le texte implique, suggère, signifie, déclenche chez le spectateur.trice et tenter de reconstituer un corpus de références culturelles (littéraires, morales, religieuses, etc.), lesquelles colorent le texte de multiples et précieuses nuances, mais sont bien souvent perdus pour le public d’aujourd’hui. À travers cinq rôles féminins (Partenope, Berenice, Bradamante, Rosmira et Alcina), nous interrogerons la représentation de la femme et de la « féminité » à l’aune de la notion d’une puissance féminine et de ses implications sur la scène de l’opéra italien à Londres entre 1730 et 1737. Nous tenterons également d’apporter un éclairage supplémentaire sur cette période de transition dans la carrière du compositeur, lequel abandonne progressivement l’opéra italien pour se consacrer à l’oratorio anglais.
28/11/2020
A nous rebelles et désobéissantes. Louis XI et les villes en révolte.
Le règne de Louis XI est marqué par une cinquantaine de révoltes dans des bonnes villes du domaine royal, comme Reims, Bourges et Angers, et dans des villes récemment conquises par le roi, telles Arras, Beaune, Dole ou Perpignan. Ces soulèvements, qui se caractérisent par une grande diversité, rompent l’image d’une relation harmonieuse entre le roi et ses villes qui domine dans l’historiographie. Les contestations du pouvoir royal existent au sein des communautés urbaines, la révolte en étant la forme la plus visible et la plus violente. Le pouvoir royal en châtiant les insurrections, ou en les pardonnant, impose un récit qui est celui de l’obéissance due au souverain. Les révoltés sont criminalisés et leurs revendications sont tues par un discours royal qui qualifie le soulèvement de « rébellion et désobéissance ». Ce discours est mis en acte par une répression qui peut prendre des formes multiples. Louis XI élabore une politique répressive à large échelle dans laquelle le châtiment de la ville rebelle lui permet de renforcer son autorité dans le royaume et de construire sa souveraineté dans les territoires conquis par les armes (le Roussillon, les Bourgognes et l’Artois notamment). À l’échelle de la ville, la répression d’une révolte est l’occasion pour certains individus et certaines familles de s’élever socialement et politiquement en servant le prince et en jouant un rôle actif dans le processus de retour à l’ordre. Le roi a besoin de ces acteurs pour maintenir une obéissance que le pardon et la grâce ne garantissent nullement. Le pouvoir royal reste méfiant vis-à-vis des villes qui se sont révoltées car, au sein de ces dernières, la contestation demeure.

Tobias
BOESTAD
Sous la direction de

Jean-Marie Moeglin
Sorbonne Université
19/11/2020
« Pour le profit du commun marchand » - La genèse de la Hanse (XIIe siècle – milieu du XIVe siècle).
Si la communauté de villes commerciales connue sous le nom de Hanse allemande n’émerge qu’à partir de la seconde moitié du XIVe siècle, les marchands de l’Empire n’ont pas attendu cette époque pour s’associer sur les différents marchés qu’ils fréquentent en Europe du Nord. Dès la fin du XIIe siècle, de premières associations les regroupant sont attestées en Angleterre et dans l’espace baltique. Alors que l’organisation de ces groupements se complexifie et que leur influence politique s’accroît progressivement, au point de représenter bientôt les intérêts commerciaux de l’ensemble des villes de langue bas-allemande, la référence au « profit du commun marchand » se diffuse en leur sein, nourrissant une coopération durable. Cette étude vise à mettre en lumière les ressorts politiques de la solidarité entre marchands et villes allemandes, en accordant une attention toute particulière aux discours qu’elle suscite et à la valeur normative de ceux-ci. Elle entend ainsi renverser la perspective constitutionnaliste qui a longtemps caractérisé les études juridiques sur la Hanse, afin de mettre en évidence les mécanismes juridiques par lesquels les expériences politiques du XIIIe et du début du XIVe siècle ont donné naissance un régime inter municipal de prise de décision, doté de règles spécifiques et agissant suivant un système de principes et de valeurs propres. Après une présentation des principales étapes et charnières de la genèse de la Hanse, ce travail met au jour les ferments de la communauté hanséatique et enfin la manière dont certains de ses acteurs, notamment la ville de Lubeck, ont su transformer en principe juridique cette coopération politique et économique.
19/10/2020
La guerre est déclarée ! La mobilisation industrielle à Toulouse pendant la Première Guerre mondiale.
Entre 1914 et 1918, la mise en place de la mobilisation industrielle décrétée par le gouvernement de l’Union sacrée a profondément transformé Toulouse. Alors que la ville était restée à l’écart des mouvements d’industrialisation au XIXe siècle, les investissements publics importants consacrés à la production d’équipements militaires ont accéléré le développement de son industrie. Les acteurs de cette transformation ont cependant été mis à l’épreuve en raison des réquisitions de main-d’œuvre, des pénuries et de la hausse des prix. A la différence de l’Allemagne, les mouvements sociaux qui résultent de la dégradation du niveau de vie en 1917 n’ont pourtant pas remis en question le consensus autour de l’effort de guerre, ni à Toulouse, ni en France. La thèse étudie les raisons du succès de la mise en place de la mobilisation industrielle comme de sa réalisation. Elle montre que la France disposait d’un avantage institutionnel et qu’elle a pu s’appuyer sur son capital civique démocratique pour préserver le pacte politique de l’union patriotique. Le taux de croissance négatif de l’activité économique à Toulouse entre 1914 et 1918 rend compte du fait que l’effort de guerre a été largement supporté par les entreprises et les ouvriers. La capacité et l’action de l’Etat ont été renforcées par l’adhésion des populations au programme de l’Union sacrée.
2019
16/12/2019
L'autre Louvre : la Société du Louvre de 1855 à 1939.
Les Grands Magasins du Louvre naissent en 1855 à l’ombre du Grand Hôtel du Louvre, dans un quartier en expansion suite aux travaux de Haussmann, deux ans seulement après la création du Bon Marché. Leur création est fortement liée au projet et au réseau des frères Pereire qui souhaitent développer le commerce et le tourisme de luxe à Paris. Les Grands Magasins du Louvre s’imposent rapidement comme l’un des principaux grands magasins, voire le plus important par le chiffre d’affaires dans les années 1870-1880, ainsi que par l’espace occupé. En effet, d’abord enclavé par l’hôtel, le magasin conduit par ses deux gérants, Chauchard et Hériot, va engloutir toutes les boutiques environnantes, et s’emparer de l’hôtel en 1875. Ils adoptent ainsi le slogan les « plus vastes magasins du monde ». Ce premier pied dans l’hôtellerie va inciter ses dirigeants à poursuivre leur expansion dans ce domaine en exploitant trois hôtels supplémentaires : le Terminus Saint-Lazare, l’hôtel d’Orsay et le Crillon. Les Grands Magasins du Louvre seront donc le seul grand magasin à avoir investi dans un autre secteur que le commerce pour diversifier ses activités. A la fin du XIXe siècle, le magasin semble connaître son apogée étendant son influence sur le territoire national comme à l’étranger et s’approvisionnant en marchandises du monde entier. Mais la Première Guerre mondiale et surtout la crise économique des années 1930 lui portent un coup dur dont il ne se relèvera pas. En 1939, il dépose une première fois le bilan, avant que cette fermeture soit interrompue par la guerre. Il continuera à survivre après le Second conflit mondial, avant de disparaître définitivement en 1974.
03/12/2019
La Banque de Syrie et du Liban, levier de développement ou instrument de l'impérialisme français (1919-1949).
La Banque de Syrie et du Liban a été créée le 2 janvier 1919 par la Banque Impériale ottomane. Étant une banque commerciale, elle s’est vue attribuer, suite à la signature de la Convention du 23 janvier 1924 avec les États du Levant, le privilège de l’émission de la nouvelle livre libano-syrienne. Cette monnaie est rattachée directement au Franc français afin de faciliter le fonctionnement administratif de la France au Levant et le commerce avec la Métropole. Forte de cette position, la Banque n’a pas hésité d’exercer parallèlement son activité de banque commerciale et en tirer profit. Son activité principale est axée vers le crédit et les avances aux États du Levant et aux particuliers. En plus d’être l’agent financier des États du Levant, elle a été connue aussi pour être une banque de dépôt. Sa position d’une banque émettrice du billet local a inspiré confiance à la population locale pour y venir déposer leurs économies. Sa connaissance du territoire a poussé les capitaux français à s’allier avec elle pour l’exécution de leurs investissements au Levant. Tout au long de son existence, la BSL sera un acteur incontournable de la place financière en Orient. Son histoire est considérée comme indissociable de l’histoire économique du Levant et de la France.
29/11/2019
Entre l'aigle, les Lys et la tiare.
Les relations des cardinaux d'Este
avec le royaume de France (environ 1530 - environ 1590) :
entre diplomatie et affirmation de soi.
Ma recherche porte sur l’action diplomatique et religieuse des cardinaux d’Este et sur leur rôle de médiateurs entre l’Italie et la France. L’objectif est de faire apparaître les fondements géopolitiques de leur action, en prenant soin de faire ressortir les différentes échelles de leur action. L’emprise territoriale des cardinaux d’Este se manifeste, en effet, par l’existence de relais italiens et français. La présence d’Ippolito II d’Este et de Luigi d’Este est étudiée aussi bien sous l’angle de leur présence matérielle que sous celui de leur participation aux enjeux politiques du temps. La recherche s’inscrit à la croisée de plusieurs historiographies. Tout d’abord, elle cherche à affiner la connaissance de la sociologie des cardinaux au XVIe siècle. Ensuite, elle reprend les apports de l’histoire des relations internationales pour revenir sur le rôle des deux cardinaux d’Este comme supports de la couronne française à Rome et médiateurs pontificaux à la cour de France, et étudier leurs pratiques. Enfin, l’analyse vise à reprendre la catégorie d’humanisme chrétien, conceptualisée par Erasme, pour voir si elle constitue une ligne directrice de leur conduite religieuse. En prêtant attention à leur démarche sur la scène internationale, l’étude vise également à montrer que se dessine une identité catholique qui n’est pas hétérodoxe, mais s’insère bien dans la plus stricte orthodoxie confessionnelle. En revanche, la traversée des monts entraîne des réajustements sur le plan de l’expression et de la représentation de la foi.
28/11/2019
La part des femmes :
une lecture de la haute noblesse castillane au XVe siècle.
Cette thèse porte sur la question du gouvernement des femmes dans la Castille d’avant Isabelle la Catholique, se penchant sur un groupe n’ayant fait l’objet d’aucune étude approfondie : celui de la haute noblesse féminine, et plus précisément les épouses des hauts dignitaires à la cour des rois Trastamare au XVe siècle. Formulant l’hypothèse de l’existence au sein de ce milieu d’un ensemble de pratiques et de comportements communs, ce travail vise à analyser « la part des femmes » dans les mécanismes d’union et de transmission familiales. Au-delà des fonctions qui lui sont traditionnellement assignées telles que la médiation ou encore le mécénat religieux et culturel, la femme noble transmet et gère des terres, actrice à part entière des changements politiques, sociaux et économiques de son temps. L’étude de ce groupe d’épouses constitue un observatoire privilégié pour réévaluer le rôle de la femme noble, à la fois, à l’échelle de la sphère familiale, en proposant des éléments pouvant enrichir l’étude de la famille noble castillane mais aussi à l’échelle de la Castille, à travers l’examen de leurs interactions avec les acteurs du temps. En définitive, l’analyse s’emploie à livrer un autre portrait de la femme noble dans la Castille de la fin du Moyen Âge.
16/11/2019
L'espace du Palais.
Etude d'un enclos judiciaire parisien de 1670 à 1790.
Cette recherche est consacrée au Palais de Paris des années 1670 à 1790. Situé sur l’île de la Cité, le Palais est une ancienne résidence royale qui abrite un ensemble de bâtiments et de cours aux fonctions variées. Il se présente à la fois comme le quartier canonial de la Sainte Chapelle et comme un pôle artisanal et commercial tourné vers le demi-luxe. Il accueille également une collection de tribunaux dont certains de première importance, à commencer par le Parlement et la Chambre des Comptes. L’enjeu de notre thèse est de comprendre comment ces différentes fonctions coexistent, s’opposent ou coopèrent dans l’enclos juridique correspondant au ressort territorial du bailliage du Palais et comment ce territoire est investi par ses habitants et par l’ensemble des Parisiens. Notre approche, essentiellement spatiale, se fonde sur un corpus de plans, coupes et élévations qui a permis de procéder à des restitutions graphiques et cartographiques et d’apprécier les transformations architecturales tout au long du XVIIIe siècle. Elle s’appuie également sur le fonds du bailliage du Palais et celui du procureur général du Parlement. Nous envisageons la structuration interne des logements, des boutiques et des tribunaux (salles d’audience, salles du conseil, parquet, greffes, buvettes) ainsi que les points de contact entre les différentes juridictions (Grande Salle, Conciergerie). Il s’agit également d’insérer le Palais dans son contexte urbain en analysant la composition sociale et les pratiques propres à ce territoire. L’usage public du lieu implique des formes d’encadrement spécifiques et conduit au développement d’une culture singulière.
16/11/2019
Entre Venise et l’empire ottoman.
Administrer le contact en Méditerranée (1453-1517).
De la prise de Constantinople en 1453 à la conquête ottomane des territoires mamelouks en 1517, l’ordre géopolitique de la Méditerranée orientale connaît une reconfiguration rapide. Face à l’expansion ottomane accélérée dans le sud des Balkans, le Stato da Mar vénitien se renforce et croît légèrement. Il en résulte la constitution de frontières et de zones de contact nombreuses entre ces deux puissances inégales mais que réunissent des intérêts économiques ainsi que le souci politique d’administrer des provinces voisines. Étudier les contacts entre ces deux puissances dans ces décennies de transition ne signifie donc pas observer les rapports entre des blocs politiques homogènes, mais au contraire comprendre comment s’organisent les échanges et les circulations entre des territoires où l’autorité impériale s’exerce de façon différenciée. Cette recherche navigue entre capitales et provinces. De la Dalmatie jusqu’à l’est de la mer Égée, on repère en effet des formes de diplomatie frontalière, permises par la relative autonomie des autorités et des sociétés locales, ainsi que l’existence de stratégies pour s’adapter à la présence croissante des marchands ottomans. Derrière les promesses des capitulations se dessine ainsi une histoire politique et sociale des contacts dont la gestion se met en place à différentes échelles, par un système de co-administration appelé à une certaine pérennité, ce qui permet d’évaluer à quel point les connexions impériales transforment aussi les sociétés qu’elles concernent.

Isabelle
D'ARTAGNAN
Sous la direction de

Jean-Marie Moeglin
Sorbonne Université
16/11/2019
Le pilori au Moyen âge dans l'espace français.
Au cours du XIIe siècle, au cœur des villes du royaume de France rendues prospères par les développements des échanges commerciaux, apparaît un nouveau monument qui incarne l’autorité du haut justicier local et son emprise sur l’espace urbain. Ce poteau armorié, appelé dès l’origine « pilori », est certes un instrument pénal qui permet d’exposer les criminels à la vindicte populaire. Ses usages sont pourtant plus riches que sa fonction punitive. Le pilori est aussi un outil de prévention du scandale, une institution au service de la paix du marché, où il est implanté, ainsi qu’un symbole de l’état du rapport de forces entre les différentes juridictions urbaines. Alors qu’il est central dans le paysage urbain, l’étude de ce signe de justice a longtemps été délaissée par l’historiographie. Le renouveau continu de l’histoire de la justice médiévale depuis les années 1990 invite à l’analyser avec le même sérieux dont les fourches patibulaires ont récemment bénéficié. Pour rendre compte de la pluralité de facettes du pilori et de la peine qui porte son nom, nous avons privilégié une approche anthropologique, centrée sur les parcours des agents confrontés à ces objets juridiques. Cela nous a amené à explorer les stratégies discursives des juges et juristes qui ont contribué à l’invention du pilori, puis à sa rapide diffusion dans tout le royaume. Nous observons ensuite comment les sens et usages de la peine d’exposition évoluent à mesure que de nouvelles juridictions s’en emparent. En parallèle, nous décrivons la prise en charge du rituel d’exposition par le public, moment de refondation, autour du personnel de justice et aux dépens du condamné, d’une confiance commune. Enfin, une sociographie des condamnés au pilori débouche sur une réflexion plus large visant à brosser le devenir des infâmes dans la société médiévale.
28/09/2019
A la croisée des temps :
François II roi de France et la crise des années 1559-1560.
Cette thèse étudie les modalités et les conséquences politiques de la crise qui ébranle l’autorité royale française durant le très court règne du jeune François II et fait basculer le royaume dans le temps des troubles de religion. Dans le contexte de la fin des guerres d’Italie et après la tragique mort d’Henri II, l’avènement d’un roi âgé de quinze ans refusant le pouvoir qui lui revient, déclenche une contestation politique inédite dans la France du XVIe siècle. La situation s’envenime d’autant plus pour l’autorité monarchique que le gouvernement royal, conduit par les Guise, oncles du roi, répond par une sévère répression antihérétique au succès de la Réforme protestante. En mars 1560, la conjuration manquée d’Amboise révèle au pouvoir l’ampleur et l’imbrication de ces mécontentements à la fois politiques et religieux. Autour d’acteurs aussi essentiels pour la France du XVIe siècle que Catherine de Médicis, le cardinal de Lorraine ou Michel de l’Hospital, un processus d’inflexion politique majeure s’initie alors : le pouvoir opte pour une modération religieuse et une politique d’apaisement qu’il s’efforce d’ajuster à la « nécessité des temps » autant qu’à l’accélération des élans catholiques et protestants. Si le règne de François II ouvre le temps des troubles civils, il ouvre donc aussi celui des tentatives et des expérimentations politiques dont les édits des guerres de Religion seront les héritiers. Appuyé sur une fine analyse de l’enchaînement événementiel, le présent travail s’efforce de révéler la complexité de ce règne « à la croisée des temps » autant que son caractère décisif pour la réflexion politique du second XVIe siècle français.
14/09/2019
A l'ombre d'Angkor,
l'action des militaires français au Cambodge, 1863-1954.
Sous l’ombre tutélaire des temples d’Angkor, les militaires français ont marqué de leur empreinte toute l’histoire du protectorat français au Cambodge. Nous avons décliné cette action sous trois aspects. Une action politique et diplomatique qui engerbe les problématiques liées au contexte cambodgien mais aussi celles des grands équilibres régionaux et internationaux. L’étude s’attache à discerner ce qui tient de l’engagement personnel des militaires et ce qui se réfère aux engagements politiques et diplomatiques du gouvernement français. Une action militaire qui a pour but de pacifier le Cambodge, de sauvegarder les intérêts français puis d’éviter l’invasion du pays par les forces communistes. Les méthodes et l’efficacité de l’outil militaire français dans ce contexte sont particulièrement analysées. Enfin, il s’agit d’analyser l’action des « militaires sans armes » : explorateurs, archéologues, ethnologues, écrivains etc., qui consolident le rôle de la France dans la reconstruction de l’identité khmère et affirment sa présence en Indochine. Une analyse prosopographique tente de discerner, pour chacun des militaires concernés, l’action qui peut s’expliquer comme une quête personnelle, voire intime, et celle qui tient de sa mission ou de l’œuvre collective. La nature du protectorat créé par les militaires français puis son évolution vers un modèle tendant à s’adapter aux invariants khmers et au contexte politique français est au cœur de cette étude. L’outil militaire français au Cambodge se dévoile ainsi à travers sa structuration, son fonctionnement et ses métamorphoses créant une situation coloniale singulière entre la France et le Cambodge.
25/01/2019
Les Salaberry entre deux empires : l’adaptation d’une famille de la noblesse canadienne-française sous le régime anglais.
Le milieu du XVIIIe siècle marque une césure dans l’histoire du Canada. Après deux siècles de présence française, le pays passe sous domination anglaise à l’issue de la guerre de Sept Ans qui entraîne la fin de la Nouvelle-France. Ce changement de domination génère des bouleversements structurels dans le paysage social du pays, touchant particulièrement les élites, dont la plupart étaient officiers militaires chargés du maintien de l’ordre et de la domination sur le territoire et représentants du pouvoir royal gérant les structures et l’encadrement politique. Souvent nobles, elles offraient un code de conduite et un modèle culturel indéniable. La perte de la position centrale qu’elles occupaient dans la société canadienne pose la question de leur adaptation sous le régime anglais, étudiée au travers de l’exemple de la famille Salaberry. Cette famille, affiliée à la noblesse, proche du prince anglais Édouard duc de Kent, compte dans ses rangs un héros d’une bataille durant la guerre de 1812-1815 et présente un profil atypique. Cette étude, menée à partir des documents personnels dont une importante correspondance et de nombreux documents notariés, permet d’entrer dans l’intimité d’une famille de la noblesse canadienne-française du tournant du XIXe siècle, d’en dégager les comportements familiaux et sociaux ainsi que leurs évolutions, mais aussi d’étudier l’adaptation politique et professionnelle par la participation au fonctionnement du nouveau régime et l’acculturation du point de vue linguistique mais aussi religieux des élites sous les premières décennies du régime anglais au Québec.
24/01/2019
L'histoire du Brésil aux Etats-Unis et ses historiens, 1958-1985.
Cette étude analyse le contexte historique dans lequel l’étude de l’histoire du Brésil a émergé dans les universités américaines entre 1958 et 1985. L’expansion de la discipline reflétait alors les préoccupations nées de la Guerre froide aux États-Unis. Dans ces circonstances, l’appui institutionnel, les fonds fédéraux et privés ont joué un rôle important dans la recherche des Brazilianists, favorisant son développement académique comme spécialisation à part entière. Le terme de Brazilianist désigne seulement aux États-Unis un spécialiste de l’histoire brésilienne alors qu’au Brésil, il est connoté politiquement. S’il est vrai qu’une partie de la recherche des Brazilianists était policy-oriented et qu’ils bénéficiaient de davantage de soutien institutionnel ou d’opportunités de recherche que leurs homologues brésiliens, notamment pendant les anos de chumbo, quand ces derniers subirent le joug de la dictature militaire, on ne peut se limiter à une vision réductrice de leurs travaux. L’étude des parcours individuels fait apparaître une histoire bien plus nuancée, permettant d’évaluer leurs motivations et les échanges qu’ils ont pu avoir avec les intellectuels brésiliens et le degré de réception de leurs travaux au Brésil ; nous pouvons ainsi dépasser les polémiques en soulignant l’importance des liens tissés entre eux et le monde savant brésilien, leur apport scientifique, leur rôle dans l’institutionnalisation de la discipline aux États-Unis et la professionnalisation de l’histoire au Brésil.
10/01/2019
Les relations économiques et financières entre la France et le Pérou : Diplomatie économique, coopération technique et stratégies des firmes françaises (1945-1975).
La Seconde Guerre mondiale avait complétement interrompu les échanges entre la France et le Pérou. En revanche, au cours des Trente Glorieuses, la France réussit à rétablir une position appréciable au sein de l’économie péruvienne. Grâce à une diplomatie économique active et un engagement diversifié des entreprises privées et publiques, la France devint un partenaire notable de la coopération technique. Ce pays joua un rôle important dans les programmes d’industrialisation et de modernisation du Pérou. Cette thèse s’interroge sur l’évolution et la structure des relations économiques franco-péruviennes entre 1945 et 1975. L’étude se penche sur les échanges commerciaux ainsi que sur les domaines des échanges financiers, de l’industrie et de la coopération technique, combinant des analyses macro et micro-économiques. Il s’agira d’analyser les stratégies et performances des entreprises françaises au sein des grands projets au Pérou en considérant les succès et les limites de leurs engagements. Ainsi, la thèse présente une étude nuancée à propos d’un sujet jamais étudié auparavant et cherche à contribuer d’une manière novatrice aux recherches sur l’histoire des relations entre l’Europe et les pays latino-américains ainsi que sur les rapports Nord-Sud.
2018
18/12/2018
La compétition automobile comme enjeu opérationnel pour l’entreprise publique française : les relations entre la Régie Renault et le secteur pétrolier d’État de 1959 à 1982
L’objet de la thèse est de traiter de la compétition automobile comme enjeu opérationnel pour l’entreprise publique française. Elle montre la part respective des impératifs de recherche-développement, de parrainage, puis sponsoring, de recherche d’une image de marque, de marketing et de maximisation des ventes. Elle démontre le rôle moteur des pétroliers, Shell-Berre d’abord, puis, sous l’impulsion gaullienne représentée par Pierre Guillaumat, le groupe Elf ERAP, dont ce dernier était le PDG. Ce ne fut qu’à partir de l’arrivée de Bernard Hanon, directeur général, puis PDG, au début des années 1980, que la Régie Renault prit le leadership en ce domaine. En effet, sous la pression de la crise de l’énergie et de l’opinion, Elf Aquitaine, dirigée par Albin Chalendon, s’éloigna de la compétition automobile au profit de la voile.
19/11/2018
La mondialisation de la compagnie Brésilienne Vale, 2002-2010
L’internationalisation des entreprises des pays en développement est une caractéristique de la mondialisation contemporaine. Inversant la tendance des flux de capitaux, ces derniers représentent ce que le Boston Consulting Group appelle les global challengers: «un groupe de challengers émergents qui deviennent des acteurs importants à la fois dans les pays développés et en voie de développement à travers le monde.» Cette thèse examine le cas de l’un de ces global challengers: la compagnie minière brésilienne Vale. Après l’acquisition du géant minier canadien Inco en 2006, Vale fit un bond en avant en passant de la sixième à la deuxième position parmi les producteurs miniers mondiaux. Une évolution aussi drastique suscite un certain nombre d’interrogations. Quelles raisons ont conduit cette compagnie émergente inconnue à s’aventurer dans un environnement international? Quel a été le succès de Vale dans cette entreprise? Et enfin: quels sont les effets de l’internationalisation de Vale sur l’économie brésilienne? Fondée par l’État en 1942, Vale est à la base de la filière sidérurgique qui est au cœur du développement économique du Brésil. Dans le même temps, Vale est contrainte à rechercher de marchés à l’étranger. Après sa privatisation en 1997, l’entreprise s’est fixé l’objectif de devenir un acteur global doté d’un plan agressif d’acquisitions nationales et internationales. Vale élargit sa présence internationale et son portefeuille de produits. Néanmoins, cette ambition internationale n’est pas complètement réalisée. En 2010, Vale doit composer avec l’ingérence du pouvoir politique au Brésil et le coût de faire des affaires pour une entreprise brésilienne.
27/09/2018
La planification française comme instrument de politique industrielle de la Libération au milieu de la présidence du Général de Gaulle (1945-1965)
Immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, sous l’impulsion du Général de Gaulle et de Jean Monnet, le Gouvernement provisoire de la République française décida d’engager dans le système capitaliste français une politique économique à moyen terme désignée par le terme de « planification ». Le Plan, en tant qu’outil d’élaboration et de mise en œuvre de politiques industrielles, dirigea l’industrie française pour qu’elle puisse se développer et s’adapter aux différentes circonstances. Quatre plans furent successivement mis en œuvre dès la Libération jusqu’en 1965 par le Commissariat Général du Plan (CGP) sous la direction successive de trois commissaires généraux du Plan, à savoir Jean Monnet, Etienne Hirsch, Pierre Massé. Dans ce laps de temps furent lancés les plans suivants : Plan Pinay-Rueff, Plan intérimaire, Plan d’adaptation des charbonnages, Plan de stabilisation. Imbriquée de multiples manières à une « expansion industrielle », la planification française réussit à transformer la France rurale en une société industrielle et à faire passer l’industrie française de la situation fermée et protégée à la confrontation de la concurrence internationale. Elle joua aussi un rôle important dans le mode de rapport entre le secteur public et privé et en particulier, le fonctionnement des entreprises nationales. À plus long terme, c’était encore au Plan que revenait le mérite de tracer les lignes d’un harmonieux développement des régions françaises, surtout de l’aménagement du territoire.
25/06/2018
Entre princes et marchands : les agents généraux de France à Madrid dans les interstices de la diplomatie (1702-1793)
Entre 1702 et 1793, onze hommes occupèrent la fonction d’agent général de la Marine et du Commerce de France à Madrid. Agissant sans statut officiel, ces envoyés du secrétaire d’État de la Marine étaient la pièce maîtresse d’un réseau d’information français en Espagne. Créés après l’avènement du Bourbon Philippe V au trône d’Espagne, ces experts, clé de voûte du réseau consulaire français dans la Péninsule, mirent leur compétence économique au service d’un rapprochement commercial entre les deux monarchies. Par leur action, leur surface sociale, leur connaissance de l’Espagne et leurs discours, ces intermédiaires s’appropriaient une fonction aux contours obscurs. Hommes de l’ombre sous les ordres de l’ambassadeur français, ils acquirent une dimension qui en fit les véritables artisans d’une diplomatie commerciale franco-espagnole au XVIIIe siècle. Ces instances de dialogue interrogent les interactions croissantes entre commerce et diplomatie. L’étude tend à montrer en quoi ces figures hybrides se situaient à l’interface entre plusieurs mondes : la France et l’Espagne d’une part, le négoce et la sphère politique d’autre part. Informateurs, négociateurs et médiateurs, ces agents interrogent le cheminement qui conduisait de l’information à la négociation. Il s’agit de montrer en quoi ces hommes, acteurs de l’interconnexion des deux monarchies, dessinaient les contours d’un espace de dialogue spécifique qui visait à combler les interstices entre les réalités du terrain et la discussion entre gouvernements.
03/05/2018
Total. Comment associer responsabilité sociale de l'entreprise et réussite économique de l'entreprise (1946-2003)
Fondée en 1924, la Compagnie Française des Pétroles n’est encore qu’une société pétrolière de taille modeste au sortir de la deuxième guerre mondiale. En 2003, après avoir racheté Fina puis Elf, la désormais nommée Total SA rassemble près de 100 000 salariés, est présente dans toutes les grandes régions pétrolières mondiales et se considère comme une entreprise qui fournit de l’énergie et non plus seulement du pétrole. La thèse étudie cette identité de groupe, à travers les patrons, les salariés et les clients de Total. Comment les patrons successifs ont-ils conduit leur entreprise, quelle culture ont-ils voulu forger ? Quelle politique salariale est menée, dans le domaine de la formation, de la participation et de la subsidiarité ? Comment les clients sont-ils attachés à la marque Total et fidélisés ? Cette dernière question permet d’aborder le rapport de la société française au pétrole et à la voiture. Total groupe mondial n’est pas seulement un fournisseur d’énergie. L’entreprise pense et conceptualise sa responsabilité sociale et environnementale. En miroir de cette implication sociale, Total est aussi attaquée, voire décriée, pour un laxisme environnemental et pour des bénéfices mal redistribués. L’entreprise réagit de façon chaotique à ces accusations. La thèse s’interroge à ce titre sur le rapport affectif que les Français entretiennent avec le fleuron industriel de leur pays, et sur la façon dont ce fleuron essaye de valoriser son image de marque. C’est cette histoire d’hommes, de pétrole, d’identité et de culture, qui est le fil directeur de notre recherche. À travers le cas de Total, la thèse conduit donc une réflexion sur le capitalisme industriel comme acteur économique et social dans notre pays.
07/04/2018
Dans l’orbite de la capitale : les justices seigneuriales des environs de Paris et le crime, du règne personnel de Louis XIV à l’aube de la Révolution
Entre 1670 et 1789, des évolutions se produisirent dans les environs de Paris, comme l’extension du bâti depuis la ville et de nouvelles manières de se déplacer pour les habitants. Dans le même temps, le cadre judiciaire resta fixe, celui des tribunaux seigneuriaux issus du Moyen Âge. De même, l’Ordonnance criminelle de 1670, véritable code de procédure pénale, fut pendant ce long siècle la grammaire des interactions entre individus devant les tribunaux. Par conséquent, notamment avec ces documents judiciaires, il est possible d’écrire l’histoire des relations entre les personnes qui entrèrent dans l’orbite de la capitale.
25/03/2018
Le pari de l’Hérétique. Les prélats royalistes et la légitimation d’Henri IV
Cette recherche interroge la monarchie française en situation de crise en partant d’un pari politique hors norme, celui des prélats catholiques qui misèrent sur Henri IV, roi protestant. Elle étudie les diverses facettes de l’action politique de ces hommes et reconstruit les mécanismes de leur travail de légitimation du premier Bourbon, en privilégiant les premières années du règne. Centrer l’enquête sur ces années permet de restituer à cette période sa dimension d’incertitude vécue par les acteurs de la monarchie, qui se trouve généralement écrasée par le poids de l’histoire de la pacification, après l’édit de Nantes. Ce choix d’un temps court rend possible l’étude attentive des cérémonies possédant une grande importance symbolique, tels que l’abjuration et le sacre royaux. Trop souvent ces événements sont uniquement décrits, racontés par l’historiographie. L’analyse proposée ici s’attache à l’inverse à leur redonner leur dimension problématique, à réfléchir sur les choix stratégiques faits par le pouvoir, notamment en ce qui concerne leur publication, comme une seconde mise en scène, imprimée. En adoptant un angle d’observation centré sur l’engagement, tantôt exposé, tantôt discret du groupe de prélats (Jacques du Perron, Claude d’Angennes et leurs pairs), il devient possible d’appréhender la monarchie en tant qu’œuvre collective d’acteurs multiples qui agissent pour assurer sa survie. En proposant ainsi une alternative à la vision navarro-centrée qui domine largement l’historiographie, cette approche permet d’aborder d’une nouvelle façon la sortie des guerres de Religion et de révéler des acteurs peu connus, qui néanmoins jouent un rôle crucial dans ce processus.
2017
16/12/2017
Représenter la France à la cour des tsarines. Les deux ambassades de Joachim-Jacques de La Chétardie de 1739 à 1744
Le marquis de La Chétardie est le premier envoyé de la France en Russie à être revêtu du caractère d’ambassadeur. Cet honneur, naguère refusé à Pierre le Grand, a été accordé à sa nièce Anna, quoique ce fût au décours du premier conflit armé entre les deux pays. Son séjour à Petersbourg révéla ses qualités mais aussi ses limites ; en effet, ce courtisan achevé, courtois, expert en conversation et en réceptions mondaines, obsédé par un cérémonial pointilleux, a raté toutes les entreprises qu’il avait envisagées. A l’opposé, certaines de ses initiatives lui ont valu des désaveux. Impliqué modérément dans le coup d’État qui mit Élisabeth sur le trône, il ne profita pas longtemps de la faveur acquise à cette occasion. Il avait mal estimé les ressources des belligérants russes et suédois ; quelques maladresses, dont son gouvernement portait plus que lui la responsabilité, associées à la xénophobie exacerbée des Russes, suffirent à transformer le favori en paria ; il se vit refuser par la souveraine la médiation initialement promise dans le conflit en cours, et dut solliciter son rappel. Revenu en France, il y élabora un projet, qui fit long feu, d’alliance franco-russo-suédoise, qui devait remplacer le système des « barrières », sacrifier la Pologne et bouleverser le système établi. Son second séjour fut funeste et bref, son combat contre le vice-chancelier Bestoutcheff ne pouvant se terminer que par la chute de l’un d’eux. Ce fut lui qui fut expulsé, ayant péché par excès de confiance dans son chiffre. Ainsi, la première ambassade de France en Russie se terminait-elle dans la confusion ; La Chétardie, malgré sa séduction, avait échoué dans sa mission et dans ses grands projets.
15/12/2017
L'arche de l'opinion : politique et jugement public au Portugal aux Temps Modernes (1580-1668)
Le but de cette recherche est d’analyser le rôle politique des opinions collectives au Portugal aux Temps Modernes. Bien avant l’avènement du concept d’« opinion publique », plusieurs sources renvoient à un jugement « public », « commun » ou « général », associé fréquemment à l’idée de Fama. La présente thèse étudie l’élargissement du débat public portugais dans un contexte marqué par une intense agitation populaire et par le développement de conceptions radicales du patriotisme et de la liberté.
06/12/2017
Mobiliser l’industrie textile (laine et coton). L’État, les entrepreneurs et les ouvriers dans l’effort de guerre, 1914-1920
Au cours de la Première Guerre mondiale, les industries de la laine et du coton se retrouvent entraînées dans la mobilisation industrielle. L’intervention de l’État dans ces branches se révèle indispensable, et une nouvelle relation s’établit entre la puissance publique et les entreprises. La modification de la teinte de l’uniforme, sa large diffusion à près de huit millions d’appelés sur quatre ans et la perte des bassins industriels du Nord et de l’Est conduisent à la mise sous contrôle de l’État de presque toute l’industrie lainière, tandis que l’industrie cotonnière reste indépendante jusqu’en 1917. Cette relation s’étend jusque dans les importations de matières premières, avec une centralisation progressive qui exclut le commerce privé, mais associe négociants et industriels. En outre, la gestion de la main-d’œuvre constitue un défi quotidien pour les entreprises. Le besoin de travailleurs reste important, et les difficultés liées aux conditions de travail et au renchérissement de la vie entraînent des tensions sociales, malgré l’Union sacrée observée par les organisations syndicales. Dans le même temps, la perte des principaux territoires industriels représente une aubaine pour les autres régions, dont celles dont l’industrie textile est sur le déclin avant la guerre. Les fortes demandes de l’armée et les hauts prix du commerce privé entraînent des bénéfices importants, et conduisent l’État à adopter une fiscalité de guerre et réprimer les abus. Le retour des industries sinistrées à la fin du conflit, la question des dommages de guerre et la réintégration de l’Alsace-Lorraine mettent les industries textiles face à des changements radicaux.
25/11/2017
Les Combats de Carnaval et Réformation. De l’instrumentalisation à l’interdiction du carnaval dans les Eglises luthériennes du Saint-Empire au XVIe siècle
Dans le siècle de la Réformation, des guerres de religion, et de la confessionnalisation, le carnaval n’est pas resté un élément anodin, en dehors des conflits et des recompositions qui se mettaient en place. L’investissement originel de cette fête par Luther et les siens n’a pourtant pas conduit à une alliance heureuse avec le protestantisme. Que s’est-il passé d’une borne à l’autre du siècle ? Dans quelle mesure la rupture religieuse s’est-elle accompagnée d’une rupture culturelle vis-à-vis du carnaval ? L’interdiction progressive du carnaval a-t-elle fait consensus, témoignant d’un ethos luthérien particulier ? De pamphlets en traités, d’ordonnances religieuses en prédication, l’enquête menée ici révèle le questionnement continuel des clercs sur la nature du carnaval et en dit long sur sa complexité et le désarroi des contemporains : s’agit-il d’un rite agraire, d’une survivance des fêtes païennes, ou plutôt d’une coutume catholique ? Ce livre restitue ainsi un jalon manquant de l’histoire du carnaval et dessine une anthropologie du corps et du rire dans le monde protestant. À travers les questions du langage polémique, du rituel, ou de la discipline, il permet de réviser les relations complexes entre christianisme, rire et sérieux, mais aussi les opérations de différenciation entre confessions, et met au jour une période décisive avant que se fige le topos d’une fête païenne et révolutionnaire.
10/11/2017
Reform and Its Limits: The Belisaire Affair and the Politics of Religious Toleration in Enlightenment France
En 1767 Jean-François Marmontel publia Bélisaire, conte philosophique recelant une plaidoirie pour la tolérance civile en matière de religion et un christianisme miséricordieux aux accents déistes. Livre à succès, Bélisaire n’eut pas que des admirateurs : son soutien pour la tolérance et sa nouvelle vision du salut lui valurent une opposition vive de l’Église, surtout de la faculté de théologie de Paris qui projeta d’en faire une Censure. Or celle-ci déplut au gouvernement, qui très vite s’en mêla. L’historiographie n’ignore pas l’affaire : ses spécialistes, John Renwick et Robert Granderoute ont publié respectivement deux articles et une préface à son sujet. Mais, malgré la qualité de ces travaux, de larges pans de l’affaire restent inconnus. Grâce à des sources neuves, il ressort : (1) que l’avocat général du Parlement de Paris, Jean-Omer Joly de Fleury, profita de l’affaire pour écrire lui-même une nouvelle théologie de la tolérance compatible avec le Catholicisme et (2) que le gouvernement censura la Censure, réécrivant son 4e article qui louait trop vivement l’intolérance civile, qui était certes la politique du roi, mais qu’il se réservait le droit de modifier. Cette étude lève ainsi le voile sur le travail de magistrats et ministres qui cherchaient à défendre l’Église, soutien de la monarchie, tout en la modernisant. Elle montre aussi les paradoxes des réformes manquées : la théologie de la tolérance, pourtant riche, ne servit jamais à modifier la loi. Cette affaire mobilisa de grands commis de l’État, dynamiques et dévoués, mais la monarchie peina à appliquer leurs idées. Ainsi n’opéra-t-elle pas de nouvelle synthèse religieuse, comme elle avait pu le faire par le passé, suivant l’analyse de Dale Van Kley.
03/07/2017
Lumières françaises et culture croate à la fin du XVIIIe siècle : La réception du Bélisaire de Marmontel
C’est en 1767 que Jean-François Marmontel (1723-1799) publie son Bélisaire. Plus un traité socio-philosophique, miroir de son siècle, qu’un roman d’aventure, le Bélisaire de Marmontel retentira immédiatement dans la société de son temps et connaîtra une postérité fructueuse. En regroupant les idées clés de l’époque telles liberté de la pensée religieuse, tolérance civile (son point le plus vivement contesté par la critique et le plus ardemment défendu par son auteur), étendue de l’autorité royale, réforme souhaitée des systèmes fiscaux ainsi que des institutions de la vie civile…, l’ouvrage de Marmontel s’acquiert une importante popularité, son auteur ayant en plus remporté la victoire contre la Faculté de théologie de Paris. Il faut signaler également que le thème historique du vieux général byzantin n’est pas étranger à la littérature européenne antérieure à l’époque des Lumières françaises mais, là, ce sujet reste plutôt historique, sans l’attirail de la pensée novatrice dont Marmontel va le doter. Ainsi, parmi de tels ouvrages l’on range également le drame du Ragusain Antun Gledjević « Bélisaire ou Elpidie ». Cependant, c’est la trame idéologique du roman de Marmontel qui conduit le croate Michael Horvath (1733-1810), prêtre originaire de la région autrichienne de Burgenland, à publier à Vienne – très probablement en 1772 – une adaptation en langue latine du roman français. Une autre version latine (remaniement de la première édition) verra le jour en 1806 par les soins du libraire viennois, Aloysius Doll.
01/07/2017
Construire une relation pacifiée. Les ministres de France à Bruxelles dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Pratiques et réseaux
Des relations entre la France et les Pays-Bas méridionaux, l’histoire a surtout gardé le souvenir des affrontements et de la soif de conquête. Le renversement des alliances de 1756 met fin à ce voisinage conflictuel. Cette alliance inédite amène Louis XV et Marie-Thérèse d’Autriche à pacifier leurs rapports. L’objectif de cette thèse est d’examiner comment la mise en place et le maintien de cette paix se concrétisent entre la France et les Pays-Bas, qui dépendent de Vienne depuis le traité d’Utrecht (1713). Ce sont près de deux générations des populations de ces pays qui vivent une rare période de paix. La première partie du travail porte sur la signification diplomatique et politique de l’envoi de ministres à Bruxelles – au cœur d’un territoire qui n’est pas souverain. En analysant les formes de la représentation diplomatique et la mission de ces envoyés, c’est la question des provinces belgiques comme lieu et enjeu des relations internationales qui est posée. La seconde partie s’intéresse aux hommes et aux femmes au cœur de ces relations, aux ressources qu’ils mettent en œuvre, c’est-à-dire leurs pratiques et les réseaux qu’ils forment. Dans le contexte de relations transfrontalières, l’accent est mis sur l’intervention de personnes variées, parfois éloignées des cercles et des lieux de pouvoir.
10/06/2017
Physiocratie, saint-simonisme, agrarisme, à travers la famille Petit
La découverte du fonds Petit aux Archives départementales de l’Indre a permis de suivre une famille adepte successivement de trois théories économiques du XVIIIe et du XIXe siècle : la physiocratie, le saint-simonisme et l’agrarisme. Mme Nicolas Petit, par son achat massif de terres et sa philosophie humanitaire, son fils Alexis Petit par son militantisme saint-simonien et son petit-fils Paul Petit par son appartenance efficace à l’agrarisme sont les exemples du passage entre ces trois mouvements. Les dossiers contenus dans les Archives départementales de l’Indre permettent également de suivre le parcours saint-simonien d’Alexis Petit, proche de Prosper Enfantin qu’il accompagna en Égypte à la recherche des vestiges du Canal de Suez. Alexis Petit tentera une expérience de ferme industrielle communautaire dans les vues saint-simoniennes. Paul Petit sera un militant agrarien, secrétaire de la Société d’agriculture de l’Indre. Cette thèse a pour but d’exploiter les nombreuses données sur le saint-simonisme à travers les correspondances inédites et à travers les documents que contiennent les Archives départementales de l’Indre et de donner une version nouvelle de ce mouvement. Son but est également de démontrer que Saint-Simon et les saint-simoniens sont un chaînon notable de la transmission entre la physiocratie et l’agrarisme.
03/06/2017
Poliet et Chausson (1901-1971). Ascension et déclin d'une grande entreprise cimentière française
L’industrie cimentière française possède une influence internationale considérable. L’entreprise Lafarge est aujourd’hui le numéro un mondial du ciment. Ses concurrents français sont tout aussi performants. On peut citer Vicat, entreprise familiale, ou la société Ciment Français, filiale du groupe Heidelberg-Italcementi. Ciments Français est une entreprise héritière du groupe Poliet et Chausson. En 1971, suite au rachat de la branche cimentière de Poliet et Chausson par Ciments Français, les départements des ciments des deux groupes fusionnent. Puis, Poliet et Chausson est transformée en société holding de distribution de matériaux de construction sous le nom de Poliet S.A. Elle est rachetée par Saint Gobain en 1996 et son nom disparaît. La firme a pourtant été la première entreprise française de ciment en 1930. C’est la monographie de cette entreprise que s’attache à retranscrire cette thèse. L’histoire de Poliet et Chausson au cours du XXe siècle est tortueuse. Par un effet d’aubaine, cette entreprise parisienne de matériaux de construction, profite de l’invention du marché du ciment pour devenir l’un des plus grands producteurs de ciment français au cours des années 1930. Sa trajectoire est parallèle à celle de l’entreprise Lafarge. Elle en diffère cependant par bien des points. Émaillée d’embûches, elle oscille entre des moments de succès considérables et des périodes plus troublées. Entre industrialisation et désindustrialisation, l’histoire de Poliet et Chausson s’écrit dans l’ombre de son concurrent plus brillant, Lafarge. Comment expliquer la réussite de l’un et la disparition de l’autre ?

Raphaël
CHERIAU
Sous la direction de

Olivier Grenouilleau
Sorbonne Université
01/06/2017
« L’intervention d’humanité » ou le droit d’ingérence pour raisons humanitaires dans les relations internationales : Zanzibar, le Royaume-Uni et la France, entre expansion coloniale et lutte contre la traite du milieu du XIXe siècle au début des années 1900
Dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle, le Sultanat de Zanzibar a été au cœur des politiques abolitionnistes et coloniales aussi bien françaises que britanniques. En effet, l’île de Zanzibar ne fut pas seulement le plus grand marché aux esclaves de l’océan Indien mais aussi la porte d’entrée privilégiée des trafiquants d’esclaves, des abolitionnistes, et des partisans de la colonisation en Afrique Orientale. Cette thèse s’intéresse aux controverses, ayant opposé la France et la Grande-Bretagne dans les eaux territoriales de Zanzibar, sur le droit de visite des bateaux transportant des esclaves ainsi que sur le droit des boutres à battre pavillon français et à échapper ainsi aux contrôles de la Royal Navy. Cette recherche souligne combien ces questions furent importantes, non seulement pour les relations de la France, de la Grande-Bretagne et du Sultanat de Zanzibar, mais aussi pour le droit international et les relations internationales jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale. Ce travail montre que les opérations de lutte contre la traite qui ont eu lieu à Zanzibar ont inspiré de nombreux officiers de marine, des consuls, des diplomates, des juristes, et des hommes politiques, aussi bien français que britanniques, quant à la conception et à la mise en œuvre « d’interventions humanitaires ». Ainsi l’histoire des opérations de lutte contre la traite menées dans le sultanat de Zanzibar permet d’éclairer de manière originale l’histoire du concept d’intervention humanitaire ou « d’humanité » (« intervention in the score of humanity »). Cette recherche souligne combien la nature de ces interventions humanitaires a sans cesse oscillé entre de véritables idéaux abolitionnistes et des enjeux coloniaux pressants.
01/04/2017
Pouvoir, présence et actions de femmes : les épouses des ministres au temps de Louis XIV
« Pouvoir, présence et action » : chacune de ces trois notions renvoie à la capacité d’un individu à entreprendre. Cette capacité d’action des femmes est particulièrement encadrée dans la France d’Ancien Régime, autant par les normes juridiques que par les représentations mentales qui affirment l’inégalité entre les sexes et la supériorité des hommes. Le présent travail a pour buts l’examen des limites de la subordination féminine et l’affirmation de la possibilité d’action des femmes, dans le cadre d’une étude globale consacrée aux épouses des ministres au temps de Louis XIV. Les spécificités du groupe d’étude fondent l’essence de la réflexion : il s’agit d’analyser la possibilité d’action de femmes de la noblesse dans la France du XVIIe siècle, dans le cadre spécifique de mariages les unissant à des hommes exerçant une fonction de type ministériel lors du règne personnel de Louis XIV. Il s’agit donc d’analyser les conditions d’un pouvoir conjugal, familial et social au féminin, puis de définir les domaines dans lesquels les épouses des ministres apparaissent en tant qu’actrices. L’étude vise également à observer les attitudes des couples ministériels afin de déterminer des invariants permettant de comprendre ce que signifie être l’épouse d’un ministre au temps de Louis XIV. L’ancrage historique, juridique, économique, familial et social de ces femmes constitue un sujet d’analyse essentiel pour comprendre la place qu’elles ont occupée dans leur couple, dans leur famille, à la cour, dans la société. Le sujet invite donc à dépasser la description des activités de femmes pour les inscrire dans une histoire du couple, de la société de cour et de la noblesse au Grand Siècle.
16/03/2017
De la querelle à l’agonie. Les enjeux épistémologiques des humanistes français face au schisme religieux (1524-1604)
Cette thèse de doctorat aspire à percevoir jusqu’à quel point la dynamique agonale du XVIe siècle déclenchée par la Réforme protestante provoqua des différences irréconciliables parmi les humanistes français. L’analyse prend comme point de départ la querelle sotériologique entre Érasme et Luther de 1524, considérée comme l’exemple le plus paradigmatique de l’impossibilité de trouver une compatibilité bien entendue entre les diverses manifestations de l’enthousiasme philologique, stylistique, éthique, religieux et épistémologique des humanistes. Ses oppositions fondamentales en ce qui concerne la liberté du chrétien démontrèrent que les humanistes étaient contraints d’envisager l’élan de réforme avec prudence afin d’éviter de mettre en danger leurs propres fondements épistémologiques. Par ailleurs, l’affrontement entre ces deux hommes tellement représentatifs de la Renaissance tardive peut bien inaugurer l’étude du cas français à cause de l’influence d’Érasme sur les humanistes vassaux du Roi Très-Chrétien, mais aussi à cause de l’échec de la collatio érasmienne. Le centre de gravité historique est l’événement le plus révoltant de la France du XVIe siècle, i.e., le massacre de la Saint-Barthélemy. Le choc provoqué par la tuerie fut si définitif qu’on peut, faisant attention aux participations directes des humanistes dans la polémique confessionnelle avant et après août 1572, reconstruire le socle commun de discours dont beaucoup d’eux partageaient. Nonobstant, ces dénominateurs communs encouragèrent paradoxalement des dynamiques agonales autant qu’ils permirent la survivance d’une courante irénique marquée par la tradition sceptique qui finira par être une des marques d’identification historiographique du discours humaniste.
Habilitations à Diriger des Recherches (HDR)
Texte ?
2022
10/12/2022

Thierry
RENTET
Réseaux et histoire au siècle de la Renaissance.
Dans le cadre d’une HDR intitulée « Histoire et réseaux au siècle de la Renaissance », le mémoire de recherches inédit est centré sur l’analyse des lettres reçues par Bertrand-Raimbaud de Simiane, baron de Gordes, lieutenant général du roi en Dauphiné entre 1565 et 1578. 10 % des 7 000 lettres reçues par M. de Gordes entre 1565 et 1576, conservées aux Archives du Château de Chantilly dans les 31 volumes de la série K, ont été rédigées par les membres de son lignage : mère, épouse, fratrie, enfants, gendres et cousins de La Coste. Le mémoire repose sur la présentation une « Géographie épistolaire d’un lignage pendant les premières guerres de religion ». Sa première partie tente de comprendre la logique des déplacements des membres du lignage dans la double optique d’appréhension des rapports entre ces personnages, et entre ceux-ci et les différents pouvoirs auxquels ils sont confrontés, seigneurial, provincial et royal. La seconde partie envisage de définir la notion de « séquence épistolaire » à partir de deux angles. D’une part l’analyse d’une séquence qualifiée de verticale, composée d’un corpus de 19 lettres reçues par M. de Gordes suite au décès de son fils aîné en février 1575 ; d’autre part, la présentation d’une séquence dite horizontale, composée à partir des 271 lettres reçues pour le mois de mars 1574, qui tissent un maillage épistolaire autour de M. de Gordes.
Garant
2021
12/01/2021
Stéphane
JETTOT
Élites sociales et mémoire familiale
à l'épreuve des crises politiques.
Mon mémoire inédit intitulé, ‘The Milk of Human Kindness.’ Family Directories and the Commodification of the Aristocratic Past in Britain (1700-1832), traite de la marchandisation des récits de famille nobiliaire et de leur circulation à travers la société britannique. J’ai essayé de comprendre cette lente transition d’une culture matérielle de l’ancestralité encore fondée au XVIIe siècle sur la réalisation d’artefacts coûteux (monuments funéraires, vitraux, pédigrés enluminés) vers la vente de compilations et de dictionnaires familiaux. L’ouvrage repose sur une étude inédite du marché du livre londonien qui a facilité une reconfiguration du passé nobiliaire et de l’honneur aristocratique afin d’intégrer les nouvelles élites mercantiles, coloniales et industrielles. A partir de la correspondance échangée entre les familles et les éditeurs, il est possible de mettre en évidence, au-delà des valeurs patriarcales usuelles, des nouvelles dynamiques au sein de la parenté, entre aînés et cadets mais aussi entre hommes et femmes. Je me suis posé enfin la question de la crédibilité des récits, la manière dont ils sont alternativement rejetés ou considérés comme vraisemblables. Outre leur caractère fictionnel, ils suscitent dans les gazettes de nombreuses critiques : ils sont ainsi accusés d’être écrits par des écrivaillons, des créatures ministérielles ou même des imposteurs. Pourtant en dépit de nombreuses campagnes de dénigrement, leur succès commercial est indéniable et confirme le besoin croissant d’identification des élites, entre elles ou par des acteurs extérieurs.
Garant
2020
05/12/2020
Laurent
VISSIÈRE
De poudre et de feu.
Un Moyen-Âge sans crépuscule.
Le mémoire inédit (HORIZONS BARRÉS. Réalités, pratiques et hantises de la guerre de siège au XVe siècle). traite de manière sérielle plus de 150 sièges menés en France et dans le monde francophone, entre 1410 (début de la guerre civile) et 1483 (mort de Louis XI). Bien qu’assez brève, la séquence chronologique compte un grand nombre d’opérations obsidionales : la guerre civile des Armagnacs et des Bourguignons, la seconde phase de la guerre franco-anglaise, les guerres de Bourgogne et celles de Louis XI, ainsi que le grand siège de Rhodes (1480). Les sièges retenus pour ce travail ont tous été étudiés pour eux-mêmes et non en fonction de leurs conséquences politiques. Il ne s’agissait pas de récrire une histoire des guerres du XVe siècle, mais de comprendre ce que représentait la guerre obsidionale pour les contemporains. Si je me suis, bien sûr, intéressé à la poliorcétique (théorie et pratique de la guerre obsidionale à l’heure du canon), j’ai surtout axé mes recherches sur les problèmes matériels et psychologiques qui se posaient à une population confinée à l’intérieur de son enceinte. Les civils subissent une militarisation complète de leur paysage – dont l’horizon est désormais barré par les armées ennemies –, et de leur quotidien. Toute la société est mobilisée à la garde des murailles, y compris les ecclésiastiques, les femmes et les enfants, ce qui pose de nombreux problèmes – entre autres, famine et épidémies. Cette communauté vit au rythme des alertes, des cris, des menaces et d’une angoisse toujours accrue – la « fièvre obsidionale ». Les puissances surnaturelles sont en outre particulièrement sollicitées et, dans une ambiance électrique, miracles et prodiges tendent à se multiplier. Un dernier chapitre est consacré à la résolution des sièges – l’assaut et le sac, la composition, l’abandon –, ainsi qu’à la manière dont le souvenir du siège, grâce à des textes officiels, des légendes orales et des cérémonies anniversaires, s’intègre à la mémoire civique d’une population, parfois jusqu’à nos jours.
Garant
12/09/2020

Mélanie
TRAVERSIER
De la musique du pouvoir aux pouvoirs de la musique :
les mondes musiciens dans l’Europe des Lumières.
Le dossier d’habilitation est intitulé De la musique du pouvoir aux pouvoirs de la musique : les mondes musiciens dans l’Europe des Lumières (vol.1-Traversières ! Voies et voix d’une historienne de la musique ; vol.2-Recueil de travaux ; vol.3-Nouvelles vagues. Les sœurs Davies et l’harmonica de Benjamin Franklin).
L’essai inédit, qui entremêle l’histoire croisée de deux musiciennes anglaises et de l’instrument de cristal mis au point par Franklin, questionne les processus de conception, de certification et de diffusion de l’innovation organologique dans l’Europe des Lumières. L’enquête sur les réseaux du marché de la musique et l’histoire du goût musical est ainsi décloisonnée pour intégrer les mondes sociaux de la musique à ceux de la science, de la médecine en particulier, et de la technique.
Garant
2019
14/12/2019
Youri
CARBONNIER
Harmonies urbaines (XVIIe-XIXe siècle). Les derniers musiciens du roi de l’Ancien Régime Versailles-Paris (1761-1792).
Le mémoire inédit, intitulé Les derniers musiciens du roi de l’ancien Régime. Versailles-Paris 1761-1792, 3 vol. (396, 108 et 280 pages), constitue une étude à la fois institutionnelle, sociale et culturelle d’un groupe social particulier, inséré dans le monde de la Cour comme dans la ville, saisi entre deux dates clés. Il est complété par un recueil de 24 publications et un ouvrage publié, illustrant deux décennies de recherches en histoire urbaine (urbanisme et aménagement des villes, étude des sociétés urbaines) et en histoire des musiciens et des pratiques musicales, entre le XVIIe et le XIXe siècle.
Garant
08/06/2019
Marie
BOUHAÏK-GIRONÈS
Histoire des pratiques théâtrales
(France, XIIIe-XVIe siècles).
Spectacles des mystères chrétiens
Produire, écrire et jouer les Passions et vies de saints (France, XVe-XVIe siècles).
Le Mystère des Trois Doms joué à Romans à la Pentecôte 1509 est l’événement spectaculaire le mieux documenté du domaine français avant le milieu du XVIe siècle. Le mémoire inédit du dossier est une étude de cas fondée sur l’examen minutieux des archives et de la comptabilité du spectacle. Nous pouvons suivre la chronologie de l’événement, du geste votif à l’exécution du spectacle, soit un an dans la vie d’une cité, qui commande, finance et produit, compose, invente et versifie, scénographie, décore et donne à voir, distribue les rôle, répète et joue. On suit les acteurs qui construisent l’événement : la Ville et l’Église, les auteurs, les charpentiers, les peintres et les maîtres des secrets, les acteurs et les musiciens. Une attention particulière est donnée à la genèse du texte et aux joueurs, en une histoire pragmatique des gestes d’écriture et de jeu. La focale de l’historien est mise sur le chantier spectaculaire et les étapes du travail. Car le temps de préparation d’un mystère est aussi, voire plus, essentiel, pour la communauté qui le porte que le temps de sa représentation.